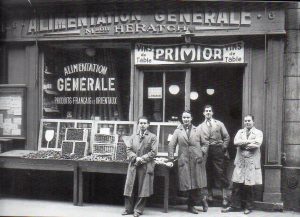Mercredi 2 novembre, à l’Université américaine d’Arménie, projection du film documentaire Motherland, de Vic Gerami, suivi d’une discussion avec Irina Ghaplanian et un vétéran
Par Gayané TCHARKHOUDIAN
Dès le début, Vic se met en scène, parle dès la première minute et ne s’arrêtera quasiment jamais, malgré ce qu’il présente comme des évènements d’une «unspeakable violence»…
Il raconte : « I went to my motherland ». C’est le film d’un journaliste qui présente un conflit armé en même temps que son conflit identitaire.
Il informe rapidement qu’il s’oppose à l’appellation de « guerre » pour qualifier ce qui se passe, préférant le terme d’« invasion ».
Le 1er tiers du film parle de lui, de son histoire, de son travail. Pendant les interviews, il y a beaucoup de plans sur lui où il ne semble pas du tout naturel…
Puis, il ajoute la donnée de son homosexualité, comme argument en faveur de son combat pour l’injustice, le jugement négatif sur une minorité. Il insert des photos avec des célébrités représentantes de la cause (Cher, Kardashian, …)
Le film est construit en 8 chapitres (Artsakh, Build up, Attack, Aftermath, it’s personnal, International community, Media, Where are we going now), en un crescendo de violence, de révélations, puis se stabilise sur un niveau d’horreur où plus rien ne choque à la fin et semble être mis sur le même niveau (corruption et malhonnêteté d’Aliev, des représentants du Conseil de l’Europe, tortures, Vic qui se promène dans les rues de Erevan, qui prie dans les églises…). Ce mélange donne presque la nausée et frôle même parfois le grotesque…
Il contient énormément d’interviews avec des spécialistes, des politiciens, et des familles d’Artsakh, des rescapés et des soldats vétérans.
C’est un film épuisant, qui essaie d’exciter les sentiments, faisant penser au style des documentaires de Michael Moore.
L’abondance des thèmes rend le film étouffant. Il joue surtout sur les émotions (pitié, haine, dégoût, horreur), les sensations.
Le montage est très frénétique, voire épileptique : scènes mélangées, à la fois la dénonciation des scandales politiques, les vidéos amateurs montrant des horreurs (bombardements, tortures), mêmes scènes qui reviennent plusieurs fois, des images d’archives du génocide.
Pour moi, le film trop long, ce qui dilue le propos et illustre bien l’avalanche de sources, de documents auxquels on a accès aujourd’hui, de vidéos, de messages tweet, d’interviews officielles.
La bande son alterne entre des chants religieux, des extraits d’opéras de Khatchadourian, des bruits d’explosions, des musiques de film de types dramatiques,…
Les dernières paroles du film sont : une citation (dont j’ai oublié l’auteur) plutôt tautologique : « Si rien ne change, rien ne change », puis une question peu originale « Nous devons faire les choses différemment. Mais le ferons-nous ? » (« If nothing changes, nothing changes, We need to do things differently, but will we do it ? »)
Qui est ce « nous » ? Il enjoint le spectateur à sortir de sa zone de confort, mais en quoi est-il sorti de la sienne ? On le voit, trop souvent, se promener dans les rues de Erevan, dans les églises, au restaurant, à Vernissage, conduire des interviews dans des salons d’hôtels, des cours internes de restaurant…
Après le film : discussion public / réalisateur, spécialiste et vétéran. Moment très émouvant, il y a eu des moments de silence.
C’était gênant parce que c’est un sujet sensible pour le public, qui a vécu ces évènements. On peut se demander : pourquoi regarder ce film ?
Dans la discussion finale, il a affirmé que tout ce qu’il a montré est vérifié, revérifié et 100 % authentique, avec une assurance même un peu douteuse, quand on pense à la relativité des sources. Le réalisateur était très fier de lui. Il dit avoir hésité à introduire son homosexualité dans le film, mais finalement l’a fait en pensant que ça aiderait le combat, car ça montre encore plus de raisons d’être persécuté…
La parole du vétéran était la plus sincère et avait le plus de valeur à mes yeux. Il a exprimé sa surprise par rapport au nombre peu élevé de spectateurs venus assister à la projection. Pour lui, c’est un vrai acte de courage que de venir voir ce film, car il a vécu ces choses en première ligne, et il semblait placer des espoirs dans ce film qui ont été décus.
Il y eut des interventions du public assez touchante, des femmes ayant contribué aux combats, remerciant le vétéran en lui disant « vivez pour que l’on vive » et que les gens qui n’ont pas combattu ne sont pas indifférents.
De mon point de vue, la seule chose authentiquement touchante dans ce film fut le témoignage des jeunes vétérans, malgré les maladresses de Vic dans sa façon de conduire les dialogues…
Beaucoup de questions me sont venues, toutefois j’ai préféré observer l’atmosphère en semi-silence, même si beaucoup de choses m’ont rendue furieuse !!
Ce film fut épuisant. On est en droit de se demander : en quoi change-t-il quelque chose à la situation ? Tous les faits sont là, mais finalement, quel impact positif a ce film ? En quoi contribue-t-il à la lutte ?
Questions que j’aurais voulu poser :
– A qui vont les bénéfices du film ?
– Comment a-t-il écrit son film ? Est-ce qu’il avait tout préparé à l’avance, pensé en amont à la structure du film et ensuite conduit les interviews ? ou alors a-t-il récolté le matériel en amont, puis essayé de lui donner une forme documentaire ? Car pour moi, c’était plutôt une accumulation de preuves avec une tentative de mise en ordre par les chapitres, mais finalement, il n’y a pas trop de progression…
– Pourquoi introduire son homosexualité, quand ça n’a rien à voir avec la guerre. Quel est le but de ce film ? Montrer que, comme les homosexuels, les Arméniens sont victimes d’une discrimination essentialiste ?
Peut-être ai-je été trop critique, car diffuser ces données reste important, mais le statut du spectateur est problématique. Le film semble finalement implorer la pitié, qualifiant même les Arméniens de «some of the world’s most vulnerable people ». La pitié entraîne la victimisation, ce qui est par exemple pour ceux qui ont combattu, un manque de gratitude, à mon humble avis.
Dès le début, il pointe du doigt ceux qui voient mais ne font rien, et remet en question le spectateur. Il est vrai qu’à l’échelle mondiale, peu de gens entendent parler des Arméniens, mais il semblerait que ceux qui sont au courant n’arrivent pas à faire grand-chose pour empêcher ce que l’on voit dans le film… Aussi, voir la machine politique internationale corrompue qui est présentée dans le film peut immobiliser le simple spectateur, car il n’a pas énormément de pouvoir face à ces lobbies superpuissants.
Un film paradoxal car le fond est très lourd et indéniablement condamnable, mais la forme mélange beaucoup d’éléments, remue beaucoup d’émotions contradictoires, et donc perd en efficacité sur ce que le spectateur va penser en sortant de la salle, va vouloir entreprendre comme démarche.
Enfin, avec des sujets aussi sensibles que la guerre et le génocide, c’est moralement déconcertant de voir le réalisateur être heureux de monter
sur scène, fier de son travail et d’entendre, avant la projection « enjoy the film »….
(Le film a un site internet où on peut voir la bande annonce, les présentations des auteurs, et on peut contacter Vic Gerami)
Par contre, ce soir je suis allée voir Aurora, et j’en suis sortie plus forte et pleine de courage. Je souhaite vraiment qu’il soit largement diffusé.
L’histoire d’Aurora me fait peut-être penser au vétéran de Motherland qui, venu assister à la projection à l’université américaine du film dans lequel il a largement témoigné, replongeant dans des choses qu’il essaie probablement d’oublier, s’étonne que ce film ne fasse pas plus de remous… L’extrême violence subie ne rencontre pas la réponse escomptée de la part de gens qui ne sont que des spectateurs et ne peuvent peut-être pas être autre chose quand on leur propose un film…
G. Tch. ■
MOTHERLAND
synopsis
Et si se battre pour son pays signifiait aller à l’encontre de certaines de ses valeurs les plus traditionnelles ? Motherland est un documentaire sur les femmes qui bousculent la tradition pour débarrasser leur pays des mines terrestres laissées par une guerre ethnique dévastatrice. Paria individuellement ; ensemble, un collectif – les démineurs se soutiennent mutuellement alors qu’ils assument le rôle dangereux de briser les stéréotypes et d’assurer l’avenir de leur république déchirée par la guerre.
Motherland suit deux femmes qui travaillent à temps plein comme démineurs dans le Haut-Karabakh. Ils se sont mis en danger afin de sauver la vie d’innombrables personnes qui utilisent ces terres pour cultiver, ramasser du bois, aller à l’école et reconstruire après la guerre. Malgré leur travail courageux, elles sont toujours confrontées à la stigmatisation des femmes indépendantes qui travaillent dans un pays où elles sont souvent la propriété et la responsabilité des hommes. En suivant leurs histoires, nous explorons non seulement leur travail dangereux, mais aussi leur vie alors qu’ils luttent contre la douleur de leur passé, leurs rêves pour l’avenir de leurs enfants et de leur pays, et l’immense joie et les liens qu’ils partagent.
Ce film est rendu possible en partie grâce au généreux soutien de l’Armenian General Benevolent Union et de HALO Trust Nagorno Karabakh. ■