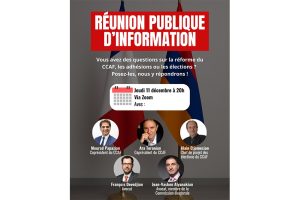De passage à Stepanakert, j’ai rencontré, fin novembre, Armen Sargsyan pour un échange d’idées sur l’avenir du Haut-Karabakh. M. Sargsyan a été ministre de l’Education et de la Culture du Haut-Karabakh, député de la FRA-Dashnaktsoutiun au parlement de Stepanakert. Il est actuellement conseiller du président Araïk Harutyunian.
Sa longue carrière politique et ministérielle, ainsi que sa formation d’historien l’ont conduit à forger une vision politique de la situation au Haut-Karabakh et de son évolution, et à développer des idées intéressantes loin des discours démagogiques…
Je commence la discussion par un long développement sur l’analyse d’un certain nombre d’experts sérieux qui présentent, dans les médias arméniens, une analyse digne de ce nom, sur la situation politique et sociale tant en Arménie qu’en Artsakh, sans pratiquer le langage simpliste auquel ont malheureusement recours dans nombre de plateformes d’information ou de chaînes de TV, proches de l’opposition parlementaire à Erevan.
Je lui rappelle donc que les observateurs avertis font part de leur constat d’affaiblissement de la Russie, notamment suite à la guerre d’Ukraine. Cet affaiblissement se fait notamment sentir dans les zones d’influence traditionnelles de la Russie, comme dans le Sud-Caucase où elle avait pu s’imposer définitivement par les traités de Gulistan et de Turkmen-Chay au XIXe siècle contre la Perse.
Michaël Zolian, ancien député au parlement d’Erevan et expert politique, estime que les fréquentes menaces d’Ilham Aliev proférées à l’égard de l’Arménie et même ses interventions militaires (le 13 septembre dernier, …) témoignent de cet affaiblissement qui élargit par voie de conséquence sa marge de manoeuvre politique et diplomatique. Un autre exemple que je cite est l’absence de référence au Haut-Karabakh dans le communiqué de la réunion tripartite de Sotchi, le 31 octobre dernier, confirmant la capacité actuelle du président azéri à imposer son point de vue à ses deux interlocuteurs, le président Poutine et le Premier ministre Pashinyan.
Je me souviens dans une discussion que Claire Mouradian m’avait, dans le temps, fait remarquer que la Russie avait mis quatre siècles pour conquérir le Caucase et sans doute elle n’allait pas le quitter facilement. Cependant, le fait est qu’elle l’a quitté, certes pour un court laps de temps, en raison de la révolution bolchévique et rien ne prouve qu’elle ne le réitérera pas. De plus, l’incursion de la Turquie d’Erdogan en Azerbaïdjan, outre sa forte présence économique en Géorgie doit être interprétée comme un recul géostratégique relatif de Moscou dans cette zone.
Dans ces conditions, on peut légitimement s’interroger sur la continuité de la présence militaire russe dans le Haut-Karabakh. La reconduction de cette présence est conditionnée dans la déclaration du 9 novembre 2020 à l’accord de Bakou et d’Erevan en 2025.
Mon interlocuteur y acquiesce en précisant que la Russie fait actuellement face à une situation difficile en Ukraine. Cependant, dit-il, si l’Occident parvient à un accord sur l’Ukraine avec la Russie, alors, celle-ci restera au Sud-Caucase, donc au Haut-Karabakh au-delà de 2025, car si les Russes retirent leur contingent, ils seront amenés à quitter également leur base militaire de Gyumri, ce qui signifiera le retrait russe du Sud-Caucase. Il s’ensuivra un renforcement de l’influence turque dans cette sous-région. La Turquie est déjà omnipotente en Géorgie de par ses investissements dans plusieurs secteurs importants de l’économie. Elle est également présente militairement surtout en Azerbaïdjan. Bakou lui a mis à disposition une base militaire à Lankaran en plein pays talish.
Il est vrai que la signature de la déclaration du 9 novembre 2020 a permis aux Russes de s’installer au Haut-Karabakh, donc pour les Azéris, en Azerbaïdjan. Et, beaucoup d’Arméniens du territoire sont convaincus que le contingent y restera longtemps. Armen Sargsyan semble se ranger en faveur de l’hypothèse du maintien à l’avenir des troupes russes.
Je cite encore les propos de Michaël Zolian qui s’étonne de telle affirmation en général. Samuel Babayan, ancien héros du Haut-Karabakh, lui, sur Factor-TV, croit que les Russes partiront même avant 2025, compte tenu de l’imprévisibilité des décisions de Moscou. Ara Papian, ancien ambassadeur au Canada, s’interroge sur 106,5Radio: « si ce contingent se retire que fera l’Artsakh? » et, pour sa part, le politologue Areg Kochinian n’exclut pas un tel scénario et exhorte Erevan à prévoir un scénario catastrophe pour ne pas être pris au dépourvu.
Mon interlocuteur historien rétorque que la Russie ne voudra pas d’un rapprochement entre Ankara et Bakou qui permettra in fine à la Turquie d’accéder à l’Asie centrale.
Je repose la sempiternelle question : Que doit faire le Haut-Karabakh ?
Une diplomatie visant à coopérer tous azimuts
Pour l’ancien ministre « une politique multi-vectorielle » est la réponse adaptée à la situation actuelle. « Il faut donc coopérer avec tout le monde », précise-t-il. Il souligne l’attitude favorable de la France et la résolution du Sénat, la reconnaissance par 15 Etats américains (sic) du Haut-Karabakh, …. Cette coopération tous azimuts est possible du fait que la question du Haut-Karabakh constitue un terrain où Russes, Américains et Français ont pu coopérer (à travers le groupe de Minsk). Si l’Occident et la Russie renouent, cette coopération revivra.
J’insiste auprès de mon interlocuteur : et, si Bakou dit non à la reconduction de la présence russe en 2025 … Il me répond que la Russie reconnaitra l’indépendance du Haut-Karabakh et celui-ci demandera le maintien du contingent sur le territoire.
Je reste dubitatif face à cette réponse (peut-être un peu trop rapide et tranchante). Moscou brandira probablement la menace de reconnaissance de l’indépendance, mais le président russe risquera-t-il de se mettre en contradiction, alors qu’à deux reprises, il a déclaré publiquement que le Haut-Karabakh faisait partie intégrante de l’Azerbaïdjan?
Une politique visant à renforcer l’État
comme un acteur politique
Dans un entretien, David Babayan, ministre des Affaires étrangères (actuellement par intérim), m’avait dit que les forces politiques artsakhiotes devaient agir en sorte que le Haut-Karabakh redevienne acteur politique et non un objet subissant l’agenda d’autres Etats. Ces propos laissaient entendre, dans mon esprit, que tel a été le cas dans le passé.
Le conseiller Sargsyan exprime son parfait accord avec l’idée de M. Babayan. Pour cela, il est indispensable que tant l’Arménie que l’Artsakh soient acceptés par tous comme « deux Etats pour une nation ». Il rappelle l’exemple de la Turquie et de l’Azerbaïdjan dont la diplomatie véhicule ce narratif. Pour M. Sargsyan, cela implique qu’Erevan « garantisse l’existence de l’Artsakh », d’une part, et que Stepanakert « participe aux négociations en tant que tel… », d’autre part. Le cas du Kosovo est parlant à cet égard, d’après lui, car ce pays a agi dans les négociations avec la communauté internationale comme un « sujet étatique fort ». Il en est résulté que le gouvernement kosovar a pu préserver l’intégrité territoriale avec la partie serbe du territoire.
* * *
Le raisonnement d’Armen Sargsyan semble considérer immuable une influence exclusive russe dans le Sud-Caucase, en dépit des reculs enregistrés par Moscou. L’homme politique averti n’ignore pas pour autant que l’Occident et certaines puissances régionales s’y intéressent de plus en plus. Or, le processus d’affaiblissement de la Russie qui s’est enclenché avant ses déboires en Ukraine, a amené les dirigeants de Moscou à composer avec la Turquie d’Erdogan. L’analyste Hagop Badalian emploie une expression intéressante, pour décrire le nouveau rapport de forces russo-turc, « la frontière a été amenée d’Akhourian (la rivière d’Akhourian) à Shushi » après la guerre des 44 jours. Personne n’ignore que l’Occident (USA et UE) , de son côté, tentent de renforcer son engagement dans la zone.
Marc ALENZI ⊆