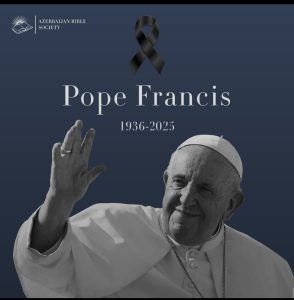Par Marc DAVO
Fermé par les Azéris depuis le 12 décembre dernier, sous prétexte fallacieux de protection de l’environnement, avec la complicité suspectée de la Russie, le couloir de Latchine est l’artère vitale du Haut-Karabakh. Il ouvre le territoire, via l’Arménie, sur le monde extérieur. Nous n’allons pas discuter des tenants et aboutissants de cette ténébreuse affaire qui choque non seulement la communauté nationale mais qui doit interpeller les pays épris de libertés. L’affaire a été examinée au Conseil de sécurité de l’ONU, où la représentante de la Russie s’est employée à la ramener au niveau d’incident technique, alors que l’Irlande, la France et les Etats-Unis, … ont exigé la réouverture du couloir.
Certes, les Ukrainiens, quotidiennement bombardés, sont dans une situation pire que les Artsakhiotes, mais ces derniers ont le droit de vivre en paix et non subir les vexations et les menaces des Etats prédateurs.
Ce qu’on va évoquer ici, c’est un aspect particulier de la question des responsabilités. En effet, qu’il y ait complot et tentative de créer un climat d’insécurité de la part de Bakou, il n’y a pas de doute. Qu’il y ait complicité russe dans cet imbroglio, un faisceau d’arguments plaide en ce sens.
L’assassinat des combattants arméniens par les militaires azéris suite à la non-intervention des soldats russes à Khtsabert au lendemain de la signature du cessez-le-feu du 9 novembre 2020, l’installation des Azéris à Paroukh (un village situé près d’Askeran), consécutive à l’intrigue du commandement russe au Haut-Karabakh et à la naïveté ou plutôt l’incompétence du secrétariat du Conseil national de sécurité de Stépanakert puis, l’occupation par les soldats azéris des hauteurs de Yeghtsahogh, près de Latchine puis, l’évacuation avant échéance des trois localités de Latchine, Aghavno et Sus et enfin, la coupure de gaz, sans parler des interruptions ou des perturbations d’internet … témoignaient de façon la plus évidente que les autorités azéries allaient continuer leur entreprise maléfique en vue de la désarménisation du territoire. Tout cela a eu lieu pendant deux ans et à intervalles réguliers.
Les autorités de Stépanakert étaient donc averties de la manière dont Bakou comptait agir avec le Haut-Karabakh. Nous ne sous-estimons pas leur mobilisation sur le programme de construction de logement pour les déplacés de Shushi et de Hadrout, encore qu’ils ne sont pas encore tous relogés. Cependant, ces mêmes autorités sont sensées gérer et surtout anticiper les manoeuvres prévisibles azéries visant à créer la panique ou l’insécurité.
La bonne gouvernance ne veut pas dire seulement la bonne parole rassurante. Elle ne doit pas se limiter à des slogans d’encouragement et de rassemblement sur la Place de la renaissance. Elle demande des mesures concrètes dans tel ou tel cas de figure créé par l’ennemi qui est à l’afflûx. D’autres crises peuvent encore venir.
Ruben Vardanyan, avec de larges prérogatives par rapport à son prédécesseur, Artak Beglaryan, a une grande expérience de gestion. La bonne gestion, c’est aussi la prévision et l’anticipation. A la décharge du nouveau ministre d’Etat, on peut dire qu’il vient d’arriver en octobre et son équipe définitive n’est pas encore installée. Mais quand on prend la direction d’un pays, on vient avec des plans et mesures provisoires pour parer à faire face à toute situation d’urgence. Depuis octobre dernier, les ministres sont chargés d’expédier les affaires courantes en attendant la désignation de nouveaux titulaires. Une équipe compétente doit être mise en place le plus rapidement possible. Ce ne sont pas les conseillers dans l’entourage auxquels il convient de confier la gestion et donc la responsabilité des dossiers.
Aussi bien l’équipe précédente que celle de M. Vardanyan auraient dû prendre des mesures concrètes telles que le stockage des denrées alimentaires, l’élaboration d’un plan d’approvisionnement et de recherche de sources alimentaires, des médicaments, ou même certaines pièces de rechange stratégiques (appareils industriels, informatique, …), bref des stocks stratégiques de 3 mois par exemple, etc. etc.
La route reliant Goris (en Arménie) à Stépanakert n’est fermée qu’à hauteur de Shushi. Elle est praticable jusqu’à Lissagor à partir de la frontière arménienne, en passant par Hin Shen et Mets Shen, à l’intérieur du territoire du Haut-Karabakh. Parallèlement à la demande d’ouverture de l’aéroport de Stépanakert, comme l’a formulée Ruben Vardanyan à la communauté internationale, l’instance de sécurité (conseil de sécurité, police, …) aurait pu sélectionner et rendre praticable des sentiers pour l’approvisionnement de la capitale et au-delà, quel que soit son volume. Il existe plusieurs moyens de le faire parvenir à la population. Pendant les longues années de guerre au Vietnam, la piste Hô Chi Minh a bien servi à approvisionner en armes et en alimentation les unités situées dans le sud. Tout était transféré en bicyclette ou à pied. L’écrasante machine de guerre américaine n’a pas pu empêcher ce flux quasi continu.
Enfin, le dernier accroc de Berdzor n’a manifestement pas servi de leçon. Il aurait fallu commencer la construction d’une route alternative à partir de Lissagor vers Stépanakert contournant Shushi occupé par les hordes de militaires et de miliciens azéris.
Gageons que la nouvelle équipe gouvernementale se ressaisira et adoptera les mesures adéquates. Elle a largement le temps puisqu’elle “travaille du 7h00 jusqu’à 2h00 (du matin)”, aux dires même de M. Vardanyan. ■