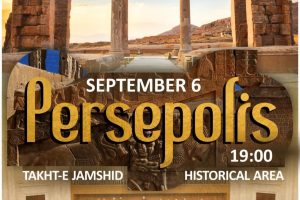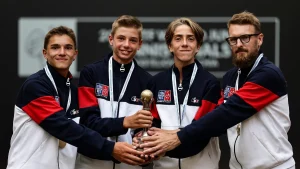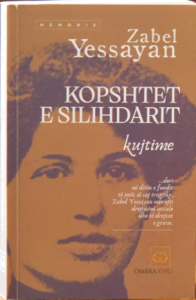Le 21 avril, à l’initiative de la maire du 9e arrondissement de Paris, Delphine Burkli, l’ancienne « Place Chavarche Missakian » dans le 9e arrondissement a été rebaptisée ; le nom d’Arpik Missakian, la fille de Chavarche, étant ajouté à celui du père. Désormais cette place s’appellera « Place Chavarche et Arpik Missakian ».

Étaient présents à la cérémonie d’inauguration l’ambassadeur d’Arménie Mme Hasmik Tolmajian, l’historien des génocides, Dr Yves Ternon, le conseiller de Paris, Alexis Govciyan, les Maire-adjoints : Arnaud Ngatcha, Jean-Pierre Plagnard, Laurence Patrice, des responsables de la Maison de la culture arménienne de Paris, ainsi que le révérend Joël Mikaelian, président des Églises évangéliques de France et les membres de la communauté.
Ont successivement pris la parole Mme Delphine Burkli, M. Arnaud Ngatcha, Mme Laurence Patrice, Dr Yves Ternon et Mme Hasmik Tolmajian. Dans leurs interventions, ils ont souligné la signification de cette journée, l’importance du devoir de mémoire, le sens du devoir civique des deux personnalités à qui on rendait hommage, l’importance de renforcer l’amitié franco-arménienne. En ce qui concerne les prises de parole, il aurait été préférable de faire appel à une personnalité du monde culturel connaissant bien le journal « Haratch », plutôt que de donner la parole à trois membres de la municipalité, qui pour ne pas répéter les mêmes propos que Mme la Maire finalement n’avaient rien à dire de particulier. Dr Yves Ternon est un historien des Génocides, qui a rencontré Arpik dans les années 1970, qui lui était de bon conseil pour effectuer ses recherches sur le Génocide arménien. Il manquait également la présence d’un représentant de la communauté franco-arménienne, comme par exemple un représentant du CCAF, ou de la Maison de la Culture… Mme Tolmajian, l’ambassadeur, représentant la République d’Arménie, mais pas la communauté arménienne de France.
Dans les discours de tous les intervenants, la lutte d’Arpik avait trait au passé. Pourquoi lier l’activité journalistique d’Arpik et de Chavarche au passé, alors que tous les Missakian, père et fille, menaient une lutte quotidienne pour le devenir de la communauté arménienne, pour son avenir ? Les discours de tous les orateurs relevaient du passéisme. Pas un mot sur l’avenir des Arméniens de France et de la diaspora. Le passé, le Génocide et le devoir de mémoire. Les organisateurs de cette initiative semblaient ignorer totalement le combat existentiel que menait « Haratch » pour vivifier la vie intellectuelle, sociale, culturelle, littéraire, linguistique et revendicative de la communauté.
Comme l’ont annoncé les orateurs du jour, une telle initiative à la veille du 24 avril était une manière de commémorer le Génocide. Et la parole donnée à Yves Ternon, a, un peu plus, souligné ce caractère. A priori, c’est un honneur pour la communauté arménienne de mériter d’un tel hommage, qui a reçu l’assentiment de tous les courants politiques de la Mairie de Paris. Cependant, l’activité, l’œuvre des intellectuels arméniens et des personnalités de la presse arménienne de la diaspora, doivent-elles être inéluctablement liées au génocide des Arméniens ? La journée internationale de la liberté de la presse, la journée des Saints-traducteurs de la culture arménienne, la date anniversaire de naissance d’Arpik ou l’anniversaire de « Haratch » auraient pu être des occasions plus significatives pour honorer les mérites d’Arpik Missakian.
Une initiative maladroite
Tout en respectant l’initiative de la Mairie de Paris 9e d’honorer les deux figures emblématiques de la presse arménienne, inscrire leurs noms sur une même plaque ne nous paraît pas du tout justifiée. Elle est même une maladresse. Chavarche et Arpik étaient deux notoriétés de nature différente. Deux mondes différents. Chavarche, une figure du pays, et Arpik, celle de la diaspora. Chavarche Missakian était un intellectuel formé à Istanbul, chef du parti FRA Dachnaksoutioun, figure révolutionnaire, il était devenu rédacteur en chef au gré des circonstances afin de défendre la cause nationale. L’intellectuel, l’homme politique utilisait le journalisme comme moyen pour diffuser les idées de la lutte contre les exactions et l’obscurantisme du régime ottoman. Pendant la période du génocide, il a mené une activité clandestine, envoyant à l’Étranger des informations authentiques de première main à propos des atrocités commises lors de la Première Guerre mondiale. Il faut lire « Chavarche Missakian. Le premier documentariste de la Grande catastrophe » de Yervant Pamboukian publié en 2017, pour comprendre la personnalité de Chavarche Missakian. A Paris, le 17 novembre 1924, sur décision de la 10e Assemblée générale de la FRA Dachnaksoutioun, il reprenait, en France, la publication du journal « Haratch ». Il a forgé toute une génération par son journal. Outre cette initiative de reprendre la publication du journal en France, il fut le fondateur de la FRA Nor Seround.
Arpik Missakian, quant à elle, était née en France, avait fait ses études en France, était élevée au contact quotidien de son père et des intellectuels de la rédaction de « Haratch ». C’était presque naturel qu’elle en devienne la rédactrice et la directrice. Elle évoque la situation créée par la mort de son père par ces lignes dans son article intitulé « Mots d’adieu » (dernier numéro de « Haratch », 30-31 mai 2009) : « A la veille de la mort de Chavarche, à l’automne 1956, nous avions prévu de créer une imprimerie, afin de mettre fin à l’errance de la publication de “ Haratch ” d’imprimerie en imprimerie … Mais la mort nous en a empêchés et nous sommes restés orphelins. Après de longues hésitations, nous avons décidé de nous en tenir à notre projet, même si les interrogations demeuraient. Arriverons-nous à continuer ? Les plus optimistes prévoyaient une vie de cinq ans pour le journal, privé de Ch. (Signature utilisée par Chavarche – « NH ») et de ses éditoriaux. » Chez Arpik, on ne trouve pas cette affiliation à un parti. Bien au contraire ; afin de préserver l’indépendance du journal, elle a lutté jusqu’à la fin de sa vie contre la reprise en main de « Haratch » par la FRA. C’est peut-être la différence la plus marquante entre elle et son père : l’indépendance de la presse. Et on sent là, l’influence de la culture journalistique héritée de la France. Dans le film documentaire d’Arby Ovanessian dédié à « Haratch » et à Arpik, intitulé « Haratch 83 », tourné du vivant de Mme Missakian en mai 2009, quelques jours avant l’arrêt du journal, elle formulait de la façon suivante le rapport de la FRA et du journal « Haratch » : « “ Haratch ” était le journal d’un militant dachnagtsagan et pas un journal dachnagtsagan ». Rien qu’en considérant ses différences, il n’était pas judicieux de mettre les deux noms sur la même plaque.
Sur le panneau de la « Place Chavarche et Arpik Missakian », on peut lire : « Chavarche Missakian, fondateur du journal “ Haratch ”, Arpik Missakian, rédactrice en chef ». Si la désignation concernant Arpik est correcte, celle de Chavarche néanmoins est incomplète. Le leader du parti, le révolutionnaire, l’intellectuel luttant pour la survie de l’arménien occidental, l’éducateur y sont délaissés. Et, c’est injuste, car c’est renié tout un pan de son passé de militant de FRA, de résistant à l’oppression turque, au service de la défense de la cause arménienne. C’est oublier le prisonnier politique qu’il était, qui suite à une délation s’est fait incarcérer. Il a survécu aux tortures dans les geôles turques de 1916-1918. Une période sombre de sa vie qu’il a retracé dans son livre « Face à l’innommable Avril 1915 », traduit par Arpik, paru chez les Editions Parenthèses en 2015.
Il faut aussi rétablir une autre vérité historique. Chavarche Missakian est le fondateur de l’édition française du journal « Haratch ». Historiquement, « Haratch » a été fondé en 1905 à Tiflis, après quoi il a été transféré en la ville de Garine (Erzurum) en Arménie occidentale en 1908, fuyant les persécutions de l’Empire Russe de l’époque. Puis pendant la Première guerre mondiale il a été transféré cette fois à Bakou, ensuite pendant la période de l’indépendance, à nouveau, à Tbilissi puis à Erevan. En 1925, Chavarche Missakian reprend sa publication à Paris, comme nous l’avons dit, sur ordre du parti FRA Dachnaksoutioun. Il utilise, pour le titre, le même cliché, aussi les mêmes polices typographiques que celles de HARATCH de Garine.



Il y a aussi une autre circonstance. Le 11 avril 2007, à l’occasion de l’inauguration de la « Place Chavarche Missakian », Arpik n’a publiquement pas caché sa déception au vu d’un lieu aussi insignifiant dédié à son père. Alors qu’elle en était mécontente, la municipalité a, à présent, y ajouté son nom. Il aurait été souhaitable que la Mairie de Paris prenne une décision en tenant compte de tous ces aspects pour honorer ces éminents intellectuels arméniens.
La maison sur le volcan
Cette initiative cache une autre réalité douloureuse. À l’heure où le nettoyage ethnique d’Aliev en Artsakh menace les Arméniens artsakhiotes et où les frontières de la République d’Arménie sont soumises à des bombardements et des attaques quotidiens, il fallait laisser de côté les politesses, les formalités, les hommages, et s’occuper exclusivement de l’extinction du volcan. Il est plus important d’œuvrer pour la levée du blocus de l’Artsakh et pour l’application des sanctions contre l’Azerbaïdjan que d’attirer l’attention du public sur l’inauguration de telle ou telle place, même si ces initiatives sont aussi bénéfiques et expriment de la sympathie envers la communauté arménienne.
Que s’est-il passé après la fermeture de « Haratch » ?
Un dernier point. La Mairie du 9e arrondissement a passé un coup de fil pour nous informer de cette cérémonie d’inauguration. Et c’est tout. Ni une invitation officielle, ni quelconque document pour annoncer l’événement. Les lecteurs de « Nor Haratch », dont l’écrasante majorité sont d’anciens lecteurs de « Haratch », sont restés dans l’ignorance de la réalisation de cette manifestation. C’est peut-être un oubli, toujours est-il que cela démontre la déconnection totale des organisateurs d’une certaine réalité arménienne – dans le cas présent, de la presse franco-arménienne – et ignorent complètement le combat qu’Arpik menait ses dernières années.
Le 29 mai 2009, deux jours avant la fermeture de « Haratch », Arpik Missakian a publié l’ « APPEL AU SOUTIEN POUR LA CREATION DU JOURNAL “ NOR HARATCH ”» (cf. contenu de cet appel ci-après). Cet appel a été signé par des intellectuels de France, de la diaspora et d’Arménie : Kéram Kévonian, Mgr Norvan Zakarian, Khatchig Tololian, Armen Mutafian, Marc Nichanian, Père Haroution Bezdikian, Krikor Beledian, Anahid Ter Minassian, Gévorg Ter Vardanian, Haroutioun Kurkjian.

Outre cet appel, Arpik Missakian concluait par ces lignes son éditorial des 16 et 17 mai 2009, placé sous le chapitre « À qui de droit » et intitulé « Pourquoi sommes-nous obligés d’arrêter la publication de “ Haratch ”» : « Nous espérons, voire même nous sommes convaincus que la communauté arménienne de France se dotera bientôt d’un nouveau quotidien arménien, ayant une imprimerie moderne et une approche contemporaine, afin que la brèche ouverte par l’arrêt de “ Haratch ” ne crée pas un vide. » Et dans le dernier numéro du journal, daté des 30-31 mai, le « Discours d’adieu » se conclut par ces mots : « Il reste cependant à suivre le conseil de Chahnour (poète et écrivain français connu en France sous le pseudonyme Armen Lubin) et à terminer cet éditorial avec une note d’optimisme. En effet, cette décision qui est la nôtre a aussi une conséquence positive. Nous avons créé l’occasion pour un groupe d’intellectuels de descendre dans l’arène et de planifier la création d’un nouveau quotidien et de doter notre communauté d’un nouveau journal, avec de moyens modernes. »
Rappelons que « Nor Haratch », tri-hebdomadaire, est publié, de façon régulière, depuis le 27 octobre 2009 jusqu’à nos jours. Il publie également le supplément hebdomadaire « NH-Hebdo » en français. Il possède aussi son propre site web bilingue, norharatch.com. Arpik Missakian était consciente que la majorité des lecteurs de « Haratch » attendaient une nouvelle initiative, elle a donc répondu à l’appel d’un groupe d’intellectuels. Honorer et glorifier « Haratch » comme un fait marquant du passé, et ignorer son successeur, est l’expression pure et simple d’un passéisme. « Haratch » revit avec « Nor Haratch ». L’adresse de la rédaction du journal reste la même : 83, rue d’Hauteville – 75010 Paris.
« NH »