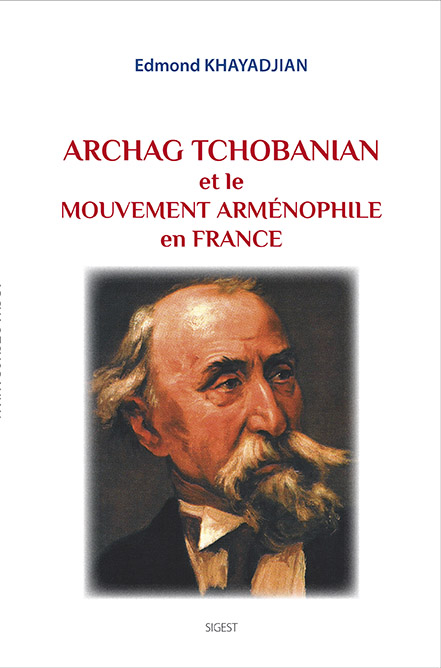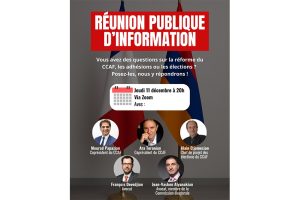Le 24 mars dernier, Séda Mavian, journaliste et historienne, donnait une conférence à Paris sur le thème « Archag Tchobanian et les Arméniens durant la Seconde Guerre mondiale ». Organisée par l’Institut Tchobanian, la conférence s’est tenue dans la salle de la cathédrale arménienne de Paris, avec l’aimable autorisation de l’Eglise apostolique arménienne.
Avant de passer la parole à la conférencière, Varoujan Sirapian, président de l’Institut Tchobanian, a brièvement rappelé les travaux de l’Institut, fondé en 2004, et son action dans les domaines culturel et géopolitique.
Le sujet traité par Sèda Mavian était intéressant et important pour comprendre la situation des Arméniens en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Or si l’on connaît l’Archag Tchobanian (1872-1954), poète, publiciste, intellectuel, promoteur du mouvement arménophile en France, partisan ramgavar et militant de la Cause arménienne, on méconnait sa fonction de président du Comité Central des Réfugiés Arméniens de France dès sa création en 1925 (CCRAF), et le rôle essentiel qu’à ce titre il a joué dans la défense des droits des Arméniens entre 1940 et 1945.
A cet égard, son action fut tous azimuts : défense du statut civil des Arméniens (notamment sa lutte contre les dénaturalisions, par l’obtention de la suspension provisoire de la déchéance de nationalité); défense de leur liberté de travail (notamment sa lutte contre l’interdiction d’exercer pour les praticiens, par l’obtention de dérogations à l’interdiction d’exercer); défense de leur droit de circuler et défense de leur droit aux allocations chômage (sous la forme de l’« assistance-chômage »), ainsi que l’intervention en faveur des prisonniers de guerre pour les faire libérer.
Sèda Mavian a détaillé tous les aspects de cette action multiforme et montré son impact sur la communauté arménienne de France, encore majoritairement constituée, à cette époque, d’apatrides et d’étrangers directement visés par la législation xénophobe de Vichy. Elle a mis en avant le « principe de bienveillance » que Tchobanian avait obtenu pour elle des autorités vichyssoises mais qu’il s’agissait ensuite de faire appliquer à tous les échelons de l’administration française, lorsqu’un Arménien était concrètement confronté à un problème. Là, Tchobanian intervenait à la fois au cas par cas et dans tous les cas qui lui étaient soumis ou dont il avait connaissance.
En conclusion, tout en faisant valoir le côté novateur de son étude, Sèda Mavian a reconnu que le sujet mérite approfondissement, car son travail certes volumineux s’est néanmoins limité à l’étude de la correspondance en français de Tchobanian avec les hauts-dignitaires et représentants de l’État français (jusqu’à Pétain et Laval) archivée au Musée d’Art et de Littérature de Erevan (MAL), et qu’il conviendrait de l’élargir d’une part à la correspondance en arménien avec ses collègues et autres interlocuteurs, conservée au MAL, mais aussi à d’autres fonds. Un appel à peine déguisé au développement de la tchobaniologie …