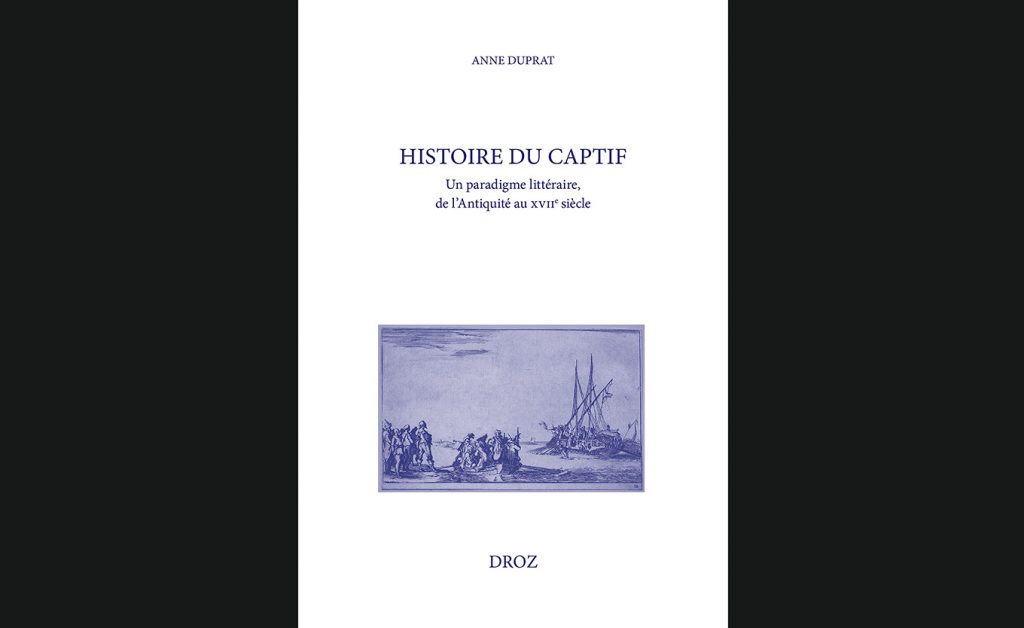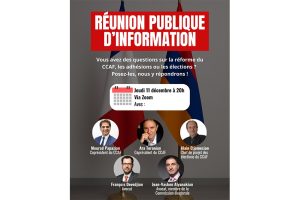Anne Duprat
Histoire du captif
Un paradigme littéraire de l’Antiquité au XVIIe siècle
Librairie Droz, 2023, 492 p., 38,93€
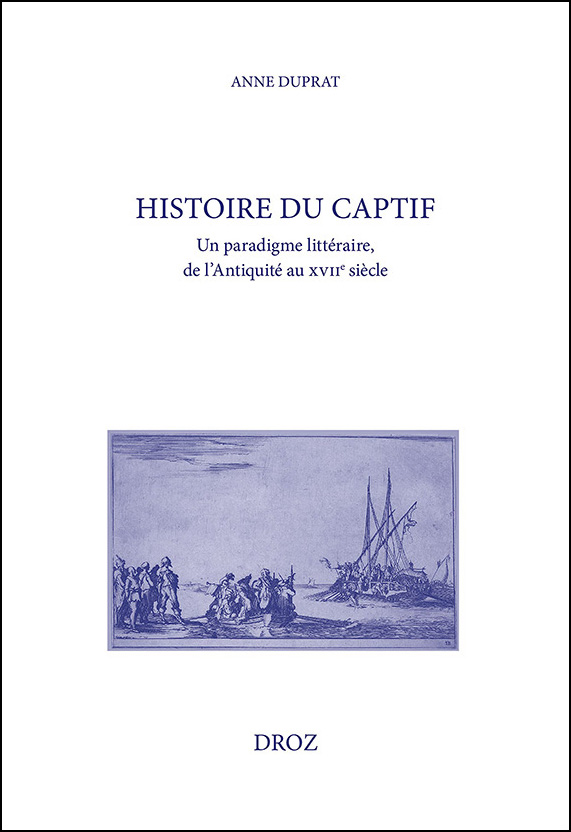
Par un titre emprunté à Cervantes, Anne Duprat mène une enquête érudite où l’Histoire du captif est aussi l’histoire que le captif raconte, un témoignage entrelacé à la fiction, qui « revendique tout ensemble son invraisemblance et sa vérité, sa vocation divertissante et son exemplarité morale, sociale, religieuse et philosophique ». Cette double dimension du récit de captif (véritable /fictif) pose des problèmes critiques quant à l’appréciation d’authenticité (ou d’ « effet d’authenticité ») du récit dont Duprat examine la structure et les critères (nature du discours, posture vis-à-vis de l’autre) selon les époques. Il lui arrive aussi de poser son regard sur des illustrations qui rendent compte des objets composant le décor de l’univers barbaresque. Situant son sujet dans les espaces maritimes des contours de la Méditerranée, où s’affrontent Chrétiens et Musulmans, entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIIe, Duprat, qui n’oublie pas Fernand Braudel, définit l’objet de son livre : établir le « corpus captivitatis, qui donne sens et forme à ce qu’on appellera ici la littérature barbaresque de la première modernité », un « courant littéraire proprement européen » qui participe des « pré- ou proto- orientalismes » et permet de « penser la question de l’asservissement ».
Les récits de captifs transportent le lecteur, le « ravissent », tout en dénonçant le monde « que partageaient l’ancien captif et son lecteur. Le narrateur de l’histoire est en général celui qui raconte son épisode de captivité résultant de l’enlèvement par des pirates », son récit entrelace le fait avéré vécu et la fiction. Les modèles de ces récits proviennent du « corpus grec et latin, de Tite-Live à Plutarque » ou encore et surtout d’Héliodore d’Emèse (l’auteur des Ethiopiques) ainsi que de « la tradition biblique et patristique filtrée d’un côté par l’humanisme réformé, et de l’autre par l’enseignement des jésuites », écrit Duprat qui présente dans un tableau le «schéma de base et variantes » de l’histoire du captif.
À la différence de l’épopée homérique — référence néanmoins cruciale que l’auteure analyse ici sous l’angle du pirate, comme elle le fait pour beaucoup d’autres récits de l’antiquité (Bacchus transformant les pirates en dauphins chez Ovide) ou du Moyen Âge, comme le novelliere italien du XIVe (utilisé par Marlowe et Shakespeare), le Décaméron de Boccace, ou l’œuvre de Cervantes, afin de situer son propos – l’enlèvement ne s’effectue plus par les dieux mais par les hommes dont l’expérience ressortit souvent à la rédemption, révélant ainsi le caractère théologique de la narration. La transformation des événements en aventure se transforme ensuite en récit exemplaire moralement, religieusement, politiquement. Les récits construisant le monde barbaresque révèlent une « hybridité culturelle et religieuse », ils appartiennent à « l’univers esthétique des histoires extraordinaires » basées sur l’aventure véritable qui leur permet, même si la fiction y intervient, de rester dans la « vraisemblance ». L’auteure prend en considération, la littérature grecque et latine, italienne, française, anglaise, espagnole et portugaise (le genre portugais de l’histoire tragico-maritime) et consacre plusieurs chapitres à l’ analyse détaillée de nombreux ouvrages pour en montrer la spécificité ou les similitudes, en dégager « les effets de sens produits » par leur « structure ». Duprat étudie également l’évolution du style qui, dans le baroque français, par exemple, nouera l’univers barbaresque au roman sentimental, laissant l’artifice dominer l’authenticité et associant le divertissement à l’édification morale ou religieuse.
Le récit du captif comporte une dimension politique, « comme double négatif et pourtant exemplaire de celui du conquérant », il permet aussi de « renvoyer dos à dos l’anarchie politique et la tyrannie ». La littérature « barbaresque » anglaise, par exemple, soutient le développement de
l’« identité impérialiste » mais donne aussi naissance à « des schémas de pensée alternatifs sur l’autre », écrit Duprat qui relève par ailleurs une forme de piraterie dans les « opérations maritimes » que mènent les états dans leurs conquêtes commerciales et coloniales.
Duprat décrit le récit d’enlèvement « comme un paradigme fictionnel spécifique à l’univers de pensée qui précède les Lumières et le ‘désenchantement du monde’ » et montre comment ce « motif fictionnel utilisé depuis l’Antiquité a pu se retrouver au centre de la représentation symbolique de la circulation des gens et des biens en Méditerranée, pendant cette période décisive de son histoire qui voit le renversement progressif de l’équilibre des forces entre islam et chrétienté », l’islam étant représenté par les Maures et les Ottomans. La menace ottomane marque particulièrement les récits entre la prise de Constantinople (1453) et la bataille de Lépante (1571), cependant que les représentations du Maure dominent la littérature espagnole et se différencient de celles de l’Italie. Duprat montre le lien très intéressant – et c’est peut-être le point fort de son étude savante – entre la piraterie et l’évolution du droit qui classe le captif selon son statut social (esclave, homme libre…) et sa religion, mais avec qui se posent aussi le droit au retour, à l’héritage, le droit marital, le droit commercial avec le rachat du captif, etc., cadre dans lequel apparaît le thème de la « fiancée du pirate ». La question du retour est aussi celle « de la réinsertion possible du captif dans sa société d’origine », souligne Duprat (1), mettant en évidence la complexité juridique qu’engendre ce retour parfois inattendu.
Ce rapport au droit éclaire les liens que l’auteure établit entre le récit du captif, la sophistique et les rhéteurs romains. Rachat, évasion, mariage (avec la fille du pirate), conversion et martyre marquent la vie narrée de l’otage. Si l’arrière-plan du récit comporte toujours une dimension transcendantale, cela n’empêche pas certains d’entre eux de privilégier l’érotisme du captif (ou de la captive) séduit, sans oublier la dimension esthétique (dont fait partie une « esthétique du témoignage »). Monde familier, monde étranger et marchand, monde métaphysique forment l’espace-temps dans lequel se tissent des alliances politiques, commerciales et religieuse, car Réforme, contre-Réforme et ordres religieux sont bien présents.
Malgré l’époque et l’espace géographique dans lesquels Anne Duprat situe son étude sur une « représentation de l’Orient » et plante le décor dans lequel s’affrontent chrétienté et islam, où les ports marchands et le commerce occupent une place prépondérante, l’index ne comporte pas les termes « Arméniens, Arménie », ce que l’on regrettera tout en s’étonnant car les Arméniens, dans les ouvrages mêmes cités par l’auteure, circulent et il leur arrive parfois de détenir des rôles importants dans le processus de rédemption et de conversion. C’est le cas du « martyrologe des Plus illustres captifs » (1640) du père Dan (2), ou celui des nouvelles de Giraldi Cinzio (3), auxquels se réfère Duprat. Les marchands arméniens ne sont pas absents de la « collection Hakluyt » et La Calprenède imagine Cléopâtre prisonnière sur le bateau du roi d’Arménie. Suite aux massacres et persécutions, tant du côté Perse que Turc, les Arméniens, soutien des Chrétiens d’Occident, se sont établis dans de nombreux ports, d’Italie en Inde, les Génois ayant même surnommé la Crimée « Armenia maritima », comme l’avait noté Kéram Kévonian. Il rappelait aussi les « risques encourus sur mer en raison des courses des pirates » (4).
Cette absence ou cette invisibilité des chrétiens et des marchands arméniens trouve peut-être son explication dans le livre même de Duprat :
« Les réévaluations périodiques auxquelles procèdent les études post-coloniales sur la valeur respective de ces sources pour une représentation de l’Afrique et de l’Orient dans les lettres classiques européennes le montrent : la lecture que l’on fait de ces textes dépend elle-même de la visibilité de ces enjeux idéologiques, qui détermine à son tour le poids de réalité que l’on accorde à l’expérience racontée ».
L’enlèvement et la capture imposent un détour involontaire qui engendre le désir du retour ou sa nécessité. En quoi consiste ce retour, sinon en un retournement ? Le retour du captif n’est pas un déplacement, il procède d’un renversement de la perspective, sur le monde de l’autre et plus encore, peut-être, sur soi.
Chakè Matossian
_____
(1) Rappelons la parution récente du livre de Céline Flécheux, Revenir, qui aborde le retour sous l’angle de la philosophie et de l’art. Cf. notre compte-rendu du livre paru dans NH Hebdo du 23 mars 2023 (N° 348).
(2) Outre le personnage d’Hermifère (« arménien de nation ») il y a Govera, Duc d’Arménie dont Baudoin II, roi de Jérusalem épouse la fille. Le récit décrit minutieusement les tortures épouvantables infligées aux Arméniens, symboles du martyre chrétien.
(3) Giraldi Cinzio, Orbecche, jeune princesse perse qui épouse en secret Oronte, un jeune Arménien (tragédie).
(4) Kéram Kévonian, « Marchands arméniens au XVIIe siècle », Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 16, n°2, Avril-Juin 1975, p. 212. Sauf omission de notre part, Anne Duprat ne mentionne les Arméniens qu’une seule fois, non en tant que marchands, interprètes ou religieux, prince ou princesse, mais en tant que pirates (« pirates arméniens, albanais ou scythes ») (p. 368).