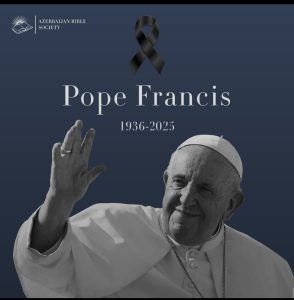Par Marc DAVO
Depuis le début du mois de mai, on observe une forte accélération du rythme des rencontres entre protagonistes du Sud-Caucase. Qu’elles aient lieu en Occident ou en Russie, ces réunions, souvent tripartites, ont manifestement le même but, arranger dans des conditions optimales les possibilités de dessiner les futures voies de communication et imaginer les moyens de les maîtriser en assignant à chacun des pays de la sous-région son rôle particulier.
Cette accélération intervient dans un contexte international marqué :
– par le regain d’activisme diplomatique de Washington dans le Sud-Caucase, lequel pourrait s’expliquer aussi comme une réponse aux récents succès diplomatiques de Pékin (médiation entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, proposition de « plan de paix » pour l’Ukraine, …). Ces succès ne pouvaient pas laisser indifférente l’administration américaine au moment où le président Biden s’apprête à solliciter un second mandat.
– par les efforts russes de desserrer l’étau des sanctions internationales qui commencent à peser sur l’économie du pays. Moscou constate aussi son incapacité à gagner la guerre en Ukraine, ce qui est de nature à menacer le régime de Vladimir Poutine, et s’efforce de mettre en place une nouvelle architecture sécuritaire dans son environnement immédiat vers le sud et le sud-est par le biais d’un pôle contre le bloc occidental.
>>> Un calendrier serré, chaque réunion poursuivant un objectif différent
Au fil du temps, deux approches contradictoires sont mises en évidence. Washington et Bruxelles s’emploient d’atteindre une certaine stabilité dans la sous-région en insistant sur la nécessité de trouver des solutions, notamment au conflit du Haut-Karabakh …. En revanche, Moscou tente de maintenir non-résolu les conflits qui surgissent ici et là. Ce faisant, il se donne le moyen d’assurer sa présence et de dicter ses conditions.
C’est sur cette base que les pourparlers s’organisent sous forme bilatérale ou à trois ou à quatre … Ces réunions ont commencé avec la rencontre Mirzoyan-Bayramov à Washington puis à Arlington, début mai, qui a duré 4 jours, sans pour autant avoir donné des résultats tangibles. Par la suite, Charles Michel, président du Conseil européen, a pris le relais pour réunir les dirigeants arménien et azéri à Bruxelles, le 14 mai. Sa déclaration équilibrée, quoi que dise l’opposition parlementaire arménienne, apporte une précision utile concernant la superficie (29 800 km2 pour l’Arménie et
86 600 km2 pour l’Azerbaïdjan) reconnue mutuellement par les protagonistes de la sous-région. Annoncée début mai, une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan est aussi organisée le 19 mai à Moscou sous l’égide du ministre Lavrov. Celui-ci en profite pour faire pression sur le gouvernement d’Erevan, dont l’action fait l’objet de mécontentements du Kremlin. En effet, Erevan est accusé de vouloir tourner le dos au « protecteur » russe.
>>> Réactions
La réaction à ces réunions et leurs résultats est diverse et variée, mais selon la ligne de partage qui caractérise les forces politiques en Arménie et en Artsakh.
La réaction la plus retentissante, puisque émotionnelle, est celle aux propos de Charles Michel à Bruxelles. David Babayan, ancien ministre des Affaires étrangères de Stepanakert, saisit l’occasion en demandant fermement que tout le monde clarifie ses positions sur l’Artsakh, à commencer, pour la première fois de la part d’un responsable artsakhiote, par Moscou. Le Parlement de Stepanakert aussi dénote son mécontentement vis-à-vis des propos de M. Michel, critique le gouvernement d’Erevan, etc.
Le parti Contrat-Civil de Nikol Pachinian accueille avec enthousiasme la déclaration de Bruxelles (14/05) qui porte sur la superficie et sa reconnaissance, …
L’opposition parlementaire, suivant les critiques de Moscou sur tout ce qui vient de l’Occident, tire à boulets rouges sur le gouvernement et les Occidentaux « qui ne font rien d’autres que des déclarations ». Ses propos proférés ne dépassent pas les arguties et les vitupérations habituelles.
Les milieux d’experts et analystes sérieux commentent différemment ces événements. Ara Papian, ancien ambassadeur au Canada, sur Radio106,5 plateforme de Modus Vivendi, préfère qu’il n’y ait pas de document signé à l’issue des pourparlers de Washington/Arlington, car “l’équilibre des forces est en défaveur de l’Arménie et en ce cas, les conclusions seraient forcément désavantageuses pour Erevan”. L’analyste Areg Kotchinian qualifie d’encourageant l’activisme de la diplomatie américaine (Azatutyun TV du 07/05). Et, d’après Tigran Grigorian (sur CivilNet), expert sur les questions concernant le Haut-Karabakh, la déclaration de Bruxelles ne reflète rien de nouveau dans le processus engagé, si ce n’est la confirmation des décisions de Prague l’an dernier.
>>> La réunion du 25 mai à Moscou
Le plus important événement en termes de conséquence à venir pour le Sud-Caucase s’est produit le 25 mai en marge du sommet de la Communauté eurasiatique à Moscou auquel participe le président azéri, sans être membre de cette instance. A Moscou, ni la réunion tripartite Poutine-Aliev-Pachinian qui n’a duré qu’une vingtaine de minutes, ni la réunion des dirigeants membres de l’organisation n’est significative autant que celle de Vladimir Poutine avec Ilham Aliev.
Rappelons que dans sa démarche visant à créer le pôle opposé à l’Occident – et le format 3+3 proposé sur les conflits sud-caucasiens en est l’illustration, ce qui signifie la mise à l’écart de l’Occident de cette sous-région – Moscou s’est allié à la Turquie d’Erdogan dont la doctrine néo-ottomane (inspirée du pan-touranisme et du pan-islamisme) l’éloigne du bloc des pays membres de l’OTAN. L’une des contreparties de ce rapprochement est l’introduction de la Turquie dans le Sud-Caucase (soutien militaire à Bakou lors de la guerre des 44 jours, déclaration de Chouchi en juin 2021, …). Ce pôle anti-Occident incorpore aussi l’Iran, même si certaines contradictions apparaissent dans les objectifs que ces trois pays à régime autoritaire poursuivent (intangibilité de la frontière irano-arménienne pour Téhéran, obtention d’un corridor – sovereign passage – par Meghri pour Ankara, …).
En fait, les présidents Poutine et Aliev, à deux, examinent les pourtours d’une coopération stratégique sur le dos de l’Arménie. Celle-ci est écartée de la voie Nord-Sud avec tous les manques à gagner pour son économie.
Dans cette nouvelle configuration, Moscou donne la priorité aux transports terrestres, considérant que la voie maritime des échanges est dominée par les pays occidentaux. Le projet de voie nord-sud, version russe, doit établir la liaison entre l’Inde et la Russie via le réseau ferroviaire iranien
et celui d’Azerbaïdjan, pays partageant une frontière avec la Russie et l’Iran. D’où la mise à disposition par les Russes d’un prêt (1,3 Md$) au profit de Téhéran en vue de la construction du chemin de fer d’Astara-Rasht (Iran).
Ilham Aliev est allé à Moscou pour négocier les modalités pratiques de la réalisation de ce projet qui fera de l’Azerbaïdjan le principal pont de cette liaison Russie-Iran/Inde et le principal bénéficiaire politique et économique de la voie Nord-Sud/version russe. On peut supposer que le président azéri a en contrepartie obtenu des concessions de la part du président russe au sujet de la liaison est-ouest (route de la soie) via Meghri. Les forces russes devraient selon le point 9 de la déclaration du 9 novembre 2020 surveiller cette voie-là. Les deux chefs d’Etat ont minimisé la question de la souveraineté arménienne sur cette partie de la voie en la reléguant à une discussion sémantique.
* * *
L’Azerbaïdjan, à n’en pas douter, fera tout pour appauvrir l’Arménie. Ecartée dans le temps du passage de l’oléoduc et du gazoduc Bakou-Turquie (via la Géorgie) dont les royalties non-négligeables auraient renfloué le budget arménien, l’Arménie fera aujourd’hui encore les frais de l’entente Moscou-Bakou en ce qui concerne la voie de communication Nord-Sud entre St-Petersbourg et Mumbai (Bombey) via l’Iran et l’Azerbaïdjan.
Seule la voie alternative Nord-Sud qui doit accéder à l’Europe orientale (à travers la mer Noire) peut être envisagée de passer par l’Arménie (et la Géorgie). Mais là, les choses trainent. Ces quelques malheureux kilomètres de route de Kajaran-Sissian qui requièrent la construction de tunnels et de ponts restent en état de projet. Et pourtant, l’Union européenne a prévu d’apporter un financement conséquent de 600 M€.
Notre analyse nous amène à la réflexion suivante. On ne tire pas de leçons des inconséquences et erreurs du passé. Un exemple au hasard : si l’armée arménienne avait tenu la région de Nakhitchevan (par où passe la voie ferrée joignant Erevan au réseau iranien) au-delà de deux mois en résistant aux attaques turco-tatares au moment de l’indépendance de la 1ère République (1918-20), l’Arménie d’aujourd’hui aurait pu se retrouver dans une meilleure position, au lieu de s’interroger sur la faisabilité d’une hypothétique voie ferrée à construire par le Syunik venant d’Iran.