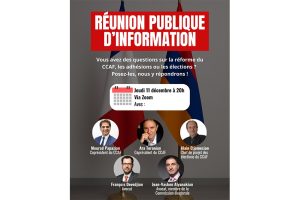François Ansermet
L’origine à venir
Ed. Odile Jacob, 2023, 202 p., 23,90€
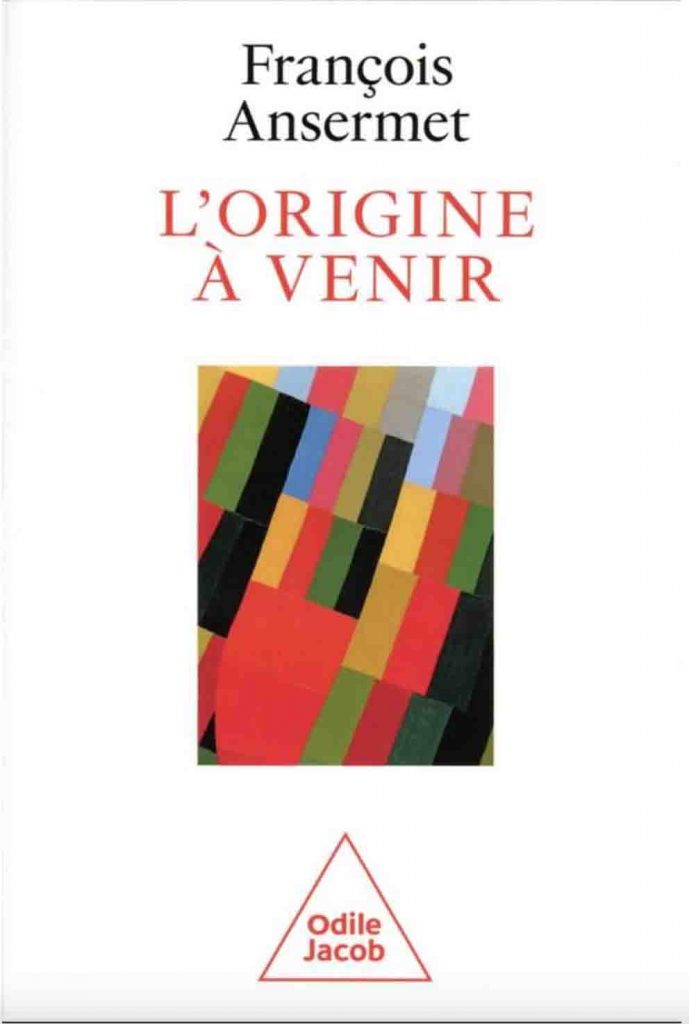
D’emblée, par le titre de son ouvrage, François Ansermet, psychanalyste, professeur honoraire à l’Université de Genève, propose au lecteur une réflexion sur la temporalité paradoxale de l’origine. Celle-ci n’est pas un point de départ mais un devenir car l’origine tient du fantasmatique, elle est, comme la mort, l’inconnu. La question de l’origine demeure sans réponse et durant notre vie nous l’inventons, la fantasmons, remplissons ce vide en lui conférant parfois un « trop plein de sens ». L’origine est marquée par le trauma de la naissance, les blessures, et prend son point de départ dans l’« amnésie infantile » qui caractérise tout humain, du fait même qu’il naît inachevé. Nous gardons des traces inaccessibles de tout ce qui a précédé la conscience du moi et même de ce qui a précédé notre naissance et jouera un rôle déterminant dans notre devenir (le désir des parents, le choix du nom, le fait que les parents ont parlé de nous avant notre naissance, etc.). La question de l’origine donne lieu à une production mythologique et narrative, elle peut engendrer l’angoisse chez certains et le psychanalyste y répondra en ouvrant un « espace d’indétermination » offrant au sujet la possibilité de se libérer de tout ce qui l’a précédé et l’enferme. Pour cela, Ansermet insiste sur le « futur antérieur » comme temporalité spécifique de l’origine. L’auteur rappelle que, selon Jacques Lacan, notre naissance énigmatique (pourquoi moi ? où étais-je avant de naître ?) provient, d’un malentendu, le leurre de l’amour des parents, le leurre de la reconstitution de l’unité dans l’acte sexuel. Freud avait quant à lui mis en évidence la lutte entre le narcissisme de l’individu (Thanatos) et l’instinct de reproduction de l’espèce (Éros), Thanatos étant non pas la mort après la vie mais le repos absolu que nous recherchons dans l’assouvissement des pulsions et qui est là avant la vie. Notre origine s’entrelace donc à la mort comme repos perturbé par la vie qui se déclenche en tant que réaction à la perturbation.
Aujourd’hui la question de l’origine s’avère bien plus complexe qu’à l’époque de Freud ou Lacan, du fait de l’évolution biotechnologique qui peut faire croire à certains individus qu’ils ont résolu la question de l’origine en créant comme ils le souhaitent un enfant dont on connaîtrait tout le parcours génétique, en d’autres termes, un nouveau-né « traçable ». Pour Ansermet l’origine ne saurait être simplement ramenée au biologique, nous sommes davantage que nos gènes et que nos empreintes épigénétiques. Certains croiront résoudre la question insoluble de l’origine par l’identité qui est tout aussi problématique, simple construction destinée à occulter la part d’inconnu qui est en chacun de nous et que l’auteur appelle « extimité ».
Outre les questions existentielles, Ansermet montre les problèmes éthiques et économiques soulevés par les nouvelles pratiques de procréation qui deviendront prédictives puisqu’elles ne nécessitent plus un homme et une femme mais bien un laboratoire, avec des donneurs et des récepteurs de spermatozoïdes et d’ovules, éventuellement congelés. Ce qui entraîne l’auteur à « imaginer que les futurs marginaux pourraient paradoxalement devenir les hétérosexuels qui deviendraient les derniers à pouvoir procréer sans assistance médicale, et donc sans un possible lien entre prédiction et procréation ! Avec le séquençage du génome, la possibilité de bilans préconceptionnels entre en jeu : déterminer les risques, miser sur les potentialités – le patrimoine génétique pourrait prendre la place des autres formes de patrimoines et entrer en jeu vers des nouveaux modes d’alliance ». Le système de santé pourrait même s’en trouver affecté, car jusqu’à présent « chacun est d’accord de payer pour tous » du fait de l’incertitude, ce qui pourrait ne plus être le cas avec la demande choisie de procréation. Les notions de père et mère sont quant à elles vouées à un changement radical et entraînent une modification de la perspective anthropologique : « un homme devenu femme, qui a conservé ses spermatozoïdes, peut procréer. Il pourrait ensuite réclamer d’être reconnu comme père en tant que femme. Une femme devenue homme pourrait de même utiliser ses ovocytes vitrifiés et demander à être reconnue comme mère, d’autant plus si elle a porté l’enfant dans l’utérus qu’elle aurait conservé malgré le changement de genre ». Ce sont donc des reconfigurations culturelles, politiques, économiques et administratives (par conséquent fiscales aussi) que produisent les biotechnologies en réalisant ce qui était jusqu’ici fantasmé (ou réalisé basiquement dans les sociétés patriarcales – dans le Caucase, notamment – par l’avortement sexo-sélectif au détriment des filles). Aussi, Ansermet demande-t-il : « Est-ce que ce qui est possible doit forcément être fait ? ». Les biotechnologies nous confrontent à la séparation entre la procréation et la sexualité, ayant des conséquences au niveau du droit. Elles répondent à un « désir d’enfant » indépendant de l’acte sexuel et du genre du ou des parents d’intention (l’ensemble des parents biologiques et d’intention pouvant réunir cinq personnes, signale Ansermet). Selon l’auteur, « les désirs sont sur le point de devenir des droits » et dès lors le désir d’enfant devient un « droit à l’enfant ». Or ce droit à l’enfant entre en contradiction avec le droit de l’enfant dont le droit à l’autodétermination ne sera plus respecté.
Les nouvelles formes de procréation sont étroitement liées aux questions de l’intersexualité découlant parfois de la discordance entre le sexe morphologique et le sexe chromosomique mais dépassant toujours le cadre du biologique pour investir le langage : « les intersexes nous obligent ainsi à revisiter tout ce que l’on pensait savoir de la sexuation, jusqu’à son point limite : celui de l’impossible articulation entre le langage et le vivant ».
Ansermet cherche la source des débats actuels sur la différence sexuelle qu’il est difficile de situer. La question, qui est celle de l’indétermination ou de l’intersexe, dépasse bien sûr les questions administratives (faut-il supprimer les cases « masculin », « féminin » ou ajouter une case « intersexe » sur les passeports, les portes des toilettes, etc.) et touche à la culture, au point de vue idéologique, politique, sur la représentation de la sexualité. Ansermet, se référant à Marie Delcourt, l’helléniste liégeoise trop souvent oubliée, rappelle le lien entre mortalité et différenciation sexuelle illustré par l’androgyne du récit d’Aristophane dans le Banquet de Platon où la fable décrit le nombril comme trace mnésique du châtiment infligé par les dieux : l’androgyne est coupé en deux, il n’est plus immortel et doit chercher sa moitié pour reconstituer l’unité perdue. Ansermet observe l’acceptation d’une indétermination sexuelle dans d’autres cultures et sur base des cas auxquels il s’est trouvé confronté, invite
à sortir d’une idée vaginale de la sexualité. Il importe de laisser au sujet le choix de son objet sexuel, bref il s’agit de « repenser ce qu’est la dif-
férence sexuelle, au-delà de tout réductionnisme anatomique ou psychique ». Ce n’est pas l’organe sexuel qui rend homme ou femme, mais il peut nous le faire croire ; certaines illusions rassurent (elles peuvent conforter l’individu et maintenir un ordre social). Nous assistons à la valorisation grandissante de l’irréductibilité de l’individu, d’un désir singulier qui tourne toujours autour du malaise (« être mal dans sa peau ») et du malentendu (ma naissance et donc, du même coup, ma mortalité). Une clinique nouvelle résulte nécessairement de ce que permet le bricolage hormonal et les biotechnologies, qui donne lieu à des interrogations et des problèmes dont Ansermet rend compte : interventions chirurgicale ou hormonales sur les enfants, réversibilité ou non de l’intervention, préservation de la fertilité… Ce qui importe au thérapeute est d’éviter les généralisations dont témoigne le vocabulaire et de s’ouvrir au contraire « à la singularité de chaque cas ». A la fin de son ouvrage, Ansermet illustre la réalité de l’indétermination dans le vivant en citant l’œuvre de l’artiste du land art, Andy Goldsworthy, faisant apparaître la limite incertaine entre la rivière et la mer pour en déduire que « la véritable œuvre, c’est le changement ». En surgit nécessairement une interrogation sur le temps menée par tous les philosophes depuis l’Antiquité, distinguant le temps chronologique (Chronos) de celui du retour (Aion), sans oublier la question de l’instant. La temporalité n’a de sens que par rapport à notre mort.
Aussi Ansermet reprend-il les rapprochements effectués par Freud et Lacan entre le sexe féminin et l’angoisse de la mort (qu’incarnerait le tableau de Courbet, L’origine du monde – rappelons ici que ce tableau n’était pas destiné à une exposition publique). L’on pourrait dès lors penser que les biotechnologies offrent une sorte d’échappatoire à cette angoisse, mais, comme l’écrit Ansermet, ce contournement par la technique et le machinique n’en révèle que d’avantage l’angoisse liée à vision médusante du sexe féminin lieu de notre apparition vouée à la disparition.
Ansermet consacre plusieurs pages à la détresse des enfants abandonnés, martyrisés, ceux qui sont placés dans les orphelinats, ceux qui ont vécu l’échec d’une « fonction de médiation » celle, symbolique, qui « traduit le cri en appel » et celle imaginaire, qui se passe dans le regard de l’Autre (et le sourire, « énigmatique », auquel Ansermet consacre quelques passages). Pour survivre l’enfant a besoin d’entrer en relation avec « un désir qui ne soit pas anonyme » qu’il pourra trouver dans l’adoption. Il y a aussi le destin des enfants, volés et retrouvés, le retour des disparus (Argentine [1]) confrontés à des temps différents : « le temps du secret, le temps de la révélation de la vérité et le temps de leur choix de retrouver leur famille biologique ». Comment « advenir » à partir d’une filiation traumatique ?
L’origine n’est pas un destin mais un devenir, ou un advenir, spirale bien plus que boucle, dans laquelle le sujet peut saisir l’inattendu, rencontrer la sérendipité et avec elle la créativité. En dernière instance, le livre de François Ansermet fait apparaître la puissance de l’imaginaire comme cela même qui se dérobe à l’emprise des biotechnologies mais assurément pas à celle de la mort.
Chakè Matossian
_____
(1) A ce sujet, voir Sévane Garibian, « Chercher les morts parmi les vivants. Donner corps aux disparus de la dictature argentine par le droit », in ANSTETT Élisabeth et DREYFUS Jean-Marc (dirs.),Cadavres impensables, cadavres impensés. Approches méthodologiques du traitement des corps dans les violences de masse et les génocides, Paris, Petra, 2012.
Le génocide des Arméniens n’aura pas épargné le massacre de milliers d’enfants mais il aura aussi laissé de nombreux orphelins, certains vendus comme esclaves, d’autres turquifiés. L’étrange destin d’un groupe d’orphelins arméniens a été étudié par Boris Adjemian dans son livre La fanfare du Négus – Les Arméniens en Ethiopie (XIXe – XXe siècle), EHESS, 2013.