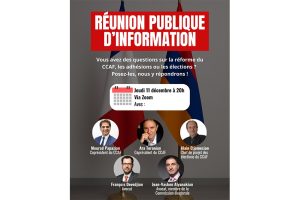Carlo Ossola
La vie simple
Paris, Les Belles Lettres, 2023, 140 p., 11,50€
Oui, notre époque est « avare » de vertus, constate Carlo Ossola (Professeur honoraire au Collège de France). Pour contrer ce repli, il nous offre un livre élégant et profond qui équivaut en quelque sorte à « marcher vers l’autre les bras ouverts ». Un livre sur les vertus, de nos jours, il faut oser. Ossola nous rappelle leur existence nécessaire pour le bénéfice de tous, en s’inspirant des Dialogues du Tasse (1544-1595) et en laissant la parole à de nombreux auteurs tant classiques que modernes. D’emblée, l’auteur nous invite à méditer cette pensée de Pascal : « La vertu d’un homme ne se doit pas mesurer par ses efforts, mais par ce qu’il fait d’ordinaire ». La vie simple n’est pas si simple, observe Ossola, car « simplifier les désirs est plus difficile que les accroître ». Le simple se rattache à la vérité, au repos, à l’écart et au retard par rapport à l’agitation qui semblent gouverner le monde par toutes les formes de divertissement et de préoccupations. Pour nous aider à penser l’exigence du retrait en ces temps anxiogènes, Ossola convoque l’ « absolutio », c’est-à-dire les vertus minimes incluant le devoir de compassion envers autrui et de perfection par rapport à soi. Il en répertorie vingt-quatre : douze « pour soi », douze « pour les autres ».
Pour soi. La bonhomie qui dépeint l’homme tolérant, tranquille et probe, un homme pouvant paraître un peu mou alors qu’il est simplement résigné et bienveillant. Dans la littérature comme au cinéma, il est souvent incarné par le personnage du médecin, celui qui connaît les hommes et ne s’illusionne guère. La discrétion touche à la prudence, au discernement : « capacité de distinguer en peu de temps, parmi les opportunités et les événements, ce qu’il y a de nuisible ou d’utile ». Elle définit également le respect des confidences reçues et la force de s’écarter du tumulte mondain. Ossola rattache la franchise à la pureté et à l’intégrité, il voit la placidité comme une fermeté tranquille, en quelque sorte connectée à une paix divine, céleste, celle que l’homme partage avec l’univers et qui devrait gouverner les gouvernants. La constance pourrait être une « grande vertu » (elle est même intrinsèque à l’application des autres vertus), elle relève du courage et de la stabilité, soutient l’amitié. Giacomo Leopardi (1798-1837) l’inclut parmi les « choses imaginaires » si essentielles à la vie. Pourtant, ajoute l’auteur du Zibaldone cité par Ossola, « si l’homme sensible les rencontrait plus souvent en ce monde, il serait moins malheureux, et si le monde courait un peu plus derrière ces chimères (abstraction faite d’une vie future), il serait beaucoup moins malheureux ». La constance frôle l’usure, elle révèle notre ancrage dans la durée, mène à une réflexion sur le temps qui renvoie immanquablement, à celle, sublime, de saint Augustin. La patience, vertu « noble », est la « capacité de ‘pâtir’ », d’assumer ; elle provient de l’héritage chrétien comme de l’héritage classique. Dans les langues romanes, rappelle Ossola, patienter « veut aussi dire savoir attendre ». Comme le temps risque de ramollir les mots et les choses, Ossola fait appel à l’ « estro », une sorte d’inspiration, une stimulation dynamisante d’origine divine engendrant la prophétie ou la poétique. Chez les Grecs, c’était aussi le nom du taon (on se souviendra que Socrate avait été comparé à cette mouche férocement acharnée). Depuis quelques années les signataires d’e-mails saluent leur destinataire par le mot « cordialement », utilisé vraisemblablement de façon machinique, oubliant le « cœur » qui en est la source. L’on se réjouira donc de découvrir chez Ossola ce en quoi consiste la cordialité « bienveillante et sereine, prévenante et paisible, la cordialité adoucit l’âpreté et est la demeure de la simplicité », c’est bien une « saillie du cœur ». Inclure l’ « obéissance » dans les vertus minimes pourrait nous déconcerter. Il ne s’agit pas ici d’être assujetti mais de « reconnaître que, pour apprendre, il faut faire confiance à la parole des maîtres », une docilité menant à la sagesse. Gilles Deleuze disait : « Tristesse des générations sans ‘maîtres’ » (1). Si la sobriété pose la question délicate de la limite, la souplesse, symbolisée par le chat, se révèle quant à elle assez ambigüe. En tant qu’agilité, la souplesse fuit parfois la franchise, mais elle ressortit à la sagesse, car ainsi que l’illustre la fable du chêne et du roseau, il vaut mieux plier que se briser,
« flectar, non frangar ». C’est dans le Paradis de Dante qu’Ossola trouve la douceur qui imprègne la mémoire d’une joie sereine car pleine d’amour (la vision de Béatrice), elle s’adresse à nous comme le rythme apaisant d’une horloge.
Douze autres vertus sont « pour les autres ». L’affabilité, contraire à l’agressivité, à l’arrogance et à la sécheresse d’esprit, contribue au développement des autres vertus essentielles aux relations humaines. Affable, c’est « être grand sans orgueil », comme l’Argide de Voltaire. Si la sympathie risque d’occulter la justice en occupant sa place (Proudhon), elle n’en demeure pas moins, aux yeux d’Ossola, une « forme sereine de connaissance du monde, de l’autre qui se trouve à côté de nous ». La loyauté ou l’engagement de la parole donnée, qui semble aujourd’hui disparue, s’oppose au réalisme : soit la foi en une cause, soit l’adaptation, où s’infiltre toujours un peu de perfidie ou de cynisme (on peut penser à la Realpolitik dont les Arméniens font les frais aujourd’hui, comme hier). Le dévouement s’incarnerait dans les personnages féminins comme Agafia Matveevna (dans l’Oblomov de Gontcharov) ou Félicité (dans Les trois contes de Flaubert, évidemment plus moqueur) ou la Vera d’Andreï Makine (La Femme qui attendait). Comme prise en main par l’informatique qui en fournit le simulacre pour nous assujettir, la prévenance, rappelle, Ossola, consiste en la sollicitude bienveillante et emplie de douceur. Vertu « centrale », la mesure « est toujours quelque chose ‘de plus’ que l’exactitude », (elle correspondrait plutôt à l’expression populaire « au pif »), elle n’attire pas (car les excès, tout comme les désirs, séduisent davantage que la modération ou les besoins) bien qu’elle soit libératrice, car écrit Ossola : « La mesure est une règle qui ne sert pas à vérifier les choses mesurables ». Le tact, empreint de pudeur est l’attention à l’autre, une sorte de « toucher de l’esprit » comme l’est aussi l’ironie, en tant que toucher piquant à la manière socratique, décrite par Léopardi « cette ironie ne fut ni dédaigneuse, ni acerbe, mais reposée et douce ». C’est elle qui exprime le mieux notre condition de « miette ridicule » face à l’univers, notre ressemblance avec le « ciron », selon les mots de Pascal. L’urbanité, opposée à la rusticité ou à la barbarie, sous-tend ce que le XVIIIe s. aimait appeler le « commerce » entre les hommes (on dirait aujourd’hui la « communication »). Il reste, comme le dénonçait Rousseau, que la frontière est bien mince entre politesse et hypocrisie. Mais, écrit Ossola, aucune vertu « ne peut être bien décrite sans le contour d’ombre du vice qui l’assiège » et sans urbanité point de société. En revanche, une société sans responsabilité est tout à fait concevable, c’est le cas de la nôtre : il n’y a plus de réponse car il n’y a pas d’écoute. On ne répond plus à et on ne répond plus de. On confond responsabilité et pouvoir, ce qui nous aide à comprendre l’horreur manifestée envers la gratitude, cette noblesse d’âme, qui « est le fardeau le plus difficile à porter », car c’est la dette impayable. Or,
la gratitude procure à celui qui la connaît une « conscience euphorique du don reçu », la reconnaissance de la dette. L’ouvrage s’achève sur la générosité, sur les « âmes généreuses de héros », les grands héros des épopées, mais aussi sur « des générosités plus sobres, imperceptibles », ou sur la fin aussi généreuse qu’inutile du héros solitaire.
La belle couverture du livre reproduit une photographie de Giuseppe Smerilli, qui a également illustré un Dante d’Alberto Manguel (2). Une fenêtre carrée percée dans un mur de pierre laisse voir un ciel bleu et une corde à linge sur laquelle sèche, suspendu par deux pinces en bois, un pan de tissu blanc. Créant toute une atmosphère, la photo de Smerilli révèle la simplicité dans cette action « ordinaire » que Pascal, grâce à Ossola, nous invite à méditer. Au reste, Pascal n’a pas dédaigné l’ordinaire. Retiré du monde, il rejette le superflu, partout : il fait lui-même son lit, il demande qu’on ôte les tapisseries du mur. Il lui faut parvenir au rien, simplifier au maximum. Mais le surplus s’agrippe : « quelque pauvre que l’on soit on laisse toujours quelque chose en mourant », dit-il (3). La vie simple n’est assurément pas la simple vie.
Chakè Matossian
_______
(1) Gilles Deleuze, à propos de Sartre, en 1964. « Il a été mon maître », in L’île déserte et autres textes, Paris, Minuit, 2002, p.109. Sartre venait de refuser le prix Nobel.
(2) Alberto Manguel – Nicola Giuseppe Smerilli, Dante – orizzonti dell’esilio / Landscapes of Exile, Con una Nota di / With a Note by Carlo Ossola, Florence, Olschki, 2022.
(3) Mme Périer, Vie de Pascal.