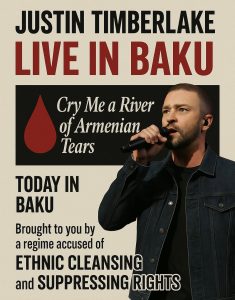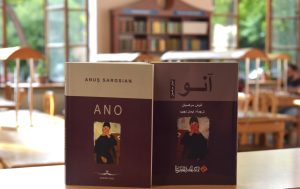Jean-Christophe Bailly
L’Apostrophe muette –
Essai sur les portraits du Fayoum
(Nouvelle édition revue et corrigée)
Éditions Macula, 2023,
154 p., 22,00€
Jean-Christophe Bailly invite le lecteur à pénétrer le monde empreint d’une grâce mystérieuse, étrangement familier, celui des « Portraits du Fayoum ». Lointains, puisqu’ils proviennent de l’Égypte à l’époque de l’Empire romain, ils sont aussi proches par leur aspect, par l’élégante simplicité avec laquelle ils capturent un présent au seuil de sa disparition. Vibrent encore en eux les traces d’une vie quotidienne dont ils diffusent l’atmosphère. Placés dans les tombeaux et donc supposés ne plus jamais être vus, les portraits du Fayoum accompagnent le corps momifié du défunt, son voyage. Ces morts, essentiellement des Grecs d’Égypte, enveloppés dans un savant tressage de bandelettes, sont des hommes et des femmes, parfois de tristes enfants, bref des gens.
Diverses pensées d’ordre philosophique et esthétique traversent l’interprétation des « portraits du Fayoum ». De par leur appartenance au rituel funéraire, ils entretiennent une relation avec le masque et avec le double dont ils se distinguent en tant que portrait individualisé – et non symbolique – réalisé durant la vie de cet être qu’ils accompagneront dans départ qu’est la mort. Chez les Égyptiens, rappelle Bailly, il n’y a pas de revenants, mais seulement des partants. Nous sommes bien sûr confrontés ici à la question du temps, au contraste entre la durée et l’éternité.
Survient également une réflexion nécessaire sur le visible et l’invisible. En tant qu’objet enfermé à jamais avec le corps momifié dans un tombeau, les portraits du Fayoum relèvent du caché. Invisibles, ils pénètrent déjà l’espace-temps auquel ils s’adressent, celui du monde invisible. Or, voilà que nous les découvrons et les exposons dans les musées, ce qui n’est pas sans créer un certain contre-sens par rapport à l’idée qui a guidé leur création. Déplacés dans l’espace, passé du dedans au dehors, de l’ombre du monde éternel à la lumière du monde matériel et non divin, ces portraits quittent aussi la dimension spirituelle pour finir là, devant nos yeux, comme tableau. En cela, ils inaugurent quelque chose comme l’histoire du portrait, ils en révèlent surtout le noyau central, à savoir le rapport originaire du portrait avec la mort ici renforcé par le milieu égyptien : « Dans cette culture où se croisent éléments populaires et éléments savants et où se développent les cultes à mystères, il était naturel de voir la préséance égyptienne jouer à plein, et d’autant plus que la mort, dans ce carrousel anxieux, joue un rôle central et est pour ainsi dire le pivot autour duquel viennent se rassembler les formes diverses et enchevêtrées des croyances ».
En regardant les portraits du Fayoum, Bailly relance la réflexion sur le visage. Nous ne connaîtrons jamais notre visage, il ne nous est donné à voir qu’à travers le regard de l’autre ou le miroir. Dès lors, les grands yeux de ces portraits du Fayoum apparaissent-ils comme les miroirs noirs, comme le dispositif spéculaire d’un iris sans lequel je n’ai pas de visage. Au contraire de la représentation égyptienne, de profil, ces visages sont tous représentés de manière frontale. S’appuyant sur les recherches de Françoise Frontisi-Ducroux, Bailly trouve dans la peinture céramique grecque la clef de la frontalité comme « stratégie ». Si la représentation de profil « triomphe » sur les flancs des vases grecs, l’apparition de la frontalité n’en devient que plus claire, elle est réservée à la figure de Gorgô, la face médusante dont le potier peintre dévie le regard afin qu’il ne pétrifie pas les autres personnages et nous regarde, nous, pour qui cette face n’est plus qu’une image : « cette face monstrueuse intervient comme un arrêt sur image au sein de la scène narrative dont elle est pourtant le foyer, et cet arrêt, qui serait arrêt de mort pour les protagonistes, se mue pour nous en sens, via la fonction cathartique de l’image ». La frontalité relève de l’apostrophe qui, ici, dans les portraits du Fayoum se fait discrète, évinçant le « je » et le « moi » pour faire advenir une indétermination, la « personne » : « le mystère de la personne qualifie le retrait et la différence de l’individu mieux que ne le fait la posture du sujet ». Silence, retrait émanent de ces portraits qui semblent exclure tout processus narratif.
En filiation directe avec l’âme, le visage se départit du reste du corps, se mobilise comme seuil entre deux mondes : « Sur une arche de temps considérable, qui court de l’Antiquité jusqu’à nous et jusqu’aux gros plans du cinéma, le visage s’en va, il ne cesse de s’en aller, d’être ce qui va du corps et du monde pour conduire l’être dans sa résidence la plus profonde et la moins abritée ». Ce qu’avaient perçu Antonin Artaud et Alberto Giacometti, ce dernier si attentif aux portraits du Fayoum.
Le sérieux de ces visages témoigne de l’anxiété incontournable liée à l’être, « un prodigieux isolement, un désarroi », dit Bailly qui, par la juste beauté de son écriture, traduit en mots le regard bouleversant de ces portraits. Plus que de traduction, il s’agit ici de « translation », car il importe de chercher des « procédures d’approche » de ces portraits, il faut « tenir compte à la fois de la tradition égyptienne qu’ils prolongent, de la tradition grecque dont ils procèdent et du ‘climat’ romain dans lequel ils voient le jour ».
Bouleversants, ces portraits le sont aussi en ce qu’ils montrent des hommes et des femmes qui n’appartiennent ni au monde des divinités, ni à celui de la royauté, somme toute des citoyens ordinaires. Une même simplicité marque les matériaux qui servent à élaborer ces portraits. Bailly les détaille pour souligner le contraste entre les moyens rudimentaires et le résultat « d’un extrême raffinement » auquel ces peintres anonymes ont pu atteindre, ils « surent faire passer sur des planches de bois le souffle de la vie qui glissait en s’éloignant autour d’eux ».
Une certaine monotonie, bienvenue, un peu envoûtante, se dégage de tous ces grands yeux dirigés vers un point qui nous échappe et nous enveloppe à la fois. Aussi, Jean-Christophe Bailly en vient-il à conférer aux « portraits du Fayoum » la qualité si difficile à définir, que les Anciens nommaient le « charme », la charis. Si les portraits du Fayoum reflètent « l’inquiétude religieuse et le dénuement », la charis qui les touche fait « comme si une énorme paix avait consenti à leur venue ». Le léger sourire énigmatique que ces portraits esquissent – presque jocondien – renforce la dimension paisible dans laquelle ils étaient destinés à demeurer.
Mutiques, ces portraits transmettent « l’air de leur temps » « qui bouge encore autour d’eux comme un simulacre » et de fait, les traits, les vêtements et bijoux rendent imaginable l’existence de tous ces êtres. En ce mutisme-même réside la force des portraits du Fayoum, car leur silence « comme un écho mat du divin » nous jette dans une dimension oraculaire. Jean-Christophe Bailly, à la suite d’Hérodote et Porphyre, cite l’oracle de Delphes dont son livre porte la marque : « je comprends les muets ; j’entends ceux qui ne parlent pas ».
Chakè MATOSSIAN