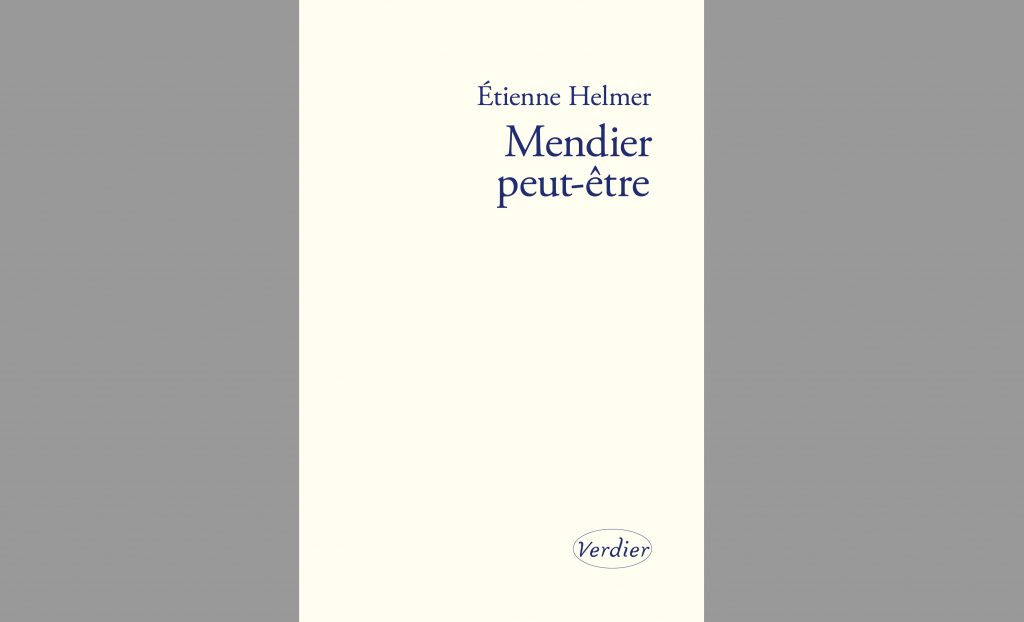
Étienne Helmer
Lagrasse, éd. Verdier,
2023, 159 p. ;
18,00€
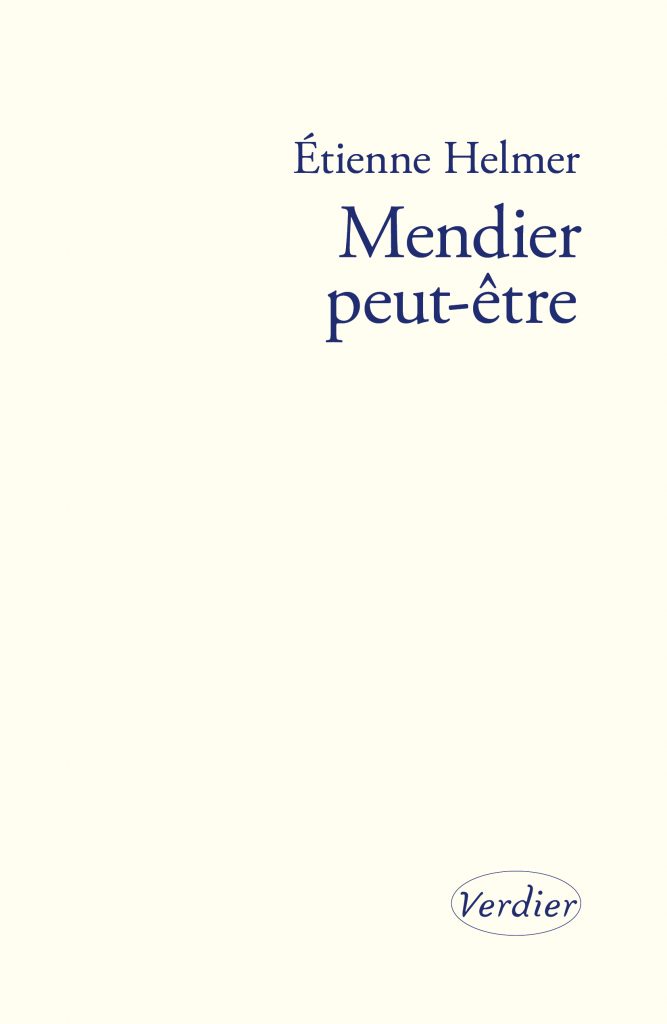
Étienne Helmer (professeur de philosophie à l’Université de Porto Rico) se range du côté de Diogène le cynique contre Aristote pour examiner la figure du mendiant non plus du point de vue du donateur, comme c’est presque toujours le cas, mais dans la perspective du mendiant. Diogène n’a pas de patrie, méprise les conventions, vit partout. On connaît la réplique célèbre du philosophe cynique à Alexandre le Grand qui s’apprête à lui donner tout ce qu’il demanderait : « ôte-toi de mon soleil ». Pour Helmer, « ce philosophe du IVe siècle avant notre ère est le seul de la tradition occidentale à avoir mis la mendicité au cœur de sa pratique philosophique, en en faisant un enjeu de transformation radicale de soi-même et de l’ensemble des rapports sociaux, économiques et politiques ». La mendicité serait une « activité économique » (quémander le nécessaire) porteuse d’une « puissance de reconfiguration des rapports humains ».
Pourquoi le mendiant est-il objet de haine, de quoi est-il la figure vivante, mourante ? C’est du point de vue philosophique qu’Etienne Helmer aborde cette question qui, pour lui, concerne « les concepts permettant de saisir les enjeux de sens que le mendiant et la mendicité soulèvent dans un monde qui les relègue à ses frontières matérielles et symboliques, tout en ne cessant de les rendre de plus en plus nombreux et visibles au centre des villes ». L’auteur se propose de dégager une « figure philosophique » du mendiant, c’est-à-dire sa forme extérieure et son sens conceptuel, « édifiée à partir de données venues des sciences humaines et sociales, d’analyses puisées dans l’histoire de la philosophie, et de représentations, littéraires, notamment ». Selon Helmer, la philosophie grecque aurait marqué le « partage des vies », faisant de la figure du mendiant « un anti-modèle d’humanité, sur le rejet duquel s’arc-boutent les principes métaphysiques, politiques et éthiques de la vie bonne ou réussie, individuelle ou collective ». Il propose ici de voir le monde depuis la perspective du mendiant afin de « jeter une lumière critique sur les fondements conceptuels admis de l’éthique et de la politique, et en suggérer de nouveaux », ces derniers concernant la représentation de « nos besoins » et celle du « vivre-ensemble » (heureusement, cette notion copieusement utilisée de nos jours et supposée être consensuelle, pacifique et sympa, n’apparaît qu’une seule fois).
A la différence de ceux qui traitent le mendiant comme un enfant ou un vieillard dépourvu de raison, Helmer veut voir en lui un être rationnel qui pense à sa vie. Sous la construction négative de la figure du mendiant qu’il a élaborée, Aristote aurait en fait visé Diogène le cynique dont il refuse la proposition d’autosuffisance basée sur la mendicité comme moyen d’y parvenir. Diogène en tant que « homme sans », privé de cité, est donc l’inverse de l’homme comme animal politique prôné par Aristote, il incarne la transgression associée à la sauvagerie animale.
Depuis l’Antiquité le mendiant se définit de façon privative, c’est l’homme « sans ». Mais ce qui était négatif du point de vue de la conception aristotélicienne de la cité ne l’est pas chez les cyniques pour qui « l’autosuffisance morale ne consisterait pas à adhérer aux valeurs collectives qui, sous couvert de justice, ne sont jamais qu’à l’avantage de quelques-uns : elle consisterait au contraire à s’en affranchir au nom de la liberté ».
Helmer traite les questions telles que « Donner ou ne pas donner ?», « que donner ? », le mendiant doit-il être assigné aux besoins élémentaires ? ne peut-il avoir des envies d’autre chose qui ne sont pas des choses, comme des paroles, de la reconnaissance ? Lorsque le donateur privilégie le don de biens plutôt que d’argent, n’est-il pas en train d’infantiliser le mendiant en décidant à sa place sous prétexte d’éviter l’achat d’alcool ou de drogue, ou de préserver l’intégrité et la sécurité de l’espace public qui coûtent cher à la collectivité ? Le donateur s’attribue ainsi à lui seul la rationalité, rejetant l’homme « sans » hors du monde « commun ». Or, la communauté des hommes n’a pas de dehors et « tout se joue en elle », souligne Helmer en se fondant sur l’éthique de Kant et son idée politique de la justice. Selon le philosophe de Königsberg, il y a une « obligation de bienfaisance » en vue de pallier « l’injustice générale des hommes » : on ne donne pas, on rend. Ce qui n’empêche pas Kant de déprécier aussi le mendiant à qui il reproche de se mettre dans la dépendance. Helmer remarque l’absence du mendiant dans les théories de Peter Singer et de William MacAskill, philosophes utilitaristes, qui prônent « l’altruisme efficace » fondé sur le calcul du « ratio » des associations caritatives donnant lieu à un classement de celles-ci en fonction de leur efficacité (seul compte le nombre de vies sauvées). Refusant d’aborder la figure du mendiant sous l’angle de la « sous-culture », Helmer la regarde sous celui de « forme de vie », nécessairement plurielle, dynamique, polarisée, (on peut penser à François Jacob, la vie se faisant dans le hasard et la nécessité). Enfin, Helmer pose la question de savoir s’il y a une « mutilation » de la forme dans la vie du mendiant. Cette figure fait surgir ce que nous ne voulons pas voir, la vulnérabilité inhérente à la vie et avec laquelle toute forme de vie doit composer.
Limitant son analyse à l’Occident, Helmer perçoit le mendiant comme l’homme des « seuils », des intersections, qu’il occupe de manière active et inventive afin d’obtenir l’aumône : langage verbal, corporel, vestimentaire. Ces interactions dans la réalité sociale qu’est l’espace créent une ambiance et donnent forme à cet espace. Occupant un non lieu, le mendiant doit revêtir une apparence conforme à son statut, il doit être visible, repérable en tant que mendiant, mais non choquant. L’écrivain Albert Cossery (1913-2008) avait magnifiquement traité le sujet dans une nouvelle opposant deux maîtres de mendicité dans les bas-fonds du Caire, l’un prônant le dénuement pour éveiller la pitié et le dégoût craintif (école classique), l’autre les beaux vêtements pour attirer la sympathie (nouvelle école).
Que l’espace soit stratégique, la lutte des « places » entre mendiants (déjà racontée par Homère) le montre bien et cette « place », peut, comme Diogène le cynique l’avait concrétisé en se servant « de tout lieu pour tout » (manger, dormir, assouvir ses pulsions…) faire exploser la dichotomie dedans-dehors, son fondement politique. Ainsi, selon Helmer, le mendiant serait le seul « animal vraiment politique parce qu’il défait le partage spatial du monde : il le dé-partage, il le rend commun, ou du moins invite-t-il à le penser comme tel ». Du côté de l’autorité politique, la rue n’est plus un lieu de rencontre et de socialisation mais essentiellement un lieu de circulation. Helmer, après d’autres, note qu’une bonne part du mobilier urbain a été conçu pour rendre la rue inhabitable.
La représentation du temps n’échappe pas à la secousse de celle de l’espace et Helmer repère dans la vie du mendiant une « temporalité alternative », intéressante dans une société rendue ubiquitaire et accélérée par la technologie. Il convoque le terme de « contre-temps » pour exprimer non seulement que le mendiant est à la traîne du cours normal des choses mais qu’il renverse de surcroît l’idée dominante du temps, laquelle s’avère intrinsèquement liée à la valorisation du travail. Comme le mendiant ne travaille pas, il est hors de la production, hors des échanges, hors du futur, hors de la modernité, ce qui ne signifie pas une absence de rythme dans son quotidien. L’attente définit sa manière d’habiter le temps (comme les mendiants de Beckett) et l’attente ne peut occulter ce qui de la mort s’anime en elle. Cette attente n’exclut pas le mendiant du travail car, en réalité, « si l’on mesure l’activité ou l’effort à la quantité d’énergie dépensée plutôt qu’à la richesse produite, le mendiant est, à n’en pas douter, un hyper-actif » ; il dépense énormément d’énergie pour se protéger et pour trouver des stratégies, des postures, des mises en scène, des narratifs, permettant de recevoir plus de dons. Le temps du mendiant tire sa force de l’inertie, il déstabilise en cela « l’édifice de la modernité ». C’est le temps pour soi illustré par l’anecdote déjà citée de Diogène se contentant du soleil et renvoyant Alexandre avec son offre mirobolante. Le philosophe cynique refuse la voracité acquisitrice et prône un « appétit capable de se contenter de ce qui se présente » (comme la chaleur bienfaisante du soleil). Le monde n’est plus « un trésor à conquérir mais une totalité dont le cynique est membre », il restaure la communauté brisée par la séparation entre dedans et dehors, violence fondatrice de l’accaparement. Ainsi que Rousseau, absent du livre, l’énonçait si bien dans l’Origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne.»
Si, par le choix de son sujet, le livre de Helmer prétend perturber le système consumériste, capitaliste et industriel, il apparaît toutefois en accord avec les nouveaux mots d’ordre idéologiques autour de la « sobriété » (« collective », « nécessaire », etc.), diffusés par divers canaux (colloques, débats…) qui enjoignent la jeunesse et les classes moyennes à réduire la consommation, à se contenter de peu, bref à vivre comme des pauvres car ils le sont déjà devenus ou sont en train de s’appauvrir (voir la croissance des chiffres des Restos du cœur).
Selon nous, la sobriété ne concernera jamais les élites financières, elle habituera par le biais d’une servitude volontaire le plus grand nombre à vivre pauvrement en trouvant cela juste. Diogène était mendiant, il exigeait l’ascèse, se faisant acteur de lui-même afin de maîtriser ses besoins, les ramenant à peu de choses pour mieux s’approcher des dieux qui, eux, n’ont besoin de rien. Et cela ne métamorphose pas les mendiants en philosophes heureux sous le soleil. Au reste, Helmer le reconnaît, les mendiants de nos rues ne ressemblent en rien à Diogène, mais cela ne l’empêche pas de vouloir « faire du peu la mesure d’une vie individuelle et collective pacifiée ». Selon Helmer, les personnages de fictions mis en scène par Cossery et Coetzee ainsi que Diogène, signalent l’unification du commun.
L’on remarquera que l’auteur n’aborde jamais la mendicité chez les religieux (les ordres mendiants), ni la figure de la mendiante, dont le corps et par conséquent la façon de se déplacer dans l’espace public et de se le représenter, exigent des stratégies de mendicité très différentes de celles de l’homme. C’était pourtant à une fillette habillée d’une jolie robe rouge qu’Albert Cossery, rappelons-le, avait confié la mise en pratique des théories de la nouvelle école de mendicité dans les rues du Caire.
Chakè Matossian
© 2025 Tous droits réservés