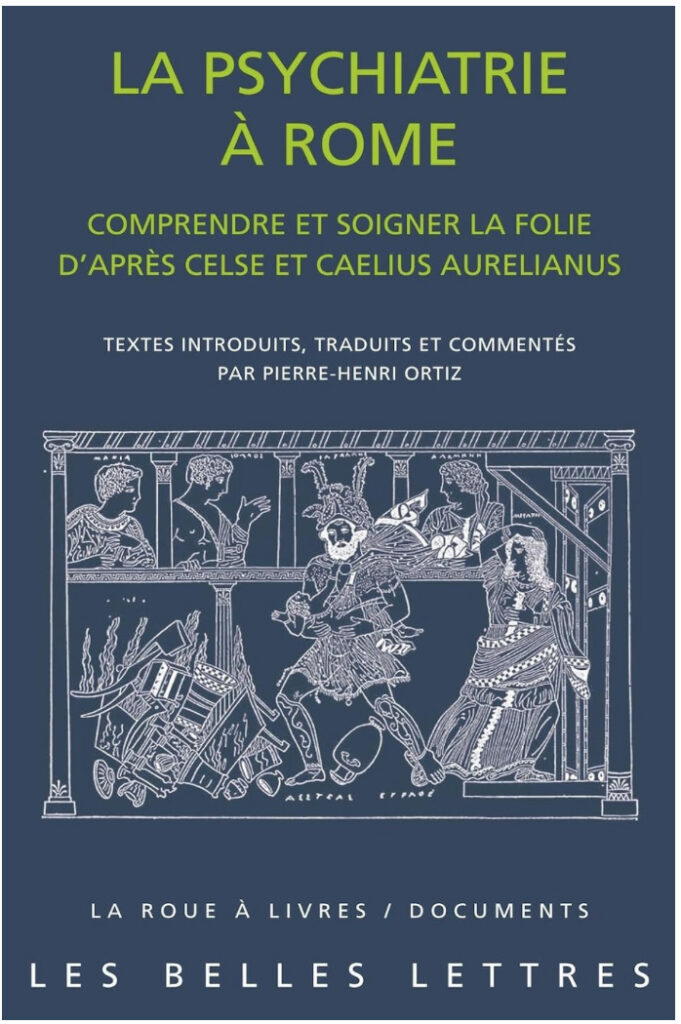
(Introduction, traductions et commentaires)
(comprendre et soigner la folie d’après Celse et Caelius Aurelianus)
Paris, Les Belles Lettres, 2024,
306 p., 25,00€
Pierre-Henri Ortiz introduit, traduit et commente des textes de deux auteurs majeurs de la médecine antique afin de montrer la naissance d’une discipline qui appréhende la « folie » comme maladie somatique et non plus comme « maladie de l’âme », expression qui n’est pas sans rappeler les beaux travaux menés par Jackie Pigeaud et souvent convoqués par l’auteur. La folie comme maladie susceptible de recevoir un traitement corporel fait selon Ortiz la spécificité de la psychiatrie à Rome.
L’appréhension de la folie, sa ou ses définitions, s’inscrivent, comme l’avait bien montré Michel Foucault, dans une vision de la société et, de fait, Ortiz ne manque pas de rappeler combien le sens juridique romain de la démence interfère dans la définition médicale de la folie. Dès l’époque de Aulus Cornelius Celsus (Celse), au Ier s., trois genres de maladie mentale se trouvent répertoriés : manie, phrénite, mélancolie. La manie comme aliénation pure, la phrénite comme aliénation dans le corps, la mélancolie comme aliénation par les émotions. Si le domaine médical évolue, le legs d’Hippocrate demeure cependant influent de même que la tradition archaïque, comme en témoigne le maintien des notions issues du Corpus hippocratique. Notions médicales dont l’auteur examine l’étymologie, l’évolution, l’appartenance aux champs juridique, tragique, poétique, philosophique.
Relativement à l’origine des termes, la phrénite, tire son nom d’une notion obscure, « phrènes », pour signifier une affection de la pensée, maladie foudroyante, caractérisée par des gestes des mains (les doigts saisissent des peluches de laine) et accompagnée de fièvre . Être en « manie », c’est être fou, avoir le jugement troublé, ce que les latins traduisent par « furor ». La manie, par métaphore, désigne « tous ceux qui transgressent les lois de la raison, les conventions sociales ou les ordres souverains », et ce terme ressortit aux domaines philosophique, juridique, politique. Ortiz attribue à Asclépiade (IIe s. av. notre ère), « le fondateur de la médecine gréco-romaine » (1), la première définition de la manie par rapport à la phrénite. La manie se caractérise par une aliénation, un désordre émotionnel, durable et sans fièvre, ce qui la distingue de la phrénite, fulgurante, fiévreuse et fatale.
La mélancolie – (étymologiquement rattachée à la bile noire, en accord avec le célèbre modèle humoral d’Hippocrate postulant les quatre humeurs et les quatre tempéraments) – se révèle plus tardive en tant que notion médicale. Un déplacement s’opère, en ce que chez les Grecs le mélancolique a rapport au divin, alors que chez les Romains la dimension juridique domine. Quoi qu’il en soit, il existerait une complexion mélancolique susceptible de favoriser certains troubles, notamment des troubles de la représentation qui prédisposent le mélancolique à la divination (le fameux traité aristotélicien Problème XXX associera la mélancolie au génie, ce qui entraînera une valorisation de ce tempérament durant des siècles dans la culture occidentale [2]). Du point de vue médical, « à l’époque hellénistique ou romaine », la mélancolie se définit par un état « dominé par la crainte et la tristesse », avec une localisation des signes somatiques dans le ventre (d’où les traitements purgatifs, laxatifs, diurétiques). Certains médecins y voient une forme de manie (état maniaco-dépressif), d’autres différencient les deux maux et considèrent la mélancolie comme une conscience qui souffre d’elle-même. L’on voit aussitôt les difficultés que soulèvent les tentatives de classification et, comme l’écrit Ortiz, « la ‘psychiatrie’ naît simultanément comme classification et comme pratique ».
L’auteur ne manque pas de souligner les idées contradictoires défendues par les médecins, l’ambiguïté des notions, les batailles d’école, les controverses entre « dogmatisme, empirisme, pneumatisme et méthodisme ».
À l’importance des découvertes anatomiques (Hérophile et Érasistrate), s’ajoute l’influence de la pharmacologie, de la rhétorique, et de la philosophie. Notamment celle de l’atomisme (le quasi invisible, les corpuscules qui circule dans les fluides du corps) que Ortiz repère chez Asclépiade figure importante de l’école méthodiste dont le représentant majeur sera Caelius Aurelianus. Les textes de ce dernier « offrent le plus de profondeur historique », ils « exposent la médecine méthodiste à son plus haut degré de maturité », comme le montrent le lexique et la traduction présentés dans le livre. L’on remarque par exemple la richesse des termes qui servent à qualifier le « pouls », ou le tournant qui est réalisé lorsque le terme
« mens » (pensée) prend le pas sur celui de
« anima » (âme). Caelius recourt également à la philosophie stoïcienne en distinguant les causes externes et les causes intrinsèques, logique qui « soutient la foi dans l’action humaine et renforce ainsi les prétentions de la médecine ». Les considérations spatiales
dégagées par Ortiz se révèlent très intéressantes : le médecin considère la maladie comme un déplacement sur une pente (un déclin), la malade penche et chute. Le mouvement plus ou moins rapide peut être cyclique, atteindre une crise, parvenir à la rémission. Le point de vue atomiste persiste dès lors que la santé consiste en la bonne circulation des corpuscules et la maladie en l’obstruction de leurs flux.
Depuis les traités hippocratiques, le délire apparaît également comme signe dans les descriptions d’autres maladies notées par Ortiz : l’épilepsie, la léthargie (contraire de la phrénite), l’hydrophobie.
L’auteur achève son essai introductif en rappelant que le succès du méthodisme n’a pas empêché les théories hippocratiques de conserver leur influence avec, notamment, les œuvres d’Arétée de Cappadoce, Rufus d’Éphèse et Galien. En outre, parallèlement aux théories médicales, une pratique familiale s’est développée grâce aux « collections pharmacologiques » et à leur divulgation. C’est enfin tout un environnement qui se dégage : pour rétablir la santé, le médecin tient compte de l’entourage du malade, de son lieu de réclusion. Des conseils sur le bien-être, la décoration, la lumière, la douceur des textiles sont prodigués. Ortiz répertorie les différents types de soins (saignées, diurétiques, purgatifs, narcotiques), il rappelle l’importance accordée à la diététique, au jeûne, aux massages et aux frictions, aux exercices de gymnastique et à ceux de l’esprit (lecture, récitation, discussion, jeux de calcul). Ce qui n’empêche pas certains de recourir à la violence. D’autres préfèreront la musique, le théâtre ou la philosophie. Le travail d’Ortiz nous montre que la médecine a beau vouloir
« répondre efficacement à des réalités pathologiques » propres à son époque et avec de nouveaux moyens, elle reste aussi, toujours et nécessairement, l’héritière d’un « imaginaire médical ».
Chakè MATOSSIAN
_______
(1) Sur les traductions en arménien d’Asclépiade et des textes médicaux grecs, voir : Jacques Jouanna et Jean-Pierre Mahé, « Une anthologie médicale arménienne et ses parallèles grecs », in: Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, N. 2, 2004, pp. 549-598; dans la première partie de l’article, J.-P. Mahé écrit : « les textes d’Asclépiade nous ont été transmis dans un florilège arménien de médecine grecque », que l’auteur détaille ensuite. Mis en ligne sur https://www.persee.fr
(2) On ne peut que renvoyer le lecteur à l’introduction de Jackie Pigeaud. Cf. Aristote, L’Homme de génie et la mélancolie. Problème XXX, Traduction, présentation et notes de J. P. Paris, Editions Rivages, 1988.