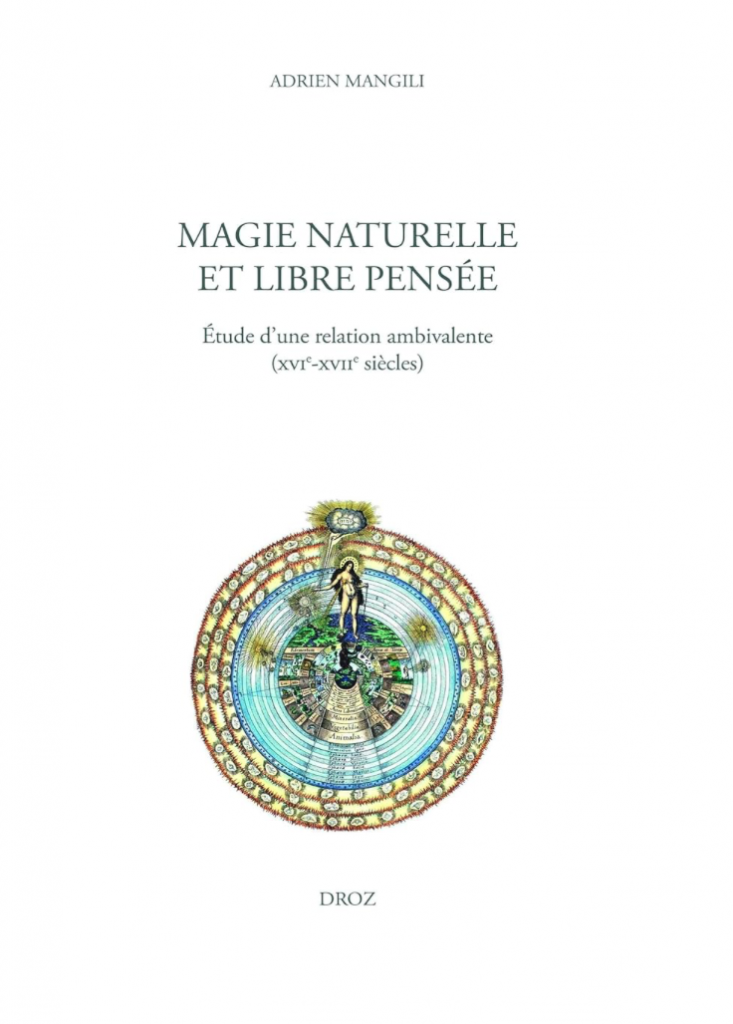
Genève, Droz, 2025,
533 p., 39,00€
Attirant l’attention sur les risques de l’anachronisme lexical, Adrien Mangili définit dans son livre volumineux et érudit (il s’agit de la publication de sa thèse universitaire) ce que sont le mage, la magie naturelle, l’occulte à l’époque qu’il a choisie. Examinant de près de très nombreux écrits, Mangili s’intéresse à la réception de la magie naturelle et à son évolution qui va de sa résurgence avec la redécouverte de l’Antiquité et des textes des philosophes grecs (Platon, Aristote, les atomistes, les stoïciens, Hermès, seront convoqués) à son déclin avec la montée en puissance de la libre pensée, celle des « esprits forts » animés par la raison scientifique.
Refusant une lecture binaire de l’histoire, Mangili tient à faire comprendre que des courants de pensée qui semblent contradictoires peuvent se croiser, que des arguments peuvent passer d’un champ à l’autre, que la magie naturelle a pu stimuler l’esprit scientifique, encourager des théories physiques qui renforceront le matérialisme au détriment du pouvoir divin ou mener à des pensées religieuses considérées comme hérétiques par le catholicisme.
La magie naturelle a des origines multiples et se trouve définie diversement (elle est « malléable ») ; elle couvre plusieurs disciplines (médecine, philosophie, mathématiques, techniques, pharmacologie, minéralogie, astrologie, rhétorique, études des langues) et se trouve d’abord associée à la sagesse. Le parcours de Mangili commence avec le platonisme et l’hermétisme qui associent le mage au sage, il s’oriente aussi vers l’œuvre d’Aristote où de nombreux mages puisent « la doctrine de la forme et de la matière », sans oublier la théorie des quatre tempéraments. Le cadre chrétien et scolastique apparaîtra au moyen-âge, ce qui n’empêchera pas le succès des magies naturelles «en raison de la rencontre de l’Occident latin et de la science gréco-arabe ». La magie fleurit à la Renaissance tant à Padoue qu’à Florence ou ailleurs jusqu’au XVIIe siècle, avec de très nombreux auteurs dont Mangili dresse le portrait et contextualise l’œuvre (Marsile Ficin, Pic de la Mirandole, Pietro Pomponazzi, Paracelse, della Porta, Agrippa, Fludd, Kircher, Gaffarel et Niceron, etc.. .) . L’hermétisme et le platonisme qui dominent à la Renaissance se mêleront parfois aux visées mystiques (Marsile Ficin et le Corpus hermeticum) sans empêcher l’advenue, au fil des décennies de courants empiristes (Niceron) et mécanistes. La magie naturelle recourt à une rhétorique, elle se fonde sur les similitudes et l’analogie, sur les correspondances : « Est magique ce qui échappe à la compréhension que l’on se fait des ‘lois’ de la nature, ce qui émerveille et étonne ». Parmi les explications des phénomènes ou les actions effectuées sur la matière, l’auteur repère : le microcosme et le macrocosme, les talismans, les onguents qui guérissent de loin, la communication à distance, les miroirs, les lois de la sympathie (attraction)et de l’antipathie (répulsion) (du chou pour la vigne, du coq pour le lion). Et c’est ce « merveilleux » que le scientifique cherchera alors à naturaliser en apportant un regard objectif pour se libérer de la réaction subjective qui nous rend passif, car l’étonnement devant l’incompréhensible ne laisse pas de nous subjuguer. Cependant, comme l’affirme Mangili, la frontière entre magie naturelle et science s’avère parfois poreuse. Il constate que les opérations des mages ont mené à des recherches (en optique, par ex.) ayant permis des réalisations d’instruments scientifiques (le télescope). Ces découvertes donnent lieu à des courants de pensée tantôt optimistes, prométhéens, tantôt sceptiques. Le microscope et le télescope, par exemple, nous révèlent des mondes qui nous étaient jusque-là invisibles ; ils nous permettent de percer l’insoupçonné, l’inconnu et de les expliquer (optimisme) tout en nous révélant notre petitesse, notre ignorance : nous ne savons donc rien et tout nous dépasse (scepticisme, comme chez Montaigne). Il ressort des deux courants que l’homme ne détient plus une place centrale dans le monde, il est détrôné au bénéfice d’une vision relativiste de la nature. En somme, « il s’agit d’humilier les prétentions humaines, sans renoncer à agir dans le monde ».
Comment les esprits forts et la magie naturelle peuvent-ils se rencontrer alors qu’ils semblent s’opposer ? De fait, les esprits forts ne manqueront pas de dénoncer la « supercherie » dans la magie naturelle, ils riront d’elle. La moquerie deviendra une arme, celle de Naudé, par exemple, contre ceux qui, à l’instar des Rose-Croix, font passer des fables pour des vérités (telle l’idée du microcosme). C’est aussi l’arme de Cyrano dénonçant l’imposture magique des talismans : « outre le fait qu’ils provoquent immanquablement le rire sardonique des esprits forts, ils exercent selon ces derniers une véritable fascination sur les esprits superstitieux ».
Pourtant, quelque chose rattache la libre-pensée à la magie naturelle. La filiation qui les relie s’éclaire par l’esprit d’insoumission et par la duplicité discursive qui les caractérisent toutes deux. La libre pensée se sert de la rhétorique de la magie naturelle pour s’opposer au pouvoir catholique déjà concurrencé par d’autres croyances comme la sorcellerie, la magie, la kabbale et surtout la Réforme. La lutte est féroce car l’Église catholique a fixé des limites très rigides à ne pas dépasser, ceux qui les ont enfreintes y ont laissé la vie, comme fait bien de le rappeler Mangili.
C’est avec la Réforme et avec Bacon (dont l’empirisme n’empêche toutefois pas la recherches des « formes cachées de la nature ») que s’établit la séparation entre la réalité physique et le surnaturel, engendrant un désenchantement du monde et un affaiblissement de l’orthodoxie catholique « puisque les démons, le Diable et les miracles subissent de biais les attaques que les esprits forts prétendent réserver à la magie ». La magie naturelle aura nourri l’irréligion non seulement sur un plan épistémologique mais aussi sur un plan rhétorique. Les esprits forts font de l’analogie un « outil de dissimulation », ils tiennent compte du pouvoir de suggestion de la langue et de la puissance des représentations sur les esprits : « Lorsqu’ils dénoncent comme les plus sévères démonologues les superstitions de la magie, les esprits forts trouvent un moyen détourné, mais acceptable, d’élargir aux pratiques religieuses ce que leur discours prétend réserver aux cérémonies magiques. Il n’y a qu’un pas entre l’imposture des mages et celles des prophètes que seule l’autorité inquisitoriale interdit de franchir explicitement. »
C’est ainsi que le désenchantement du monde consécutif au déclin de la magie naturelle sera compensé par la fiction qui prend désormais en charge le pouvoir d’enchanter. Invalidées par la science, les fictions qui alimentaient les croyances et les superstitions rejoignent alors le domaine de l’esthétique, elles produisent des récits merveilleux, satisfont le plaisir des fables. La fiction, espace de liberté, fait alors du lecteur un complice dans la diffusion des idées qui contribueront à changer comme magiquement et naturellement le monde réel.
Le livre d’Adrien Mangili concerne assurément le XVIe et le XVIIe siècles, mais rien n’empêche le lecteur d’aujourd’hui d’y trouver des lentilles optiques pour observer notre contemporanéité. Nous assistons à la mainmise croissante des orthodoxies religieuses et des idéologies sur la science, nous acceptons d’être fascinés par « la magie de notre technologie » dont nous ignorons les actions secrètes sur nos vies. Éblouis par les écrans, nouveaux miroirs magiques, nous nous réjouissons de la communication instantanée à distance… Et plus que tout, le livre de Mangili nous alerte sur la misère d’une pensée binaire.
Chakè MATOSSIAN ■
© 2025 Tous droits réservés