
Le samedi 15 mars, le Centre d’arménien occidental Haratch à Erevan a accueilli l’événement Figures Littéraires II, dédié à l’écrivain et romancier arménien de la diaspora Garo Poladian. À cette occasion, l’écrivaine, poétesse et pédagogue Nora Baroudjian a livré une conférence détaillée, en centrant son propos sur les romans de Poladian Les Garçons de l’Orient et Je renonce à l’arménité et leur interprétation.
Au nom de notre cercle littéraire, nous exprimons notre gratitude à Nora Paroutchian pour sa présentation riche et captivante. Nous lui sommes reconnaissants d’avoir répondu à notre invitation et d’avoir accepté de participer à cet événement.
Ci-dessous, nous reproduisons l’intégralité de son propos.
Vahan K. Manjikian
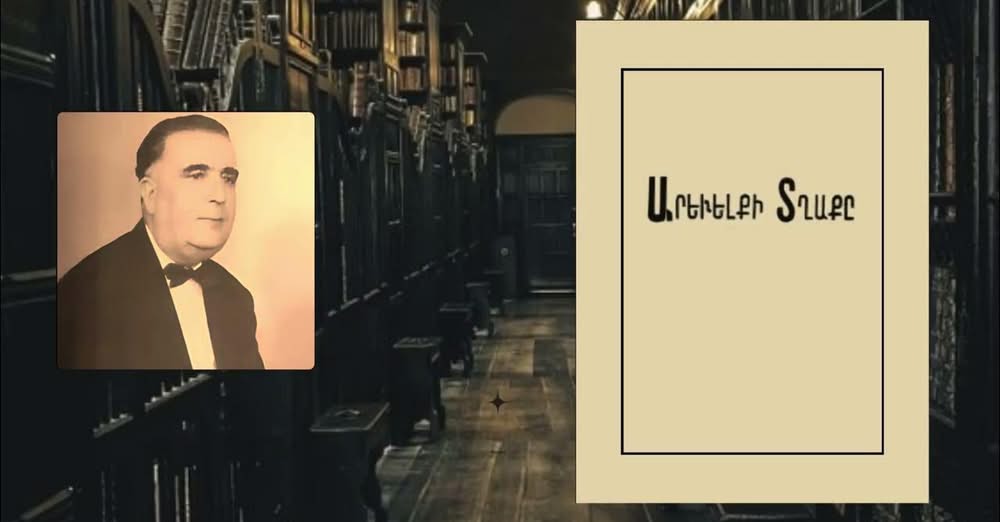
***
Appartenant à la première génération post-Génocide d’écrivains franco-arméniens du XXe siècle, Garabed Poladian occupe une place essentielle dans notre littérature et, par conséquent, dans notre vie. Cette génération, ayant vécu l’horreur du Génocide, réfugiée puis établie en France, a mené un combat acharné pour survivre, pour exister. Elle a entamé une quête d’identité, soulevé des doutes, s’est interrogée, et c’est dans cette effervescence que s’est forgée la pensée intellectuelle arménienne de l’époque, incarnée notamment par les écrivains, parmi lesquels Garabed Poladian.
Ainsi, nous pouvons affirmer que Poladian et ses contemporains appartiennent à cette génération qui, survivante, a rassemblé les fragments d’un présent brisé pour les transfigurer en littérature. Un talent spirituel avant d’être littéraire. Je tiens particulièrement à évoquer deux de ses romans : Les Garçons de l’Orient, publié à Paris en 1946 et Je renonce à l’arménité, paru également à Paris en 1949. Dans ces œuvres, Garabed Poladian se fait idéologue : il pose des questions et, à travers le déroulement des récits, suggère des réponses.
Ces romans se déploient comme des films. Beledian compare les épisodes d’aventures des Garçons de l’Orient à des opéras baroques. Il y a une tension, une rupture, l’inévitabilité de cette rupture, puis l’angoisse et la souffrance qu’elle engendre. Enfin, comme résolution de cette tension, le « retour forcé » du personnage vers le giron de son identité.
La réflexion idéologique occupe une place majeure, souvent sous forme de dialogues, où des situations et des idées très proches des nôtres aujourd’hui émergent. Par exemple, dans Je renonce à l’arménité, des jeunes se réunissent, tiennent une assemblée pour « faire quelque chose », trouver une issue à leur condition déchue. Les idées s’échangent, le débat s’enflamme, et finalement, cette réunion dégénère en conflit. On y lit : « Nous ne parlons pas la même langue, nous sommes étrangers les uns aux autres, nous ne comprenons plus, nous ne vénérons plus les mêmes dieux. … Lâches, honte, honte, peuple répugnant, nous sommes devenus un peuple de prostituées. »
Je souhaite concentrer mon propos sur quelques points fondamentaux qui, selon moi, constituent l’essence de ces romans.
Le choc des cultures dissout les pensées : l’Orient y apparaît comme un mirage, transformé, mythifié et embelli. Dans Les Garçons de l’Orient, il est écrit : « L’Orient, l’Orient, rude et sévère en apparence, mais pur. J’en suis le fils. » Un Orient idéalisé est dépeint dans ces romans, car pour eux, la patrie est l’Orient, le berceau du soleil, tandis que « l’Occident brûlait dans le brasier de ses terribles péchés, on voyait les fumées de l’Occident et surtout sa poussière. … En Orient, nous savions pourquoi nous mourions, mais en Occident, pour qui, pourquoi ? Nous l’ignorons. »
Ainsi, cette confrontation entre l’Orient et l’Occident reflète leur état d’esprit et résulte sans doute du choc de deux cultures distinctes.
L’Arménien est exilé, arraché à sa patrie, et à cette époque, il se trouve dans la condition d’un réfugié dans ce nouveau pays. Un pays avancé, développé, où il doit composer avec son passé. Comment doit-il se comporter face à ses blessures encore ouvertes ? Que faire de ces blessures ? Les regarder ou les ignorer ? Doit-il s’y enfoncer ou fuir, tenter de s’en libérer ? Doit-il choisir la vengeance ou abandonner le passé, le laisser irrésolu ?
Dans ces romans, les héros semblent confrontés à un choix et hésitent. Les œuvres de Poladian sont l’expression de cette hésitation. Doit-il sombrer dans la mémoire et vivre dans la vengeance, ou oublier et vivre comme les autres, ordinairement ? Ces questions sont présentes, et pourtant, dans Je renonce à l’arménité, le héros principal, Babken, traîne avec lui une malle où qu’il aille, quoiqu’il fasse, qu’importe le nom qu’il porte – parce qu’il a changé de nom pour adopter une autre identité. Malgré le reniement des siens, sa malle reste avec lui, et cette malle, c’est son passé.
C’est l’un des aspects les plus marquants de l’œuvre romanesque de Poladian. Il l’aborde avec pudeur et franchise, reflétant l’attitude des hommes arméniens de son époque envers les femmes. Dans ses romans, le narrateur devient le miroir de cette attitude. Les femmes sont soit des mères, des sœurs, soit des prostituées. Rien entre les deux. La mère est le fil qui le relie à son identité tandis que la prostituée n’apparaît qu’au moment du reniement. La liberté sexuelle constitue le parti de ceux qui veulent oublier le passé.
Le personnage principal des Garçons de l’Orient, Yervand, ne peut se libérer de ses complexes sexuels tandis que Sourène, pour qui « la dent de lait est déjà tombée », cherche à se délester du poids du passé et vit une sexualité libre. Mais bien sûr, uniquement avec des prostituées étrangères. Car pour Poladian, la jeune fille arménienne, cette sainte et pure Arménienne, n’est pas un être sexué.
Il y a un problème avec la sexualité : elle est impure, le lit est sale, bestiale. C’est ainsi que Marie, la prostituée des Garçons de l’Orient se suicide lorsqu’elle découvre qu’elle est en réalité une Arménienne nommée Astghik. Elle se suicide pour faire vivre Astghik, la pure Arménienne : pour que vive la pure Arménienne, la prostituée étrangère doit mourir.
Mais il y a aussi le personnage de Sirarpi. Elle incarne le mélange de la mère et de la sœur arméniennes : mère, sœur, dévouement, Sirarpi. Elle est amoureuse de Babken, elle est ouverte à l’expérience charnelle. Sirarpi est la figure de la femme arménienne réconciliée avec sa sexualité. C’est elle qui séduit Babken en faisant le premier pas. Elle est la jeune Arménienne consciente de son époque, maîtresse d’elle-même, qui sait élever l’amour au-dessus des difficultés matérielles de Babken. Ainsi, elle a pour Babguén la tendresse d’une sœur, et pour sa mère malade, la sollicitude d’une fille. Et cette femme, Sirarpi, que Babken compare à sa mère en disant : « Elles sont de la même étoffe, du même sang – même sensibilité, même dévouement, une créature sincère et noble », cette noble créature, Sirarpi, est brutalement rejetée par Babken lorsque sa mère meurt. Ainsi, celle qui le rattachait à son identité, à son arménité, à son passé et à ses blessures. Avec la mort de sa mère, le dernier lien à son arménité, Babken, délibérément, en luttant contre lui-même, s’éloigne de Sirarpi, le double de sa mère. Et là commence le reniement de l’arménité, et cette femme arménienne forte, Sirarpi, en devient une victime. Par sa féminité et sa liberté sexuelle, elle me rappelle les figures féminines des Preux de Sassoun.
Babken, bien qu’ayant renié son passé, traîne toujours avec lui la malle contenant ce passé. Comment est-il possible que celui qui renie son passé continue à le porter ? Nous percevons ici une certaine contradiction. En réalité, cet homme fuit la tragédie, la condition de victime et de martyr. Dans Je renonce à l’arménité, il dit : « Commençait à s’enraciner en moi cette conviction que la cause de tous mes malheurs était mon arménité. »
Mais le destin ne lui permet pas de rompre complètement avec son passé, car Babken ignore que son amour avec Sirarpi a donné naissance à un nouveau Babken : un jeune homme conscient, déterminé, idéaliste, convaincu et actif. Ce dernier décide de rentrer en Arménie et de s’y établir. Ainsi, contrairement à son père, le jeune Babken renforce ses liens avec la patrie.
Dans L’Occident, revue littéraire et nationale publiée à Paris entre 1945 et 1952, à laquelle Poladian a collaboré, nous trouvons des sections consacrées à la fois aux questions arméniennes et aux mouvements intellectuels internationaux. Cette génération aspire à élever le national à l’universel, à universaliser le national.
Dans Je renonce à l’arménité, une rencontre fortuite est décrite entre Babken et un poète français. Ce poète, figure de la Résistance française contre l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, lit à Babken un de ses nouveaux poèmes, intitulé Liberté. Le roman inclut une traduction partielle de ce poème, révélant qu’il s’agit de Paul Éluard et de son célèbre poème Liberté, écrit en 1942 pendant la Résistance. Dans le premier volume des Entretiens de Poladian, nous retrouvons une interview de Paul Éluard, où ce poème est également présenté. Là, Poladian dit au poète français : « Savez-vous que ce poème a été particulièrement aimé des Arméniens car ils ont vraiment su apprécier la liberté ? » Et comme preuve, il cite quelques vers du poème Liberté de Mickaël Nalbandian.
Le roman s’achève sur l’engagement du poète français pour la liberté, porteur d’une idéologie universaliste. De ce personnage engagé émerge une idée salvatrice : les divisions humaines ne sont pas raciales, mais mentales et idéologiques.
Le roman présente aussi un poète arménien. À son sujet, l’un des héros, Sourène, dit : « C’est un écrivain authentique et profond. » Mais le poète arménien n’est pas actif, il est symbolique, « seulement emporté par les mots », tandis que le poète français prend les armes pour libérer son pays.
« Nous sommes malades, l’arménité est maladive, nous ne sommes pas des gens à l’esprit sain », dit-on dans Les Garçons de l’Orient. « Nous sommes tous malades. » Dans cette lutte, dans cette réflexion sur la fuite de la condition de martyr et le dégoût du milieu arménien, nous retrouvons l’écho de nos efforts et préoccupations contemporains dans les romans de Poladian. Cet état d’esprit maladif, dans lequel nous avons replongé après la guerre de quarante-quatre jours en Artsakh, nous a une fois de plus blessés en tant que nation.
Dans les romans, ce discours de dégoût envers l’arménité, de désillusion et de désespoir, correspond malheureusement entièrement à notre état d’esprit actuel. Nos âmes meurtries, en dehors du champ de bataille et de la revendication, peinent aujourd’hui à créer. L’état d’esprit maladif tourmente à nouveau l’Arménien.
Ainsi, fuir cet état d’esprit pourrait signifier une fois de plus s’éloigner, se détourner de l’étranger, s’aliéner, se transformer ou vouloir se transformer. MAIS il y a la « malle ». Cette malle que Babken traînait comme un cercueil, cette malle où étaient conservés son passé, ses souvenirs, qu’il ouvrait dans la solitude et devant laquelle il souffrait, affrontant seul son oppression, ne permettant à personne de s’en approcher – cette même malle existe aujourd’hui, nous l’avons aussi, nous la portons avec nous. Quoi que nous fassions, qui que nous soyons, où que nous allions, dans quelque condition que nous soyons, la malle est avec nous. Elle contient des saintetés. Mais avec une différence : aujourd’hui, la malle n’est plus secrète, ce n’est plus un passé à oublier et à cacher, comme celle de Babken. Aujourd’hui, notre malle est ouverte, capable de se remplir de nouvelles valeurs et de se montrer à tous. Et il y a un effort pour réaliser cette exposition puisque les jeunes propriétaires de la malle se sont libérés de la mentalité du martyr.
Poladian est optimiste quant à la résolution de la question identitaire. Ses héros et figures qui s’éloignent de l’arménité y reviennent, mais ce retour ne constitue pas toujours une solution définitive. Babken échoue dans sa vie et sombre dans la folie, finissant interné. Marie, qui était en réalité l’Arménienne Astghik, se suicide pour faire vivre l’Arménienne en elle.
Poladian, à travers les résolutions de ses romans, transforme les aliénés en rédempteurs de la nation. Sa solution est le retour car il est impossible de devenir autre… il y a la « malle ».
***
Pour conclure, je veux souligner une réalité amère. Aussi difficile qu’ait été le combat de cette génération – psychologiquement et physiquement –, elle a pu créer une littérature, avoir des écrivains, produire et former un lectorat littéraire. Aujourd’hui, la communauté arménienne de France souffre de son absence. Présenter la littérature en arménien occidental, c’est peu de le dire, est un défi.
Voilà…
■