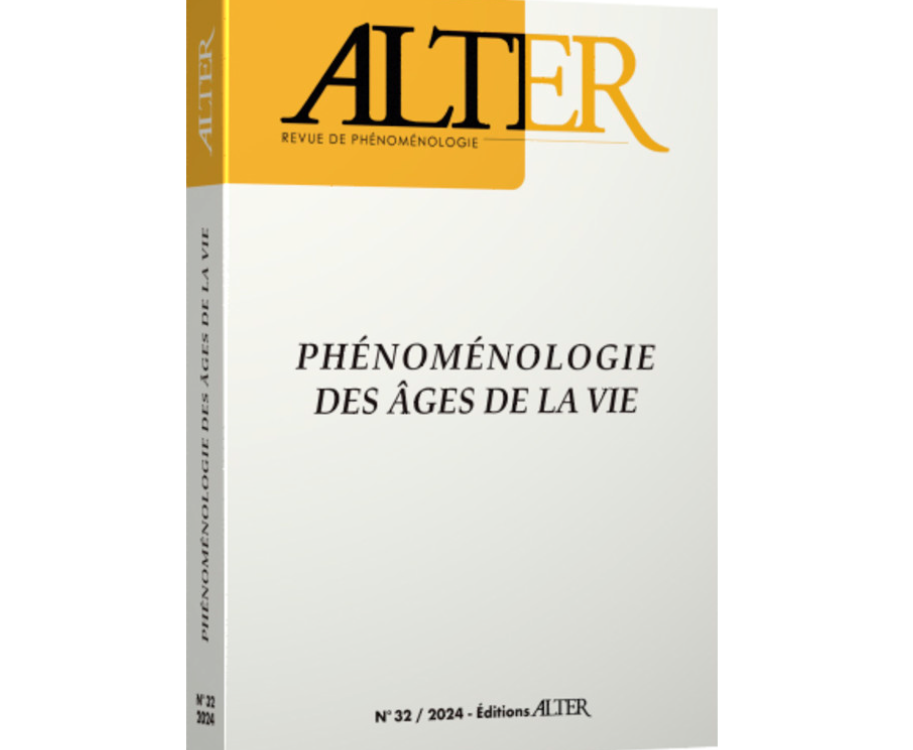
Éditions Alter, 2024,
45 p., 27,00€
La revue Alter –destinée en priorité aux phénoménologues – consacre un numéro aux « âges de la vie » du point de vue phénoménologique. Les références majeures de cette branche essentielle de la philosophie sont Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty sur qui les auteurs du volume s’appuient dans leurs contributions. Lorsqu’ils proposent et développent des théories nouvelles, les philosophes créent des concepts pour les exprimer. D’où la difficulté de la philosophie et celle de la lecture des analyses proposées ici qui recourent bien évidemment au vocabulaire de la phénoménologie (comme Dasein, épochè ou réduction phénoménologique, etc.). L’approche phénoménologique a également marqué une branche de la psychiatrie, la Daseinanalyse, avec Ludwig Binswanger et Medard Boss, notamment. En France, son plus important représentant aura été Arthur Tatossian (1929-1995), qui « fait partie des rares psychopathologues de langue française à avoir développé avec ampleur et continuité une perspective phénoménologique dans le champ de la psychiatrie » (1). Dans son article consacré à « l’âge d’Alzheimer », Claire-Line Mechkat se réfère aux travaux de Jean Vion Dury et Jeanine Chamond qui ont suivi « la voie ouverte par Arthur Tatossian ». Sa perspective permet de voir autrement que sous l’angle purement médical les personnes atteintes de troubles cognitifs. Si les comportements de ces personnes peuvent paraître bizarres, ils font pourtant sens, comme le montre l’auteure (2). Ce qui a changé c’est le sens de soi dans un contexte. La personne ne se retire pas dans ‘son monde’ comme on le croit à tort, elle reste dépendante de son environnement phénoménal : pour elle, ce n’est plus le discours qui compte mais la voix, ce n’est pas l’espace euclidien qui est saisi mais l’ambiance. Il y a un brouillage entre le « vivre » (conscience panoramique) et le « se vivre » (conscience réflexive). Le Dasein (l’être-là) ne disparaît pas, il s’estompe et son « estompement » peut être subitement interrompu, dans les moments critiques, par des instants fulgurants d’une ressaisie de soi, ce qui révèle combien le Dasein est toujours un Mitsein (un être avec), que résiste en lui le monde interhumain originaire, la « Wirheit » (le ‘nous’, la ‘nostrité’).
Ainsi que l’écrivent Marion Bernard et Natalie Depraz dans l’introduction de l’ouvrage, il peut sembler paradoxal d’aborder les âges du point de vue phénoménologique puisque l’ego transcendantal, chez Husserl, se prévaut d’une « forme de présent omni-temporel, sans naissance, sans mort, autrement dit sans âge ». Mais l’intentionnalité est projection dans le temps et dans un monde : « nous sommes liés les uns aux autres selon nos âges et notre capacité à nous projeter dans le temps », à quoi s’ajoute bien sûr la conscience de notre mortalité. L’on constate le rôle imparti à l’intersubjectivité que Claudia Serban prend en considération, lorsqu’elle examine ce qu’il en est de « l’enchaînement génératif » chez Husserl en opérant un rapprochement avec la conception du temps chez Levinas. Pour ce dernier, le temps se rattache à l’Autre, à l’extériorité, il n’y a pas de temps avant la rencontre avec l’autre : le temps intersubjectif est originaire : ce sont les autres qui m’ouvrent un avenir. La lecture du dernier Husserl tend à montrer que le passé génératif est au-delà de la mémoire individuelle et « repose sur l’entrelacement intersubjectif des mémoires et des témoignages ». Nous nous identifions moins à nos parents qu’à une « génération », pense Jean-Claude Gens qui cerne cette notion pour montrer la tension entre l’appartenance à une tradition et la critique de celle-ci, tension qui ouvre la voie à une vie qui nous est propre. C’est à la crise anti-générative de l’adolescence que s’intéresse pour sa part Natalie Depraz en voulant esquisser une « phénoménologie de l’adolescence » en dehors du critère de la puberté biologiquement connoté.
Avant cela il nous faut d’abord naître et Clarisse Picard pose l’existence de « la mère phénoménologique » attentive à toutes les étapes de l’enfantement depuis l’intentionnalité pulsionnelle (nécessairement intersubjective) à la naissance de l’enfant qui est, selon elle, « donation à soi de la mère et de l’enfant ». Elle établit une correspondance entre chaque moment vécu de l’enfantement et ceux de la méditation phénoménologique développée par Husserl, ce qui l’entraîne à affirmer que « l’enfantement est le paradigme de la philosophie elle-même en son geste inaugural ». L’enfantement peut être reporté (en fonction de la loi française de bioéthique de 2021 relative à la préservation de la fertilité), car désormais la technique biomédicale permet à la femme d’échapper à la temporalité naturelle du corps, comme le remarque Irlande Saurin. Le temps immanent du corps se distingue de celui de la projection dans le futur, l’âge acquiert une signification existentielle et non plus physiologique. C’est au petit enfant que s’intéresse Jonathan Chesnel, qui décrit, sous forme de récit, en voulant éviter l’ « adultomorphisme », le « développement de la relation à autrui et à l’extériorité », de la naissance à l’âge de quinze mois. Casimir Lejeune choisit quant à lui la voie husserlienne contre celle défendue par Agamben pour réfléchir à l’enfance dans le rapport à l’expérience phénoménologique à laquelle l’enfant, lui, n’a pas accès puisque le langage lui fait défaut (et donc la représentation de soi). L’enfance réside à l’arrière-plan de l’ego transcendantal, elle est bien une « dimension de l’existence qui continue de produire ses effets tout au long de la vie », mais n’a pas accès au transcendantal qui « désigne à la fois une attitude du philosophe méditant, et la sphère subjective conquise dans cette attitude au moyen de la réduction phénoménologique ».
Merleau-Ponty s’est intéressé à l’enfance comme le montre Xinqu Wendy Zhu dont l’analyse porte sur le paradoxe suivant : nous considérons l’enfant «comme sous-développé tout en l’idéalisant », notamment par sa créativité et son rapport à la vérité. Reprenant les travaux de Georges-Henri Luquet sur les dessins d’enfants, Merleau-Ponty s’en différencie en écartant le critère du réalisme intellectuel (la maîtrise de la perspective ou point de vue supérieur de l’adulte) pour le remplacer par la notion plus objective et neutre de « réalisme affectif ». Celui-ci procède d’une représentation spatio-temporelle spécifique (simultanéité des points de vue) révélant l’immersion de l’enfant dans un monde qui ne l’a pas encore totalement façonné. Pour cela son dessin touche à la réalité de la chose tandis que celui de l’adulte la représente selon un point de vue conventionnel. A rebours, certains artistes ont voulu, non pas imiter l’enfant mais réorganiser des expériences pour, comme le dit Matisse, cité par l’auteure « voir toutes choses comme s’il les voyait pour la première fois ». Cette contribution renforce l’idée défendue, dans le domaine de la théorie de l’art, par un Michael Baxandall (L’œil du Quattrocento) ou d’un Hubert Damisch quant au lien entre l’application de la perspective et le pouvoir de domination.
Dupraz aborde la vieillesse en soulignant qu’il aura fallu attendre le livre de Simone de Beauvoir, La vieillesse, pour que la question soit abordée sous l’angle phénoménologique et à la lumière d’une vision genrée que la philosophe trouve (comme Merleau-Ponty à sa suite) dans le livre d’Helen Deutsch Psychology of women. Girlhood de 1944.
Dans un champ plus directement politique, partant d’une photographie connue, Marion Bernard critique les réflexions de Hannah Arendt sur les événements de Little Rock (1957) liés à la déségrégation scolaire aux Etats-Unis. Accrochée au modèle romain du pater familias, Arendt déplace, pour mieux l’occulter, la question raciale pour en faire une question générationnelle. Arendt déproprie les adolescents de tout accès au politique, elle en fait des enfants victimes des parents qui les exposent. Cela lui permet de ne pas distinguer les « enfants » blancs des noirs, de culpabiliser les parents, principalement les mères noires dans la peau desquelles elle prétend se couler.
Annabelle Dufourcq scrute finement le piège de l’oppression qu’est le « gaslighting structurel » (faire douter l’autre de sa mémoire, de son jugement et de ses perceptions). L’opprimé participe de son oppression, c’est ce en quoi consiste le « savoir viscéral » que Dufourcq éclaire par la notion de « phantome » (présente chez Husserl et Merleau-Ponty) : sujet et objet ne se distinguent plus. Il y a ainsi deux réalités : l’une « instituée par le régime d’oppression », symbolique, c’est-à-dire le langage et, l’autre, le « savoir viscéral » qui, à l’arrière- plan du symbolique, se définirait comme « une réalité naissante, des ébauches de perceptions objectivantes qui n’arrivent pas à se fixer ». Du sein même du symbolique, c’est au savoir viscéral que recourt l’opprimé, à l’instar des poétesses romantiques marginalisées que Dufourcq prend pour exemple. Nous pourrions assurément appliquer son analyse au domaine de la politique internationale où bon nombre d’états totalitaires recourent au « gaslighting » à travers leurs programmes scolaires, leurs discours et leur softpower (l’Azerbaïdjan, parmi d’autres).
Ce numéro de Alter contient également des varia (parmi les articles, celui d’Eric Pommier consacré à une lecture critique du réalisme de Sartre, prend appui sur la phénoménologie de Jan Patočka philosophe tchèque dont Marc Richir n’a cessé de rappeler l’importance). Le volume présente de surcroît des traductions en français de textes de Husserl provenant des « Archives Husserl » établies à l’Université catholique de Louvain (KU Leuven) (3). On pourra notamment y découvrir une réflexion du philosophe sur l’expérience de la nature : « Si j’étais une méduse, aurais-je déjà une expérience de la nature ? ».
Chakè MATOSSIAN ■
———
(1) Michel Wawrzyniak, dans https://shs.cairn.info/quarante-six-commentaires-de-textes-en-clinique–9782100702145-page-79?lang=fr
(2) L’auteure fait également référence à Tatossian dans son article de 2001 signé Claire-Line Mouchet, « Comprendre la maladie d’Alzheimer : une approche du sensible ».
Frontières, 13(2), 39–43. https://doi.org/10.7202/1074455ar
© 2025 Tous droits réservés