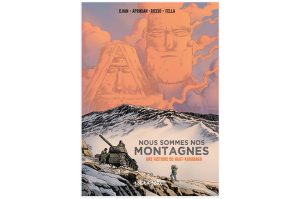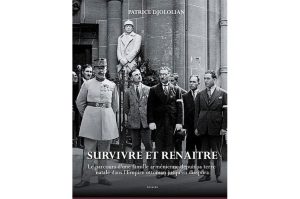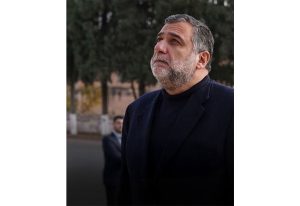Les accords conclus à Washington, le 8 août, entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ainsi que ceux signés séparément entre chacune de ces républiques et les États-Unis, comportent de nombreuses dimensions.
Il est peut-être encore trop tôt pour en mesurer toute la portée. Certains de ces textes n’énoncent que des principes généraux, d’autres manquent de détails pour permettre un jugement définitif. Néanmoins, quelques observations préliminaires peuvent aider à mieux saisir la signification de ces accords et leur importance.
Je ne propose pas ici une analyse exhaustive de l’ensemble des questions couvertes par ces documents. Mes remarques porteront principalement sur leur importance pour l’Arménie et sur la place qu’ils occupent dans les relations internationales.
Par ailleurs, je limiterai volontairement ce commentaire à l’impact de ces accords pour l’Arménie, laissant à d’autres le soin de se pencher, pour l’instant, sur leur signification pour l’Azerbaïdjan.
Enfin, bien que le district de Meghri en Arménie — carrefour de la future route de transit — puisse être considéré comme l’une des portions de territoire les plus stratégiques au monde, je réserverai ce point à une analyse ultérieure. De nombreux collègues, plus spécialisés que moi sur ce sujet, sauront approfondir cette dimension.
I. Méthodologie
- Indépendamment du parrainage de ces accords, l’essentiel est qu’Erevan et Bakou ont réaffirmé leur attachement à des principes déjà proclamés par le passé. La différence, cette fois, réside dans le fait que ces engagements sont issus d’un processus bilatéral, né de la logique interne des dirigeants respectifs.
- Un aspect notable et remarquable des textes signés à Washington est que l’essentiel avait été négocié avant la venue des dirigeants dans la capitale américaine, dans le cadre de pourparlers directs entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Si diplomates européens et américains ont contribué aux premières ébauches, les versions suivantes, ainsi que d’autres points sensibles, ont été travaillés par les deux parties elles-mêmes, à différents niveaux et parfois dans la plus grande discrétion. Ces échanges bilatéraux se sont révélés plus productifs que plus de vingt années de médiation internationale.
Ces accords représentent donc un pas significatif dans la bonne direction, tant sur le fond que dans la méthode employée. Leur véritable portée dépendra surtout de la capacité et de la volonté des deux capitales de poursuivre ce dialogue, car les relations interétatiques, comme toute relation, exigent un suivi constant, de la vigilance et de la souplesse.
- Il est essentiel de ne pas isoler un élément des accords, au risque d’en donner une lecture politique ou idéologique, plutôt que stratégique et analytique. Ces documents ne constituent qu’une étape — importante certes — dans un conflit marqué par deux constantes : le changement et les surprises. Se cramponner à une interprétation figée, c’est refuser de voir les opportunités et les défis qu’ils ouvrent.
- Il aurait été préférable que les textes soient signés dans un cadre strictement bilatéral, sans l’ombre d’une grande puissance tirant profit de son rôle. Les États-Unis n’avaient, de toute façon, aucun moyen de forcer les parties à se rendre à Washington ni à accepter les concessions souhaitées par l’administration Trump. Chaque partie avait ses propres raisons d’accepter l’invitation américaine.
- Dans ce contexte, une question se pose : pourquoi l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont-ils accepté de laisser à une puissance tierce, en l’occurrence les États-Unis, le mérite de ces avancées ? Ce choix équivaut, de facto, à écarter Moscou. L’Arménie y a vu une réponse ultime à l’échec russe à honorer ses engagements bilatéraux et multilatéraux depuis la guerre de 2020. Pour Bakou, la motivation résidait sans doute dans la recherche d’une reconnaissance occidentale pour le président Aliev et son régime, ainsi que dans la nécessité d’obtenir un soutien américain aux investissements énergétiques.
- Le sommet de Washington a replacé le processus de paix sur la scène internationale, mais en laissant de côté l’Europe, la Russie et d’autres acteurs. Les États-Unis ont agi seuls, rompant avec la tradition de formats multilatéraux, même si dominés par une seule puissance.
- Difficile de dire si cette exclusivité sera un atout ou un frein pour la suite. Les accords de Dayton, imposés par Washington dans les Balkans, montrent qu’une pression unilatérale peut se révéler plus efficace qu’une médiation collective. Mais contrairement à la Bosnie, aucune force coercitive n’a été mobilisée dans le cas arméno-azerbaïdjanais.
Les médiateurs peuvent être utiles, mais ils sont souvent impuissants ou peu disposés à exercer une pression sérieuse, et, s’il s’agit de grandes puissances, les médiateurs utiliseront toujours leur statut dans le cadre de leurs stratégies contre leurs rivaux ou antagonistes, tout en cherchant à tirer quelque chose de l’accord, compliquant les étapes ultérieures au lieu de les faciliter.
- Le processus menant au 8 août a été facilité, sinon rendu possible, comme l’a signalé Gaïdz Minassian, éminent analyste franco-arménien, par deux capitales importantes : Ankara a contribué à modérer Bakou ces derniers mois ; et Paris a fourni un soutien diplomatique à l’Arménie à un moment critique.
Fournir un tel soutien devrait être, en fait, le rôle des puissances voisines et des grandes puissances.
- Les accords laissent néanmoins de côté des questions essentielles : le sort des prisonniers arméniens détenus à Bakou, ou la préservation du patrimoine culturel arménien menacé. Ces sujets devront être abordés ultérieurement, lorsque le climat de méfiance, de peur et de haine se sera suffisamment apaisé pour permettre un dialogue de confiance.
II. Les intérêts de l’Arménie
Une façon d’évaluer l’ensemble des accords est d’examiner dans quelle mesure ils répondent aux principaux défis auxquels l’Arménie est confrontée.
- On peut soutenir que ces textes renforcent la préservation de la souveraineté de l’Arménie et la garantie de son intégrité territoriale. L’Azerbaïdjan a réaffirmé son engagement à respecter ces principes sur la base de la déclaration d’Almaty de 1991 — un objectif poursuivi de longue date par Erevan, mais jusque-là refusé par Bakou.
- Ces accords écartent également la menace d’une offensive militaire azerbaïdjanaise dans le sud de l’Arménie visant à obtenir un couloir de transit à travers Meghri entre l’Azerbaïdjan continental et l’exclave du Nakhitchevan. Cette menace pesait depuis longtemps sur la population et inquiétait aussi d’éventuels investisseurs. Dans ces conditions, le fait que Bakou ait accepté de réaffirmer le principe du non-recours à la force pour régler les différends restants avec l’Arménie ne saurait être balayé d’un revers de main.
- Dans l’évaluation de ces accords, il faut rappeler que les options de l’Arménie sont limitées. Même à l’époque de sa victoire lors de la première guerre du Karabakh, ses choix n’étaient pas entre le « bien » et le « mal », mais entre le « mauvais » et le « pire ».
- Les citoyens arméniens — et ceux qui s’inquiètent pour leur avenir — ont de bonnes raisons aujourd’hui pour respirer un peu mieux. Ces textes réduisent une menace majeure pesant sur leur sécurité. Ils ouvrent aussi la perspective d’un avenir moins incertain, avec moins d’angoisse quant au sort des jeunes mobilisés. L’espoir d’un avenir pacifique est une condition essentielle pour rétablir une relation constructive entre société et État, et pour renforcer la démocratie comme l’harmonie sociale.
- La signature de ces accords constitue également un test pour l’opposition en Arménie. Celle-ci soutient depuis longtemps que la politique du gouvernement Pachinian mène inévitablement à une nouvelle guerre et à l’autodestruction. Elle interprète chaque décision de l’exécutif de manière à justifier son rejet absolu de la ligne actuelle — parfois pour des raisons fondées, mais le plus souvent par opportunisme politique. Ce comportement pourrait être considéré comme « normal » dans un contexte classique d’opposition, mais la situation arménienne n’a rien de normal. La question est désormais de savoir si ces forces politiques sauront reconnaître les avancées positives dans les relations arméno-azerbaïdjanaises, au lieu de rester focalisées exclusivement sur leur objectif de renverser Pachinian.
On ne peut se préoccuper de l’intégrité territoriale et de la sécurité de l’Arménie tout en ignorant les aspects positifs de l’accord de paix initial et de l’engagement renouvelé de l’Azerbaïdjan à renoncer à la force dans ses différends avec Erevan.
Aucun texte ne garantit à lui seul la paix et la sécurité. Mais refuser de voir dans ces accords une avancée revient à nourrir une prophétie autoréalisatrice de conflit permanent.
- Indéniablement, ces arrangements accroissent l’importance stratégique de l’Arménie, jusqu’ici tenue à l’écart des grands axes de transit du Caucase du Sud.
III. Quatre enjeux majeurs
En ce qui concerne les points soulevés par Bakou comme obstacles à la signature définitive de l’accord de paix — contrairement au simple « paraphe » intervenu à Washington — plusieurs questions restent en suspens :
- Premièrement, la question difficile d’une route de transit pour les citoyens azerbaïdjanais et les marchandises allant de l’Azerbaïdjan vers son exclave de Nakhitchevan en passant par Meghri : une nouvelle formule a été acceptée, celle d’un bail à une entité américaine qui fonctionnerait sous les droits territoriaux souverains et le contrôle arméniens. J’aborderai plus tard les implications de cet arrangement pour l’intérêt stratégique des puissances régionales et autres.
Le point principal ici est que l’arrangement manque de toute spécificité ; il est difficile de savoir à ce stade comment les principes généraux seront traduits en pratique. Cela dépendra de la législation que l’Assemblée nationale arménienne devra adopter sur le sujet ; et des négociations qui doivent maintenant commencer entre l’Arménie et les États-Unis, avec une contribution certaine de l’Azerbaïdjan, possiblement de la Turquie, et des actions ou de l’inaction de la Russie et de l’Iran.
Il est significatif, comme l’a suggéré Gaïdz Minassian, que le texte ne fasse plus référence à la question du transport dans le sud comme un « corridor », ce qui avait soulevé des craintes et préoccupations inutiles.
- Le second point de friction est la demande répétée de Bakou de voir l’Arménie modifier sa Constitution afin d’en supprimer tout élément pouvant être interprété comme une revendication territoriale.
Dans ce cas, nous savons qu’aucun des documents adoptés le 8 août ne fait référence à cette question. Pourtant, le 8 août, le président Aliev et l’un de ses conseillers, Elchin Amirbayov, ont réitéré l’exigence de Bakou pour un tel changement comme condition préalable à la signature de l’accord de paix et à la normalisation ultérieure des relations avec l’Arménie.
Il ne m’est pas clair dans quelle mesure cette question, qui n’est pas simple à accomplir pour l’Arménie, constitue une préoccupation réelle pour Bakou et dans quelle mesure elle est un moyen de retarder la signature, préservant les options futures de Bakou. Bakou veut éliminer toute base constitutionnelle permettant à un futur dirigeant arménien de défendre ou de mettre en œuvre une politique de revendications territoriales contre l’Azerbaïdjan. Il est possible que la préoccupation de Bakou soit sincère. Mais cela n’en fait pas pour autant un véritable enjeu. Après tout, si Pachinian avait pu changer la Constitution arménienne aussi facilement qu’Aliev peut changer celle de l’Azerbaïdjan, dans l’avenir un nouveau dirigeant en Arménie qui désapprouve les politiques de Pachinian pourrait également changer cette nouvelle Constitution.
Ce qui consolidera la paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, c’est la construction d’une plus grande confiance entre eux, le développement de relations normales qui profiteront aux peuples des deux pays, et la fin de la rhétorique et des actions azerbaïdjanaises agressives contre l’Arménie, qui alimentent les arguments de l’opposition arménienne selon lesquels l’Azerbaïdjan ne veut pas la paix, qu’il n’est pas digne de confiance, que lorsque l’Arménie accepte les conditions de Bakou, celui-ci formule de nouvelles exigences.
Il n’est pas possible d’avoir de réelles préoccupations concernant de futurs dirigeants de l’Arménie qui pourraient accéder au pouvoir en utilisant le comportement azerbaïdjanais contre Pachinian, tout en nourrissant cette opposition par un tel comportement.
- À Washington, Erevan et Bakou se sont mis d’accord pour demander la dissolution officielle du Groupe de Minsk de l’OSCE, avec l’appui des États-Unis. Ce groupe, censé piloter le processus de paix depuis les années 1990, avait de fait cessé d’exister après la guerre de 2020, et s’était enlisé bien avant.
- Enfin, l’un des espoirs suscités par ces accords est que Bakou mette un terme à ses discours sur un prétendu « Azerbaïdjan occidental », concept qui inclut en réalité le territoire arménien. Ce serait un premier pas, certes insuffisant pour dissiper toutes les craintes à Erevan, mais néanmoins symboliquement significatif.
IV. Dimensions internationales
- Il y a une tendance dans les milieux d’analystes à mesurer l’importance de ces accords en termes de leur valeur pour l’un ou l’autre côté de la division géopolitique. La perception générale est que les États-Unis ou l’Occident ont gagné et que la Russie a perdu. De plus, certains soutiennent que la Russie ne va pas accepter cette défaite passivement ; regardez la Géorgie et l’Ukraine, argumentent-ils, l’Arménie et l’Azerbaïdjan prennent des risques considérables.
C’est certainement un argument sérieux. Mais cet argument présente deux problèmes. Premièrement, il ne remet pas en question l’intimidation russe au-delà des intérêts que Moscou a dans les terres voisines, c’est-à-dire le coût pour les peuples des terres voisines d’adopter des politiques dominées par la menace de représailles russes.
Deuxièmement, le comportement de la Russie va au-delà de sa propre protection ; il fait aussi partie de la mentalité impériale dont j’ai parlé ailleurs. Les empires s’effondrent ; mais la mentalité impériale survit. Comme nous oublions vite que ces mêmes peuples ont coulé l’empire soviétique/russe.
Si la réponse des empires soviétique/russe et des mentalités post-impériales aux menaces extérieures s’était limitée à des politiques étrangères et de sécurité prescrites pour les voisins, il aurait été compréhensible de s’attendre à ce que les voisins agissent de manière responsable et ne deviennent pas des outils entre les mains des antagonistes ou ennemis de la Russie. Mais tout comme l’histoire a montré que l’on peut compter sur la Russie pour riposter par la force brute contre les empiétements dans ce qu’elle considère comme son arrière-cour ou son ventre mou, l’histoire montre aussi que la Russie exige que les peuples de ces terres soient gouvernés par des dirigeants du choix de Moscou, selon le modèle que Moscou a créé pour elle-même, ou par l’occupation pure et simple et l’annexion de territoires. Comme l’a fait l’Union soviétique, tandis que la Russie tsariste occupait ces terres directement. Considérer un empire comme acquis, sous quelque nom que ce soit, s’est avéré ne pas être une solution au problème des confrontations stratégiques ; au contraire, les empires sont plus susceptibles d’être la cause de telles confrontations.
J’ai de sérieux doutes que l’enlèvement systématique d’enfants ukrainiens, la destruction de cibles civiles et le ciblage des civils eux-mêmes, et l’annexion pure et simple de territoires appartenant aux voisins puissent s’expliquer par les préoccupations russes concernant une politique occidentale très sérieusement défaillante d’expansion de l’OTAN.
- Les empires s’effondrent et se replient. Moscou n’est pas actuellement en position d’occuper l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Il a dominé la région en dressant un peuple contre l’autre et en réussissant à porter au pouvoir des élites qui lui sont favorables. C’est-à-dire, en utilisant les antagonismes politiques intérieurs d’un pays. Il ne s’agit pas de délégitimer les griefs des forces d’opposition intérieure ; mais plutôt de souligner qu’il arrive souvent que des griefs légitimes soient récupérés puis subsumés dans les jeux des grands acteurs.
Il semble peu probable que l’Azerbaïdjan compte encore de nombreux éléments pro-russes. Mais ils existent en Arménie et ils sont encouragés à recourir à la violence pour changer le gouvernement. C’est là où la politique intérieure et internationale se chevauchent, c’est ainsi que peut être comprise la plupart de l’opposition au gouvernement Pachinian — oligarques, anciens dirigeants, l’Église.
Ceux qui dans leur analyse attribuent une permanence aux empires et tiennent pour acquise l’inévitabilité du comportement post-impérial ignorent même l’histoire la plus récente.
- La Russie a tenu l’Arménie pour acquise et a échoué à remplir les obligations qu’elle avait assumées dans les traités bilatéraux et multilatéraux impliquant l’Arménie. Moscou ne donne aucune indication qu’elle se comportera différemment à l’avenir. Néanmoins, il s’attend toujours à être traitée comme le sauveur de l’Arménie.
Cela ne signifie pas que j’approuve tous les aspects ou toutes les formulations des politiques étrangères et de sécurité du gouvernement d’Erevan ; mais j’apprécie que le principe directeur principal du gouvernement ait été à juste titre de rechercher la sécurité du pays dans la réduction des sources de conflit et des menaces à son territoire en travaillant avec ses voisins tout en plaçant la souveraineté, l’intégrité territoriale et la paix au-dessus de toutes les autres valeurs.
- Les empires s’effondrent et se replient, et pas seulement l’empire russe. L’empire américain s’est lui aussi replié,malgré les actions spasmodiques et réflectives de Washington. La cause la plus importante de cela ne doit pas être cherchée dans la politique étrangère américaine ; elle se trouve plutôt dans l’absence de qualité du leadership à Washington, le niveau du discours politique, et l’endettement insoutenable qui maintient l’État et ses dépenses militaires. Ce ne sont pas là des éléments qui soutiennent un empire ou une politique post-impériale ; ce sont plutôt, historiquement, symptomatiques d’empires en déclin.
On peut aussi regarder l’état déplorable du tableau d’ensemble de l’ordre mondial post-Seconde Guerre mondialequi avait été imaginé et instauré par les États-Unis : l’ONU et les institutions affiliées, l’OTAN, pour ne nommer que quelques exemples. Aucune d’entre elles ne fonctionne actuellement avec un quelconque niveau d’efficacité ou d’harmonie, principalement à cause des politiques américaines.
- Les États-Unis apparaissent comme le garant des accords du 8 août, mais rien dans ce qui a été signé ne le dit. Même s’il y avait une telle disposition, il m’est difficile d’imaginer que les États-Unis utiliseront la force pour contraindre l’Arménie ou l’Azerbaïdjan à respecter les accords, si ces signataires trébuchent sur les détails lors de l’élaboration de ce qui a été convenu. Si les États-Unis n’utiliseront pas toutes leurs ressources pour mener à bien le processus de paix, toute garantie imaginée reste symbolique, au mieux une question d’honneur pour les signataires et le garant supposé.
Même dans les meilleures circonstances, les garanties américaines demeurent inconstantes, d’autant plus si l’on considère le caractère et le modus operandi de l’administration actuelle à Washington. La nature très personnalisée de l’élaboration des politiques américaines sous l’administration actuelle tend à renforcer ce sentiment d’incertitude et d’imprévisibilité qui prévaut aux États-Unis et dans le monde entier en général. Ce sentiment s’accentue lorsque l’on considère que les États-Unis n’ont pas d’intérêts vitaux dans le Caucase du Sud ; au mieux, les intérêts américains sont périphériques à la région elle-même. Ils concernent la Russie, l’Iran, la Turquie, la mer Caspienne, etc.
Dans les circonstances actuelles, les États-Unis peuvent sacrifier l’Arménie pour de la menue monnaie.
- Les États-Unis auraient pu obtenir des concessions importantes de Bakou pour avoir admis le président Aliev à la Maison Blanche et offert un soutien à de nouveaux investissements dans ce pays, soit sur le front intérieur azerbaïdjanais, soit sur des questions impliquant l’Arménie : la condition préalable du changement constitutionnel, les prisonniers arméniens à Bakou.
Mais j’ai le sentiment que le sommet de Washington n’a pas été préparé méticuleusement par des experts qui connaissaient les enjeux aussi bien qu’ils l’auraient dû. Les diplomates américains qui avaient une connaissance approfondie des questions ont été écartés du département d’État. Il est possible que les négociateurs actuels aient fait leurs devoirs et décidé de ne pas faire pression sur le président de l’Azerbaïdjan, ayant un autre ensemble d’objectifs en tête. Il est difficile de ne pas avoir le sentiment que Washington a peut-être vu dans ce sommet une nouvelle occasion de se mettre en avant.
- La Russie et l’Iran ont exprimé de sérieuses objections à l’ensemble du processus, et c’est compréhensible. Le gouvernement d’Arménie fait face à un défi pour gérer leurs préoccupations. Mais nous devons distinguer les aspects légitimes des préoccupations de ces deux voisins importants de leur tendance à assimiler les intérêts de l’Arménie aux leurs.
La souveraineté signifie prendre ses propres décisions sur la base de ses intérêts. Le respect de la souveraineté de l’Arménie, que tous les pays, y compris l’Iran et la Russie, ont professé, signifie que l’Arménie doit servir ses propres objectifs et n’est pas là pour servir les intérêts d’autrui. Prendre en compte les intérêts légitimes des voisins ne signifie pas formuler et poursuivre des politiques basées sur les intérêts d’autrui. Une diplomatie imaginative peut trouver des solutions à tout conflit entre les intérêts de deux pays, en supposant que les voisins soient disposés à respecter les solutions trouvées par les dirigeants élus d’Arménie et que les dirigeants élus d’Arménie soient circonspects dans leurs politiques.
Il est possible pour tout voisin d’utiliser la force pour empêcher l’Arménie de poursuivre ses intérêts tels qu’elle les définit. Et l’Arménie peut ne pas être en mesure de résister. Mais alors, dans ce cas-là, nous devons accepter que déjà telle est la menace à laquelle nous faisons face actuellement. Nous devons alors réduire nos attentes envers eux en tant que pays amis ou alliés. La Russie s’est avérée peu fiable, même en tant que seul allié formel de l’Arménie.
Elle s’est également avérée peu fiable pour l’Azerbaïdjan ; ces derniers jours, elle a détruit les plateformes pétrolières et les dépôts de SOCAR dans la région d’Odessa.
L’Iran a traité avec l’Azerbaïdjan sur la base de ses propres intérêts concernant les questions du Karabakh/Azerbaïdjan-Arménie. Plus récemment, l’Iran a approuvé la résolution d’Istanbul ridiculement anti-arménienne de l’Organisation de la coopération islamique. Même en termes symboliques, des responsables iraniens de haut niveau sont apparus à Chouchi et Stepanakert, ignorant la sensibilité du peuple arménien. Tout cela est compréhensible ; l’Iran poursuit ses intérêts d’État. Il devrait montrer une compréhension similaire lorsque l’Arménie poursuit ses intérêts tels qu’elle les définit. Le débat interne en Iran oppose maintenant ceux qui voient les accords du 8 août comme une menace et ceux qui y voient de nouvelles opportunités.
J’ai un grand respect pour la diplomatie russe et je suis conscient de la longue mémoire, de la patience et de la résilience de la Russie. J’ai également le plus grand respect pour le profond sens de l’État du leadership iranien qui a perduré pendant des millénaires, et sa capacité prouvée à définir ses intérêts. On ne devrait pas sous-estimer la capacité de ces deux pays à comprendre les changements, à s’adapter aux nouvelles situations, tout en protégeant leurs intérêts et en travaillant avec Erevan et Bakou.
- Il ne fait aucun doute qu’en essence, l’Europe et les États-Unis n’ont pas renoncé à leurs mentalités antisoviétiques et antirusses, ce qui a accru les inquiétudes de Moscou quant aux menaces pesant sur la Russie jusqu’à des niveaux dangereux.
La question que nous devrions poser est la suivante : devons-nous nous soucier des peuples de ces pays voisins ?
Sont-ils pertinents ? Comptent-ils ? Ou doivent-ils être considérés strictement comme des pions dans une partie d’échecs que jouent les grands ? Les peuples comptent-ils en politique ? Si ce n’est pas le cas, quel est alors le but de la politique, qu’elle soit intérieure ou internationale ? Est-ce seulement de satisfaire les intérêts stratégiques des grandes puissances — et toutes les politiques qu’elles conçoivent au nom des intérêts vitaux et des concepts stratégiques, au nom de leurs rivalités, abstraites des réalités dans lesquelles vivent les peuples réels de ces pays ?
- Certains pourraient penser qu’il s’agit là de l’argument d’un idéaliste. Ils auraient eu tort. Ce sont les questions d’un historien qui a vécu la politique et qui, durant quelques années décisives dans les années 1990, a participé à la diplomatie. Si les peuples locaux et les peuples des pays voisins n’avaient pas compté, les empires qui ont vu le jour il y a quelques milliers d’années auraient survécu jusqu’à nos jours.
La compréhension des rivalités internationales et des modèles stratégiques qui en découlent, tout comme des rivalités et stratégies impériales, restera déficiente si elle ignore le rôle parfois silencieux mais toujours incontournable des peuples, qu’ils soient soumis à la domination impériale ou qu’ils peuplent les anciennes colonies.
V. Remarques finales
- L’Azerbaïdjan et l’Arménie devront travailler en étroite collaboration avec la Russie et l’Iran afin que ces derniers aident les deux pays en conflit à consolider le processus de paix en cours entre eux.
- Toutes ces questions, sans exception, nécessitent un entretien et des soins quotidiens. Les chances de nouveaux progrès dépendent de la capacité et de la volonté des deux républiques à travailler ensemble et à agir directement, sans revenir à la vieille habitude de faire appel à des « oncles » pour les soutenir ou régler leurs désaccords.
- Certaines solutions créent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. Les arrangements conclus le 8 août à Washington pourraient finir par être un tel cas de figure. Heureusement, comme indiqué ci-dessus, la méthodologie fondamentale des accords conclus à Washington résulte de négociations bilatérales directes, sans médiation. Et c’est là l’un des aspects les plus positifs des accords signés le 8 août. Il y a eu une augmentation significative de la confiance que se portent mutuellement les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, une confiance soutenue par la compréhension que certains de leurs intérêts, sinon la plupart, sont partagés. Ce n’est pas encore une confiance solide, mais suffisante pour s’appuyer dessus.
- Une façon d’évaluer l’importance de ces documents est de voir s’ils marquent des progrès suffisants pour que la Turquie mette maintenant en œuvre des mesures pratiques pour la normalisation des relations avec Erevan, notamment l’ouverture de la frontière avec l’Arménie. Ces documents offrent-ils au président Ilham Aliev une raison suffisante de libérer Ankara de son emprise sur la politique turque envers l’Arménie ? Jusqu’à présent, rien n’indique que ce sera le cas. Si tel est le cas, c’est regrettable, car par quelques mesures pratiques et significatives, Ankara pourrait contribuer considérablement à la consolidation des progrès réalisés avec l’adoption de ces documents.
- Pour une solution plus permanente à l’avenir du Caucase du Sud, il faudrait s’attacher à faire du Caucase du Sud un concept politique, et pas seulement géographique. Les trois républiques du Caucase du Sud pourraient commencer à coopérer à de nombreux niveaux pour consolider les gains obtenus grâce aux progrès très sérieux réalisés lors des récentes négociations. Un tel développement serait utile à l’objectif de faire de la région plus qu’un simple terrain de jeu pour les puissances extérieures ou qu’elle soit traitée simplement comme une route de transit par des gouvernements et des experts dont les analyses ignorent souvent qu’il y a de vraies personnes qui vivent dans le Caucase du Sud avec leurs propres idées et intérêts.
Il revient maintenant à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de travailler ensemble, avec la Géorgie, pour ne pas permettre que leur nouvelle voie vers la paix soit récupérée et/ou perturbée par quelconque force extérieure. L’alternative sera de revenir à une ère de manipulation extérieure et de conflit renouvelé, quand ils seront réduits à des pions dans un jeu et considérés strictement comme des pays à travers lesquels transitent des pipelines. L’Azerbaïdjan et l’Arménie ont prouvé qu’ils étaient capables de développer une telle voie qui renforce leur souveraineté ; ils peuvent maintenant la maintenir. La souveraineté apporte avec elle des responsabilités ; pour commencer, des responsabilités envers les peuples au nom desquels la souveraineté s’exerce.