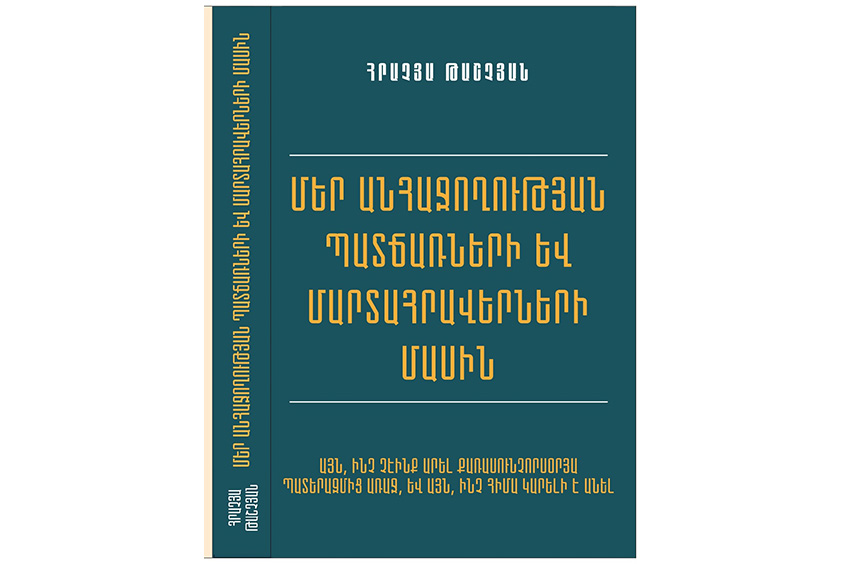
Le livre de Hrachia Tashchian, intitulé « A propos des causes de nos échecs et de nos défis »
Par Marc DAVO
Le mois de septembre est le mois des anniversaires en Arménie, joyeux (indépendance du pays), dramatiques (déclenchement de la guerre des 44 jours, nettoyage ethnique, perte du Haut-Karabakh, …). Bref, des occasions, non pas pour surestimer l’effort accompli dans un cas et s’api-
toyer dans un autre, mais pour approfondir la recherche et la connaissance objective des événements qui ont marqués l’histoire des Arméniens. Ce moment privilégié m’a poussé à la lecture du récent livre (1) de Hrachia Tashchian, ancien diplomate de carrière et actuellement enseignant à
Erevan. Ce faisant, je me suis référé à plusieurs reprises à l’excellent ouvrage (2) de Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis, notamment aux passages dans lesquels la question des alliances est examinée.
Hrachia Tashchian, dans son livre, attache de l’importance à l’aspect psycho-social des conséquences de la guerre sur une population dont le pays subit la défaite militaire. Il se réfère à des écrits politiques et philosophiques, notamment des auteurs anglo-saxons, afin d’étayer son analyse. Il estime que la défaite azérie de 1994 (cessez-le-feu signé à l’issue de la première guerre du Haut-Karabakh) a été un stimulant de l’affirmation identitaire et un élément instigateur essentiel dans la résurgence d’un sentiment de revanche, donnant lieu à la mobilisation des ressources humaines et matérielles de la part non seulement de la classe politique, adroitement menée par Ilham Aliev, mais aussi chez la population qui se sentait diminuée et avilie dans son for intérieur. Ce sentiment s’aggravait d’autant plus que les Arméniens n’hésitaient pas à leur rappeler à toute occasion « leur incapacité à se battre courageusement, … » (sketchs d’imitation, émissions télévisées, …).
Le moyen de sortir d’une telle situation déprimante ne pouvait donc être qu’une nouvelle guerre. Pour s’y lancer avec des résultats favorables, il a fallu renforcer les institutions, autrement dit l’État. Selon Charles Tilly, cité par H. Tashchian, « la guerre a créé l’État et l’État la guerre ». Ainsi, la guerre a-t-elle joué un rôle important dans la construction de l’Etat azerbaïdjanais issu de l’effondrement en 1991 de l’URSS.
En parcourant rapidement les années depuis l’indépendance des pays sud-caucasiens en 1991, j’ai constaté avec étonnement la marche forcée des Azéris en vue de construire leur Etat, certes aidés en cela par les ressources pétrolières et gazières, alors que l’État arménien et de la même manière les institutions étatiques au Haut-Karabakh ont servi de domaine d’enrichissement personnel des dirigeants. Les deniers publics ont fait l’objet, soit de pillage systématique, soit d’offre quasiment gratuite par ces mêmes dirigeants aux Russes (industrie, énergie, transports, douane, …).
Les dirigeants arméniens se sont reposés sur leurs oreillers
À la suite de chaque conflit, l’étude des cas prend une importance primordiale pour les états-majors des armées dans le monde. L’auteur du livre établit des parallèles entre la situation du conflit arméno-azéri et celle des pays arabes limitrophes d’Israël après les guerres des Six jours (juin 1967) et de Yom Kippour (octobre 1973). La défaite arabe de 1967 avait enfoncé les sociétés arabes dans un état de déception difficile à supporter, mais elle avait aussi affecté négativement la vigilance de l’Etat hébreu à l’égard des menées chez ses voisins. Les dirigeants israéliens étaient restés sur l’idée de la supériorité militaire et donc de l’invincibilité de leur armée (Tsahal). L’Egypte en a profité. Les opérations militaires de 1973 à l’initiative du président Sadat ont constitué la revanche arabe et une sorte de « sanction » de la torpeur des responsables politiques, militaires et sécuritaires d’Israël. On connaît le résultat, l’armée égyptienne a effectué une percée des lignes ennemies sur le canal de Suez, ce qui été un choc pour la direction et la société israéliennes. Les Etats-Unis sont fortement intervenus par un soutien massif, ce qui a sauvé Israël. Et, les Arabes ont quand-même pu panser leurs plaies.
Je doute fort que ces événements, mêmes lointains dans le temps, aient été étudiés sérieusement par la classe politique et l’institution militaire arméniennes. En tout cas, elles ne semblent pas en avoir tiré l’enseignement qui s’imposait. Elles ont laissé l’ensemble de la population dans l’insouciance, étant convaincues que la Russie les protégerait ad vitam eternam. En l’espèce, le clan karabakhtsi et les éléments locaux trempés dans la corruption et le pillage ont une grande part de responsabilité dans les échecs, d’autant plus que ledit clan s’est mis au service des intérêts russes dans la sous-région.
La Russie n’a absolument pas joué le rôle d’un allié stratégique. Et pourtant, en 1997, elle s’était engagée à soutenir l’Arménie. Cependant, dans un passage concernant la situation de l’Arménie, de son armée et surtout du soutien extérieur qu’elle aurait dû recevoir, notre diplomate enseignant à l’annexe d’Erevan de l’Université Lomonosov de Moscou se montre timoré. Lors de la seconde guerre du Haut-Karabakh, la Russie « a adopté une attitude équilibrée vis-à-vis des parties au conflit » écrit-il (cf p 54). Oublie-t-il que l’Arménie est restée fidèle comme l’allié stratégique outre qu’elle continuait de faire partie de l’OTSC (Organisation du traité de sécurité collective) ? Elle a été l’un des rares pays à envoyer un détachement de médecins militaires en Syrie (février 2019) aux côtés des militaires russes. Elle a également dépêché un petit contingent de militaires pour accompagner l’intervention russe au Kazakhstan en soutien au président Tokaïev (début 2022). L’Arménie n’a pas failli à ses obligations d’allié de la Russie. En revanche, la Russie a été aux abonnés absents, lorsque l’Arménie s’attendait légitimement à un coup de main de la part de son allié principal.
Sans doute la formation et la culture russophones de M. Tashchian ont-elles un rapport avec son jugement fort modéré sur l’attitude inacceptable de Moscou à l’égard de l’Arménie. Quoi qu’il en soit, notre diplomate observe avec lucidité le cours des événements et l’évolution du rapport de forces, mais il le fait a posteriori, car l’encadrement diplomatique arménienne de l’époque formaté à l’école soviétique n’était pas en mesure d’aller au-delà du prisme qui lui était propre, ligoté qu’il a été par son inféodation au Centre moscovite. Ce même état d’esprit semble perdurer bien entendu dans des proportions moindres. Ces gens-là auraient dû savoir, ne serait-ce qu’intuitivement, que l’alliance entre l’Arménie et la Russie est caractérisée par une alliance de deux partenaires
de puissance différente, comme en donne des exemples et souligne les inconvénients Gérard Araud dans l’histoire diplomatique. « Depuis que
le monde est monde les Etats se sont alliés et ils l’ont toujours fait contre un ennemi … » précise l’ancien ambassadeur (cf p 142). Or, la période
récente montre que l’Azerbaïdjan n’était pas un ennemi pour Moscou. Après la signature d’un accord de coopération stratégique en février
2022, juste avant l’invasion de l’Ukraine, ce pays est même devenu un allié.
Rien d’étonnant dans ces conditions que la balance a été nettement en faveur des Azéris dans le conflit qui les opposait aux Arméniens.
« La guerre moderne n’a rien à voir avec les guerres traditionnelles » (3)
La guerre moderne n’a rien à voir avec les guerres traditionnelles que nous avons connues, affirme Alain Juillet lors d’une émission télévisée (Open Box TV). En réalité, privée de soutien de son « allié stratégique » du nord, mais sans s’en rendre compte véritablement, l’Arménie s’est retrouvée soudain seule face au rouleau compresseur turco-tatare. On peut imaginer ce qu’aurait été la situation d’Israël sans le soutien américain notamment en 1973. Inutile de reprocher à l’Occident d’être resté inactif dans le drame arménien de 2020 comme le font certains sous influence de la propagande russe. Ni la France, ni les Etats-Unis n’ont des accords d’assistance ou de coopération militaire avec l’Arménie. Moscou dispose des forces armées sur le terrain. Le contingent qui devait protéger la population du Haut-Karabakh était entièrement russe.
La Turquie, vis-à-vis de l’Azerbaïdjan, a joué, toutes choses égales par ailleurs, le rôle que les Etats-Unis ont joué et continuent de jouer au profit d’Israël. Pendant des années, Ankara a aidé Bakou à réformer ses institutions militaires et aussi a fourni du matériel militaire moderne. En effet, l’auteur de l’étude des causes d’échec arménien met l’accent sur le soutien de la Turquie non seulement au niveau de la fourniture d’armements efficaces, mais surtout, sur l’encadrement, la planification et même la direction des opérations durant les hostilités dès le 27 septembre 2020. Ce soutien ne s’est pas limité à la période des opérations militaires. L’encadrement et la formation des cadres militaires azéris avaient commencé bien avant, alors que les dirigeants d’Erevan et de surcroit, ceux de Stepanakert restaient dans leur conviction que les Russes ne les laisseraient pas tomber (En réalité, en septembre 2023, ils ont laissé tomber certains, curieusement les plus pro-russes, dans les geôles de Bakou).
Dans un monde où la guerre est un instrument légitime de défense des intérêts nationaux, seul l’équilibre des puissances, en rendant la victoire incertaine, en écarte le spectre, rappelle l’ambassadeur Araud.
Les centres d’études et des experts internationaux sérieux s’étonnent de la vétusté du système de défense arménien à la veille de l’éclatement de la guerre des 44 jours, et de très peu d’effort de rattrapage fait durant les 26 années précédentes. Le retard de la doctrine militaire arménienne a fait l’objet d’études. A cet égard, le Colonel Artsrun Hovhannissian a, sans ambages, soulevé les faiblesses de la formation de l’encadrement de l’armée arménienne, mais il a été la cible d’une campagne de dénigrement. Le fondateur de l’ONG « Art de survivre », Vladimir (dit Vova) Vardanov, de son côté, a évoqué sur ReOpenMedia du journaliste David Grigorian, la lenteur de réaction, l’absence d’organisation appropriée et le management rudimentaire de la guerre, côté arménien.
La commission d’enquête parlementaire qui s’est penchée sur la question durant plusieurs années a récemment remis ses conclusions au président de l’Assemblée nationale, Alen Simonian. Ce dernier semble s’abstenir de rendre public le rapport en dépit d’une demande forte de la population du pays qui a le droit de connaître les raisons de la défaite arménienne.
M. D. ■
_____
(1) Hrachia Tashchian, A propos des causes de nos échecs et de nos défis, Ed. d’auteur, Erevan, 2024 (en arménien).
(2) Gérard Araud, Histoires diplomatiques, leçons d’hier pour le monde d’aujourd’hui, Le Livre de Poche, Paris, 2022.
(3) Alain Juillet, ancien responsable au Service de renseignements français, Open Box TV, oct. 2025.