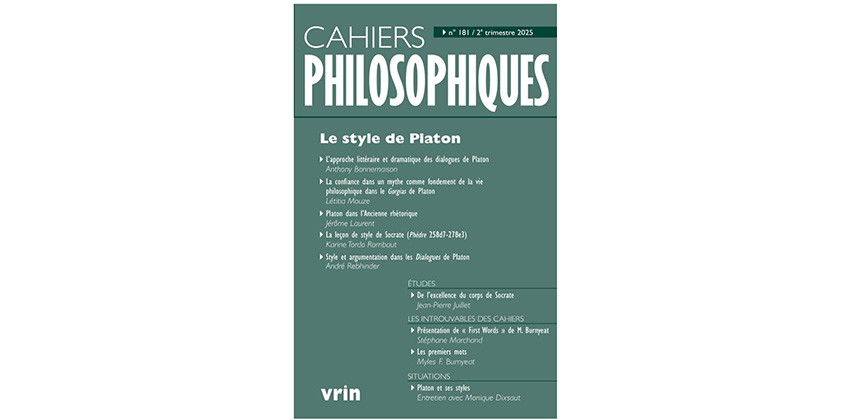
« Le style de Platon »
Paris, éditions Vrin, 2025,
143 p., 14, 00€
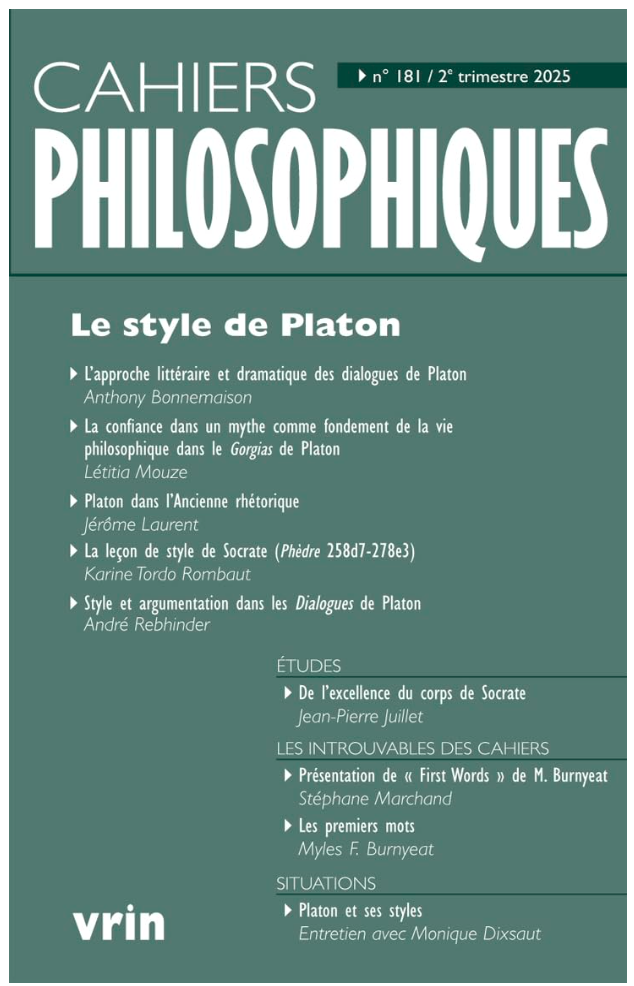
Définir ce qu’est le style s’avère difficile. L’on pourrait alors, comme le fait ici Monique Dixsaut, reprendre les propos que Gilles Deleuze (1925-1995) tenait dans Pourparlers (1990) : « Les grands philosophes sont aussi de grands stylistes. Le style en philosophie, c’est le mouvement du concept. […] Le style, c’est une mise en variation de la langue, une modulation et une tension de tout le langage vers le dehors. […] Il y a un style lorsque les mots produisent un éclair qui va des uns aux autres, même très éloignés ». Cet éclair, Dixsaut le nomme « puissance » : « Le style est pour Platon une puissance », écrit-elle.
Si Platon a choisi la forme des « dialogues » et non celle du traité, c’est pour entretenir un lien actif avec l’interlocuteur ou le lecteur, les mettre au travail. Il incombe au philosophe d’affecter les âmes, comme le soulignent différents auteurs de ce volume qui se penchent alors non seulement sur les dialogues, mais aussi sur les prologues et les mythes que Platon convoque, afin de mettre au jour le sens philosophique des moments narratifs.
Certains auteurs, comme Jérôme Laurent ou Anthony Bonnemaison, abordent la question du style d’un point de vue du commentaire historique. Pour Platon, un lien infrangible unit beauté et vérité, ainsi que le rappelle J. Laurent : « mal parler, c’est mal penser et mal penser, c’est détourner l’âme de sa nourriture qu’est la vérité ». L’auteur examine la critique du style de Platon dans les écrits des rhétoriciens tels que Démétrios (auteur de Du style) qui attribue le raffinement de Platon à son art de mêler les styles différents (« le simple, le grand, l’élégant et le véhément »), Denys d’Halicarnasse (Ier s. av. J.-C.) ou encore Cicéron qui proposera « une image de l’orateur idéal en se référant à la théorie des Idées ». Laurent repère la comparaison avec Homère chez Quintilien qui attribue à Platon « une capacité d’expression vraiment divine et digne d’Homère et chez Longin selon qui Platon parvient au sublime car, plus que tous, il a puisé « à la source homérique ».
Dans son article, A. Bonnemaison situe les Dialogues dans l’histoire du commentaire platonicien depuis l’Antiquité jusqu’à notre époque où se démarque la position de Christopher Rowe pour qui Platon reste socratique et conserve une même position philosophique présentée « à chaque fois sous des angles différents ».
D’autres auteurs, à l’instar d’André Rebhinder, se pencheront sur les effets du discours inséparables de la forme dialogique. La forme du dialogue met en évidence la nécessité pour l’interlocuteur de Socrate (ou pour le lecteur de Platon) de demeurer actif. Il ne s’agit pas d’accueillir un discours qui serait versé dans une oreille comme en un entonnoir mais de travailler de concert. Le noyau dur des dialogues demeure l’immortalité de l’âme et donc la nécessité de vivre bien, c’est-à-dire selon le bien, le beau, le juste.
La puissance du discours a un effet sur les âmes et l’usage des mythes joue un rôle à cet égard, car il contribue à produire l’adhésion à des thèses indémontrables. Les ouvrages consacrés aux mythes chez Platon se multiplient, alimentant le débat autour de la question de savoir si ces images poétiques détiennent une valeur philosophique. Létitia Mouze répondra par l’affirmative dans son analyse du mythe eschatologique que Socrate convoque à la fin du Gorgias. Socrate s’en sert pour convaincre Calliclès de la nécessité de choisir une vie juste (philosophique) car elle est bien la seule réponse possible à la question fondamentale « comment faut-il vivre ? » . Il faut vivre pour sauver son âme.
Selon Bonnemaison, la singularité des dialogues de Platon tient au fait qu’ils mettent en scène « certaines positions et arguments comme meilleurs que d’autres », ce qui révèle « leur dimension argumentative et conceptuelle ». Mieux, les dialogues mettent en scène ce en quoi consiste la philosophie, « le dialogue de l’âme avec elle-même », écrit il. C’est ce qu’affirme également Karine Tordo Rombaut qui décortique la deuxième partie du Phèdre pour mettre en évidence le travail réflexif imposé au locuteur ou au rédacteur autant qu’à son destinataire. Ainsi, le texte de Platon se révèle-t-il comme le « support d’un exercice » qui, opposé à l’oisiveté à laquelle invite le chant et le mythe des cigales, procède de l’activité intellectuelle insufflant la vie au discours rendu apte à véhiculer les semences qui sont en lui.
Les Dialogues de Platon détiennent à la fois un aspect esthétique et un aspect heuristique, ils sont « hybrides » affirme André Rebhinter qui voit en eux un « instrument de la mémoire de Socrate », un moyen propager le « plaisir que causait la remémoration de Socrate quand il parlait et réfutait ». Socrate charmait par son discours qui agissait par sa force incantatoire amenant l’interlocuteur à considérer son âme et à n’avoir plus peur de la mort.
Considérer son âme, c’est aussi entrer en connexion avec elle en sortant de son corps. D’où la question à laquelle s’intéresse Jean-Pierre Juillet, celle du rapport possible entre l’excellence de l’âme de Socrate et celle de son corps. Y aurait-il un « régime commun de l’âme et du corps » ? Juillet analyse le portrait qu’ Alcibiade dressait de Socrate (reconnu par ses contemporains pour sa force, sa résistance, pour le fait de pouvoir boire sans jamais devenir ivre, etc.) et repère les moyens donnés à l’âme pour gouverner le corps. Socrate, on le sait, était resté debout un jour et une nuit pour méditer sur un problème et en trouver la solution. Il suspend alors sa sensibilité, semble en-dehors de son corps. Cet état de « catalepsie » ressortit à une discipline d’extase fondée sur un contrôle respiratoire permettant de s’échapper de son corps, de le rendre docile, c’est-à-dire au service de l’âme. Juillet met en avant la spiritualisation du corps par l’âme, laquelle orientée vers « l’intelligible et l’invisible dont elle procède », se désintéresse du sensible et du visible.
Dans la section « Les introuvables des cahiers », Stéphane Marchand présente la traduction du texte de la conférence intitulée « First Words » par laquelle Myles Burnyeat (1939-2019) clôturait son enseignement à Cambridge en 1996. Cette conférence, « Les premiers mots » (qui révèle aussi le sens de l’humour de Burnyeat puisqu’il s’agit de son discours de clôture) Burnyeat la mène comme une enquête tout à la fois savante et joyeuse. Il se propose de reprendre la stratégie de lecture du néoplatonicien Proclus (412-485) qui scrutait (presque religieusement) chaque détail des écrits de Platon pour en comprendre la philosophie. Ainsi, selon Proclus, les prologues « ces scènes d’ouverture où les interlocuteurs sont présentés », sont-elles indicatrices du sujet philosophique principal du dialogue en question. Burnyeat confirme le procédé, il prend le premier mot ou la première phrase de certains dialogues pour repérer leur lien à la question principale. Dans la République, par exemple, la première phrase par laquelle commence Platon est « j’étais descendu hier au Pirée ». La lecture du dialogue révèle l’importance de la montée et de la descente, dans la caverne ou vers le monde solaire des Idées, tout comme la descente dans l’Hadès (la katabasis), image du monde sensible et doublure de la caverne-prison. Burnyeat poursuit avec le prologue du Banquet, du Phédon et du Timée, rendant alors manifeste le sérieux qu’enveloppent les jeux de mots auxquels nous prenons plaisir.
L’on regrettera qu’aucun article n’ait été consacré aux ressorts de l’humour dans les Dialogues (l’on peut penser à la lecture du Banquet par Lacan), ni à l’importance des atmosphères que, par les mots, Platon crée pour en imprégner les locuteurs et les lecteurs. Le hoquet d’Aristophane (Banquet) ou le chant des cigales sous le grand platane dans le décor enchanteur de la Grèce (Phèdre), parmi de nombreux exemples, n’ont-ils rien à voir avec le rythme et l’envoûtement, avec l’ébranlement du corps et la perturbation du discours, avec le plaisir esthétique qui exigent un effort supplémentaire de concentration ?
Chakè MATOSSIAN ■