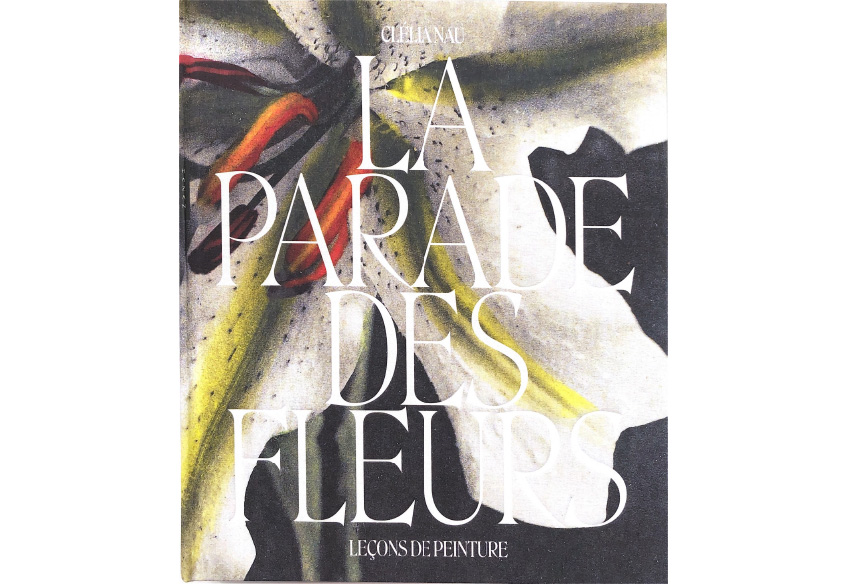
Clélia Nau
La parade des fleurs
(Leçons de peinture)
Hazan, 2025,
280 p., 110,00€
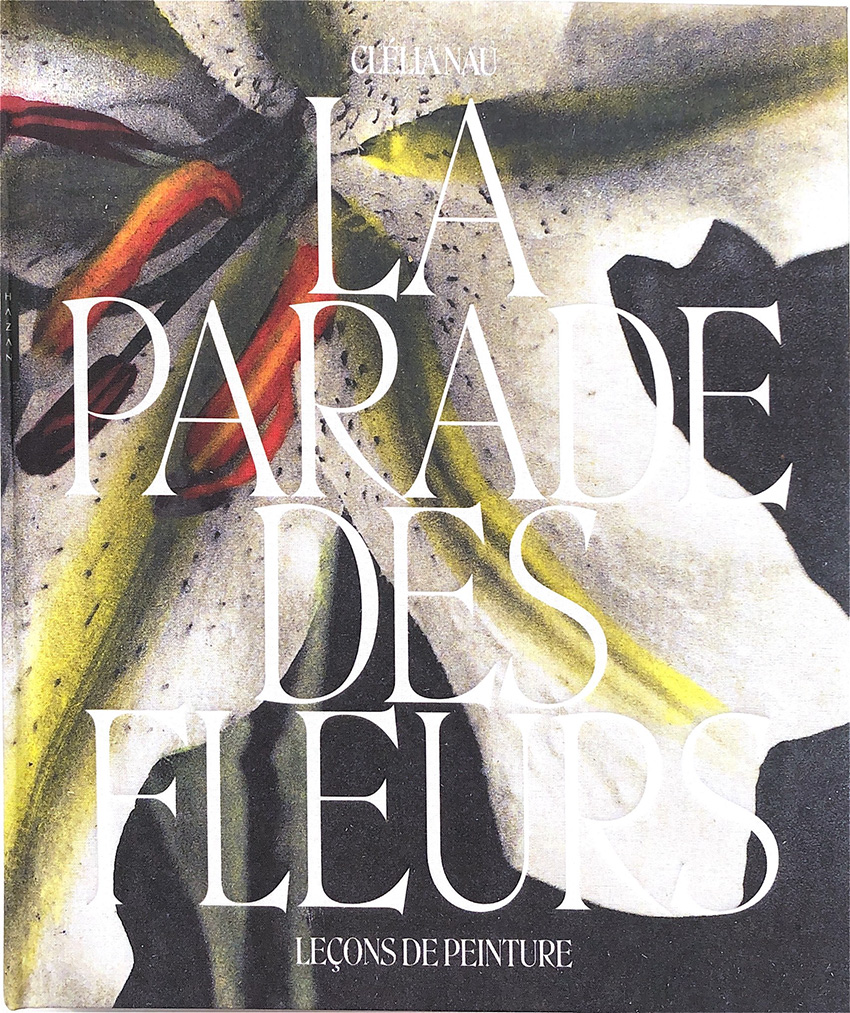
Dans un livre magnifiquement illustré, luxueusement présenté sous forme d’album inséré dans un coffret, Clélia Nau, philosophe et historienne de l’art, poursuit son étude végétale en pénétrant son sujet, comme elle l’avait fait avec les Nymphéas de Monet (1) et dans son précédent ouvrage, Feuillages. C’est par la richesse des mots auxquels elle redonne leur force originelle, par le rythme des phrases que C. Nau devient partie intégrante du monde de la fleur dont elle cherche à capter la présence. L’étude de Nau n’a rien à voir avec une « symbolique » des fleurs, même si, bien sûr, certains tableaux analysés ne peuvent être séparés du contexte religieux ou culturels auxquels ils appartiennent (notamment la rose, rose céleste source éternelle de lumière vers laquelle se tourne Béatrice dans le Paradis de Dante). Il n’y a pas de « langage secret » des fleurs car la fleur est muette et c’est l’être là de la fleur qu’étouffe, par ses mots, le symbolisme floral. Ce qui compte pour l’autrice est l’inexprimable présence réelle d’une fleur, son rapport direct avec la vie qui fait tout son attrait. Aussi, contre l’interprétation symbolique, contre ce « réflexe culturel », propose-t-elle une « phanérologie », car les productions corporelles que sont les phanères manifestent le vivant en train d’élaborer son apparence et, de ce fait, sa relation au monde. Clélia Nau veut, avec ce livre, « ouvrir » le « concept de fleur ».
Si le cinéma a pu révéler, par l’accéléré (Nau cite Das Blumenwunder, de Max Reichmann, 1926) la pulsion interne du monde végétal, son intense mobilité, il n’en reste pas moins préférable de se mettre au diapason de la « pensée végétale » et de prendre alors le parti de la lenteur, ainsi que le fait le peintre. Comme le sous-titre du livre nous l’indique (« leçons de peinture ») il revient au peintre d’avoir compris et transposé ce « il y a » de la fleur, d’avoir saisi la source même de la vie en peignant des iris et des pivoines, des lys et des roses, des pissenlits dispersant leur duvet. A la différence des botanistes au regard borné par le besoin du classement (toujours dépassés par la vie végétale) ou des historiens de l’art qui, eux aussi, cherchent à classer et à nommer, C. Nau prône l’approche « stroboscopique » du peintre. Alors que le botaniste ne voit dans la fleur que la promesse du fruit, finalité procréatrice qui révèle une moralisation à l’œuvre dans le regard scientifique, le peintre sait, lui, se faire insecte : « de même que l’abeille se couvre de pollen en pénétrant par l’étroit éperon d’une fleur et le dépose sur le pistil de celle qu’il visite après, le peintre trempe son pinceau dans la matière colorée, agglomère des éléments tout à tour gluants et poudreux, transporte pollens et pigments entre les surfaces pour les fertiliser ». La fleur exhibe la pure dépense gratuite, elle est l’apparaître-même, le phénomène au sens philosophique et c’est à un peintre, Chardin, qu’il revient d’avoir compris cette « inexprimable présence réelle » . La fleur parade inutilement, gratuitement, ainsi qu’en témoignent tant de parties en elle, comme la corolle, réflecteur de lumière, réalisant une « intensification de l’apparence » qui semble bien antérieure à la « tâche reproductive ». Suivant souvent les études du zoologiste suisse Adolf Portmann (1897-1982) à qui l’on doit d’avoir mis en avant le sens biologique de l’apparaître, C. Nau écrit : « même quand la fleur adapte, à des fins intéressées sa forme à l’insecte susceptible de la polliniser, elle le fait toujours au-delà de ce que l’efficacité du leurre exigerait ».
La matière même des fleurs s’intègre à la peinture, ce qui fait de la cosmétique un objet d’étude très sérieux auquel s’intéresse C. Nau. Le peintre et la femme pratiquent un même art du fard, ils recourent aux mêmes instruments et réalisent le « pollen de la chair ». Mais les fleurs servent aussi, – comme en rend compte l’autrice en convoquant de nombreux auteurs parmi lesquels Balzac, Ponge, Bataille ou Huysmans, Goethe et Mallarmé – de métaphores pour décrire tous les changements de teint, les altérations épidermiques qui vont du rougissement pudique à la peau blafarde qu’engendrent les passions, la maladie (« teint d’hortensia dégénéré ») et la mort. Nau n’écarte pas les aspects morbides et même dégoûtants du monde floral que trahissent l’étymologie ou les métaphores, mais aussi l’art du « fané ». Et puis, il y a l’odeur. Le sens olfactif, intimement lié à l’animalité, fait partie du refoulé de la culture privilégiant la vision. C. Nau remet à sa place cette base de l’esthétique liée à la sexualité et insiste sur le contour odorant comme empreinte de notre singularité. Les parfums végétaux visent à faire oublier l’odeur corporelle animale que l’on attribue particulièrement à la femme, ce qu’illustre ici la série de collage de Kiki Smith (2004). En dédiant un chapitre au « porter fleur », l’autrice met en évidence le lien intime entre le corps humain et la fleur qui l’érotise. Au reste, bon nombre de métaphores végétales couvrent d’un pétale pudique, comique ou ironique la crudité des mots relevant du champ sexuel.
La parure, l’ornementation recèlent une valeur suprême en ce que « paraître est une nécessité vitale », qu’il y a une « primitive pulsion du corps à se rendre visible » en se parant, notamment, de fleurs. Attentive à l’intensification de la visibilité, C. Nau ne néglige en rien son envers, le camouflage que des peintres réalisent en amassant des fleurs qui occupent toute la toile afin d’ invisibiliser un sujet qu’il revient au regardeur de trouver.
Il y a un ordre de la fleur que C. Nau examine dans son livre. Partant d’un centre, la fleur développe une organisation quasi géométrique. Ainsi la rose se trouve-t-elle comparée au cristal ou à la géométrie des ballets aquatiques filmés par Busby Berkeley (1933). S’il peut exister une ressemblance géométrique entre l’organisation de la fleur et celle du cristal, il n’en reste pas moins une différence qui consiste en cette vitalité, perceptible dans la dynamique du bourgeonnement ou la « syntaxe de l’éclosion ». Dans son analyse originale des grilles de Piet Mondrian, C. Nau rappelle l’attachement du peintre néerlandais aux fleurs et démontre qu’il transpose la géométrie mouvante de la fleur dans ses constructions abstraites et particulièrement dans son oeuvre ultime, Victory Boogie Woogie (1942-44) où se meuvent des « petits carrés polliniques ».
Un tout autre genre d’ordre dirige la guirlande et le bouquet. Distinct de l’éparpillement, le bouquet l’est tout autant de la guirlande. Celle-ci prescrit un itinéraire alors que le bouquet offre une itinérance. La dynamique de cet arrangement reste tributaire de l’eau qui maintient momentanément les fleurs en vie et de la forme du vase qui permet ou entrave certains mouvements. Le lecteur verra d’étranges et inquiétants bouquets, comme ceux que l’artiste floral japonais Azuma Makoto a figés dans de monumentaux blocs de glace.
C’est au XIXe siècle, avec la peinture de plein air que l’artiste pollinisateur domine, nous dit C. Nau qui remarque l’influence de cet assujettissement volontaire au végétal dans les oeuvres abstraites du XXe siècle, tant en peinture que dans des installations où s’épand le grain sur la toile ou au sol (Nau convoque, entre autres, le travail de Wolfgang Laib). Gallé et d’autres artistes auront pour leur part végétalisé la main. Cet attribut propre à l’humain se transforme en algues, ses doigts en radicelles. Il s’agit d’un tournant important aux yeux de C.Nau en ce qu’il ouvre « la voie à une anthropologie alternative : l’humain déchu de sa position dominante, redécouvre le lien profond qui l’attache à tous les êtres qui ont en commun avec lui cette vie végétative ».
Grâce à ses incursions dans l’étymologie et à l’attention portée à l’évolution d’un mot, C. Nau a su mettre en évidence des rapprochements entre les parties de la fleur et celles de l’œil ou du corps humain. Une fleur binoculaire nous regarde dans l’étonnante Sainte Lucie de Francesco del Cossa (1473-74), une fleur se fera oeil chez un Odilon Redon.
Aristote affirmait que l’âme de l’homme contenait une partie végétative et, loin de déprécier cette dernière, Clélia Nau, citant Friedrich Schlegel (1772-1829), semble bien s’accorder avec le philosophe allemand pour cueillir là un enseignement précieux : « l’état le plus parfait et le plus pur de la vie n’est rien d’autre qu’un pur végéter ».
Chakè MATOSSIAN ■
______
(1) Cf. Machine-Aquarium, Metis Presse, 2021. Nous avons publié une recension de ce livre dans dans NH 272 du 7 octobre 2021. Le pdf est posté sur Academia.edu.