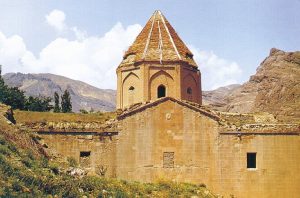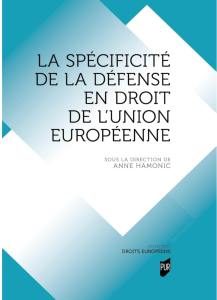La carence en cadres compétents et bien formés au sein des institutions de la République d’Arménie est l’une des réalités qui avait le plus frappé Zareh Sinanian à sa nomination au poste de Haut-commissaire aux Affaires de la Diaspora en 2019. Trois ans plus tard, le Haut-commissariat s’est doté d’un brillant consultant en la personne de Nicolas Tavitian, ancien président de l’UGAB Europe et du Comité des Arméniens de Belgique, qui possède une grande expérience dans la promotion des liens entre l’Arménie, l’Union européenne et la diaspora arménienne. Nous l’avons rencontré pour en savoir plus sur son expérience en Arménie et sur ses domaines d’expertise.
« Nor Haratch » – Pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de votre parcours ?
Nicolas Tavitian – J’ai été pendant très longtemps membre du Comité des Arméniens de Belgique, qui est la structure représentative des Arméniens de Belgique. Professionnellement, j’étais dans les lobbys européens, notamment associatifs. Déjà, il y a vingt ans, je poussais pour que les Arméniens soient mieux représentés au niveau européen. Jusqu’en 2020, j’étais directeur de l’UGAB Europe, une structure qui collaborait avec les institutions européennes sur toute une série de projets. Le dernier d’entre eux, qui s’est achevé juste après que je sois parti, portait sur l’interpénétration de l’histoire européenne et arménienne au XXe siècle. Tous les épisodes du génocide et de ce qui s’est passé ensuite ont eu d’importantes répercussions sur l’histoire européenne, ce dont les Européens et même souvent les Arméniens ne sont pas forcément conscients. Je pense par exemple à Fridtjof Nansen, le créateur du Haut-Commissariat pour les réfugiés, qui a fondé cette structure en grande partie pour les réfugiés arméniens. Le mouvement humanitaire moderne de défense des réfugiés a principalement commencé avec les Arméniens. On peut aussi penser à Raphaël Lemkin, le juriste qui a inventé le terme et le concept de génocide. Il y a de nombreuses manières dont l’histoire des Arméniens a pénétré l’histoire européenne et qu’il faut faire revenir à la surface.
« NH » – Qu’est-ce qui vous a amené à vous engager auprès du Haut-commissariat aux Affaires de la Diaspora ?
N. T. – Il y a toutes sortes de raisons de venir travailler en Arménie, et notamment la volonté d’être présent sur place. J’ai travaillé longtemps sur la relation Arménie-Europe du point de vue européen, et plus spécialement bruxellois, et je voulais me placer de l’autre côté. Je tenais à voir comment le gouvernement arménien envisage ses relations avec la diaspora.
« NH » – Quelles sont les principales missions du Haut-Commissariat ?
N. T. – Le Haut-Commissariat a toute une gamme d’activités, mais pour simplifier, on peut distinguer quatre grandes missions. La première, c’est le rapatriement. L’un des objectifs est de faire revenir – ou simplement venir – en Arménie les Arméniens de la diaspora, car c’est un pays où l’on peut vivre par patriotisme, mais aussi où la qualité de la vie pour ceux qui ont du travail n’est pas mauvaise du tout. La deuxième, c’est la contribution des Arméniens de la diaspora au développement de l’Arménie par leur expertise. Pendant et après la guerre, de nombreux médecins sont venus aider à soigner les victimes de la guerre et les réfugiés. Il y a également un grand nombre d’ONG de la diaspora qui contribuent au développement de l’Arménie par des projets humanitaires ou dans le domaine de la santé. La diaspora peut et doit contribuer à la sécurité de l’Arménie, notamment par le travail de lobbying. Je crois qu’il y a une réflexion profonde à mener sur la manière dont la diaspora peut améliorer son impact à la fois dans le domaine du soft power, mais aussi par sa contribution directe en matière d’expertise à la sécurité de l’Arménie sur le plan technologique et militaire. Enfin, le Haut-Commissariat a aussi vocation à soutenir la diaspora. La diaspora a une vie propre et n’est pas seulement orientée vers l’Arménie. Dans ce domaine, les forces de l’Arménie sont limitées, mais elle possède néanmoins des capacités qu’elle peut utiliser pour donner un élan et une énergie à la diaspora.
« NH » – Pour en revenir à la question du lobbying, on ne connaît pas vraiment bien les structures qui se chargent de cette mission en Europe. Aux Etats-Unis, on connaît l’ANCA (Armenian National Committee of America) qui fait depuis longtemps du lobbying et qui a enregistré de grands succès. Comment est structuré le lobby arménien en Europe et quels succès a-t-il enregistrés ?
N. T. – Au cours des vingt dernières années, nous n’avons pas fait autant que nous aurions pu au niveau européen. Il y a un lobby qui existe depuis quasiment vingt ans, c’est la Fédération euro-arménienne pour la justice et la démocratie (EAFJD), le lobby de la FRA Tachnagtsoutioun. Des Arméniens d’Arménie ont aussi créé un lobby il y a une dizaine d’années qui s’appelle EU Friends of Armenia, qui est un lobby non-arménien en soutien à l’Arménie. Non-Arménien dans le sens où les personnes qui gèrent la structure ne sont pas Arméniens. Et puis il y a l’UGAB qui en plus de travailler sur différents tableaux (humanitaire, développement de l’Arménie, éducation, etc) fait aussi du lobbying. Par exemple, c’est l’Ugab Europe qui a obtenu que le Parlement européen commémore formellement le génocide en 2015 avec une résolution commémorative et une séance consacrée au centenaire du génocide. A présent, EU Friends of Armenia s’est beaucoup affaibli (depuis 2018) et l’UGAB Europe ne fait plus de lobbying du tout. Il ne reste donc plus que la Fédération euro-arménienne pour la justice et la démocratie, l’équivalent du CDCA en Europe. Cependant, je pense que nous avons d’urgence besoin d’un réel lobby au niveau européen qui doit être coordonné avec les experts nationaux. Nous ne pourrons pas avoir d’influence à Bruxelles si nous ne sommes pas coordonnés efficacement avec les structures représentatives des communautés. Il nous faudrait aussi un lobby en Allemagne, où nous sommes très peu organisés au niveau fédéral. Il faudrait au moins que nous soyons présents dans les grands pays européens avec des lobbys efficaces, professionnels et pragmatiques. Personnellement, je pense qu’il faut oublier l’idée de cause arménienne, car c’est un terme vague qui est basé sur la moralité, l’idée de la justice. Aujourd’hui, nous devons formuler nos objectifs dans des termes politiques clairs, en intégrant la justice dans l’argumentation. Nous devons nous demander quelles relations nous souhaitons que la France ou l’Allemagne entretiennent avec l’Arménie. La politique, c’est de l’action. Ce n’est pas une expression de moralité ou de solidarité. Les institutions européennes et de plusieurs pays reconnaissent le génocide. Il faut s’en féliciter, mais ce n’est pas un but en soi. C’est juste un élément de discours qui peut nous faire avancer vers un but concret et il faut d’urgence que nous mettions en avant nos objectifs.
« NH » – Vous êtes originaire de Belgique, qui est l’un des pays centraux de l’Union européenne. Pourriez-vous nous parler des aspects économique et politique des relations Arménie-Belgique ?
N. T. – Il fut un temps où la Belgique, au sein de l’Union européenne, était le principal partenaire économique de l’Arménie. Cela était dû en grande partie au commerce des diamants avec la ville d’Anvers. Les diamants étaient envoyés pour en Arménie pour la taille et renvoyés ensuite en Belgique, ce qui faisait beaucoup d’exportation et d’importation. Mais en réalité les relations économiques ne sont pas aussi intenses que les statistiques le suggèrent. Nous souhaitons les développer et il existe pour cela une structure qui s’appelle la Chambre de commerce belgo-arménienne qui organise notamment des visites d’investisseurs potentiels en Arménie. Mais dans les faits, l’Arménie n’est pas une priorité du commerce extérieur de la Belgique et malheureusement, cela se manifeste par le fait qu’il n’y a toujours pas ici à Erevan d’ambassade de Belgique, ni même de consulat.
Sur les questions politiques, le gouvernement belge s’aligne sur l’Europe. Pendant la guerre, nous avons obtenu du Parlement, qui soutient très fortement la communauté arménienne de Belgique, de s’exprimer très clairement pour condamner l’agression de l’Azerbaïdjan et de la Turquie. À d’autres occasions aussi, le parlement nous a soutenu : il a par exemple reconnu le génocide des Arméniens en 1998, avant la France. Mais très souvent ce soutien ne se retrouve pas au sein de l’exécutif. Pendant la guerre de 2020, le ministère des Affaires étrangères s’est juste aligné derrière l’Europe avec des paroles assez plates regrettant la guerre et appelant à la paix, mais sans pointer du doigt l’agresseur, ni les crimes de guerre. Le ministère des Affaires étrangères a été très décevant et même après la guerre, lorsque nous lui avons demandé son appui au sein des institutions européennes pour obtenir le retour des prisonniers de guerre, il a refusé d’agir. Même pour une question aussi élémentaire et aussi non-partisane, le gouvernement belge n’a pas souhaité intervenir. Il faut cependant mentionner le fait que l’actuel président du Conseil de l’Europe, Charles Michel, est un ancien Premier ministre et c’est sous son mandat que le génocide a été reconnu par l’exécutif.
« NH » – Justement, quel est votre point de vue sur les actuels pourparlers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous l’égide de Charles Michel ?
N. T. – L’Union européenne reste très prudente dans ce dossier. Elle ne s’est absolument pas engagée pendant la guerre, ni même après, et ce jusqu’au début de cette année et le conflit en Ukraine. Il est assez probable que son implication ait à voir avec la rivalité avec la Russie, puisque le groupe de Minsk est de facto dissous dans les conditions actuelles. Il y avait donc une forme de vide institutionnel que l’Union européenne a essayé de remplir. Et je pense qu’effectivement, il doit y avoir la volonté de l’UE d’augmenter son influence dans la région en profitant du fait que la Russie est engagée militairement en Ukraine. Malgré cet aspect géostratégique, je voudrais penser qu’il y a aussi une volonté d’avancer vers une résolution des différents aspects du conflit. Charles Michel, dans ses médiations, ne prétend pas avancer sur la question du statut du Karabagh, mais il compte faire avancer les négociations sur la délimitation de la frontière. Cela dit l’Histoire nous montre qu’on ne peut pas faire confiance à l’Union européenne. Sa capacité à s’affirmer dans la région est très faible et elle est très vulnérable aux pressions venant de l’extérieur, que ce soit de l’Azerbaïdjan, de la Turquie, des États-Unis ou de certains de ses Etats membres. Je considère que cette solution est provisoire en attendant que les réels acteurs de la région se réaffirment.
Propos recueillis par
Achod PAPASIAN