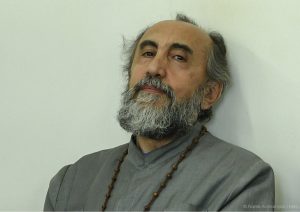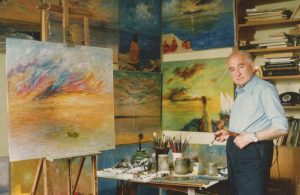Il est des auteurs dont le nom vous hante durant des années, jusqu’au jour où l’occasion se présente de les connaître enfin de plus près. Le 21 juin, grâce à l’Institut de recherche en sciences humaines Ashot Johannissyan, les amoureux de la littérature arménienne ont ainsi pu découvrir la vie et l’œuvre de Zaven Biberian à travers le regard expert et passionné de Gérard Malkassian.
« Nor Haratch » – Pour commencer, pourriez-vous nous présenter votre parcours personnel, à la croisée de la philosophie et de la littérature arménienne ?
Gérard Malkassian – De profession, je suis enseignant de philosophie, principalement au lycée, mais aussi depuis quelques années dans les classes préparatoires aux grandes écoles. En parallèle, je m’intéresse depuis longtemps aux questions culturelles et littéraires arméniennes, notamment par le biais des Conférences du salon que j’organise depuis une dizaine d’années à la Maison des étudiants arméniens de la Cité universitaire. Malheureusement, ces conférences sont interrompues depuis la crise du Covid et j’attends le retour de conditions normales pour pouvoir reprendre ses rendez-vous qui attiraient un public très varié. Je pense qu’il y a un certain besoin dans la communauté arménienne de France pour les réunions de ce type où l’on peut parler des différents aspects des littératures arméniennes ou d’autres formes d’expression culturelle et artistique.
« NH » – Votre conférence, intitulée « Zaven Biberian, l’intellectuel de la société majoritaire et de la minorité opprimée », met à l’honneur un auteur de la diaspora qui reste encore méconnu à ce jour. Qu’est-ce qui vous a poussé à étudier plus en profondeur son œuvre ?
G. M. – Avant toute chose, je voudrais dire quelques mots sur l’Institut Johannissyan, car c’est l’un des rares instituts à vocation philosophique, spécialisé dans les sciences humaines, qui a été créé il y a quelques années en Arménie par des jeunes chercheurs en philosophie et en histoire de la littérature. Il regroupe tout un ensemble de jeunes passionnés qui travaillent sur divers thèmes de la pensée et de la culture arménienne, à la fois au passé et au présent. Ils essayent de constituer une sorte de patrimoine intellectuel arménien. La preuve en est qu’ils m’ont demandé de faire un exposé sur Zaven Biberian, un auteur qui n’est que peu connu en Arménie, et d’ailleurs pas beaucoup plus en diaspora.
Je me suis intéressé à Zaven Biberian, car il fait partie des auteurs qui présentent des aspects très originaux. Tout d’abord, c’est un auteur de Turquie de la communauté arménienne d’Istanbul et à l’époque, par la force des choses, il n’y en a évidemment plus beaucoup. Les quelques grands auteurs qui pouvaient transmettre une forme de tradition et de lien avec les générations à venir – comme Zabelle Yessayan ou Hagop Ochagan – sont tous partis après la victoire de Mustafa Kemal. Il ne restait alors plus qu’une communauté réduite avec quelques auteurs dont les poètes Zahrad et Zareh Khrakhuni. Mais Zaven reste une perle rare, car c’est un romancier authentique qui a le talent de raconter des histoires, ce qui n’est pas si courant dans la littérature arménienne. Comme beaucoup, j’ai découvert son œuvre avec son dernier roman « Le Crépuscule des fourmis », paru en feuilleton de son vivant et publié au complet au moment de sa mort en 1984.
« NH » – Lors de la conférence, vous avez mentionné qu’il a fait une partie de ses études dans une école française. Selon vous, est-ce que la littérature française a pu influencer son regard de romancier ?
G. M. – Incontestablement. D’ailleurs, il ne s’en cachait pas. Zaven Biberian n’a fait que l’école primaire en langue arménienne, avant de faire le collège et le lycée en français au lycée Saint-Joseph, un collège de frères lasalliens situé à Kadıköy. C’est donc par le français qu’il s’est formé à la littérature. D’ailleurs, ses premières tentatives d’écriture à l’adolescence et jusqu’à ses 25 ans se feront en français et il va finalement se tourner vers l’arménien lors de son « service militaire », pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l’armée turque. A l’époque, les non-musulmans étaient systématiquement envoyés dans ces brigades de travail forcé. C’est à ce moment-là que va s’opérer la transition vers l’écriture en arménien, une transition un peu contrainte et forcée. Biberian semblait regretter de ne pas avoir pu devenir un auteur de langue française. En tout cas, son regard littéraire a été grandement façonné par les auteurs français, et plus particulièrement par l’œuvre de Gustave Flaubert.
« NH » – Quelles sont les principales thématiques qu’il aborde dans ses romans ?
G. M. – Dans l’œuvre de Biberian, les personnages se trouvent toujours au croisement de communautés et d’institutions extrêmement diverses qui pèsent sur leurs conditions de vie, leur conscience et leurs désirs. On retrouve toujours cette tension entre l’individu, ses aspirations, son désir d’une vie intense et les contraintes sociales qui pèsent sur lui. Le personnage est contraint de faire face à des relations conflictuelles au niveau de la famille, des diverses nationalités et des réalités sociales et économiques.
La thématique des liens familiaux est centrale dans ses romans. Biberian montre qu’il est très difficile de mener une vie heureuse en famille, car elle est elle-même constituée sur des liens de domination et de dépendance qui empêchent la construction autonome de l’individu et sa capacité à nouer des liens avec les autres.
Un autre thème est celui de l’opposition entre la civilisation soumise à l’économie capitaliste. N’oublions pas que Zaven était plutôt proche des milieux communistes en Turquie. Ses personnages sont souvent à la recherche d’îlots de liberté et de tranquillité, recherche souvent vaine, car Zaven est un auteur réaliste. Cependant, il aspire à travers ses œuvres à un univers proche de la nature, libéré des contraintes sociales économiques et des luttes de pouvoir qui vont avec.
« NH » – Dans la seconde partie de sa vie, Zaven Biberian a commencé à s’engager dans les luttes politiques et sociales, notamment par le biais du journalisme. Pourriez-vous nous parler de sa contribution dans ce domaine ?
G. M. – En effet, Zaven Biberian était un journaliste à la plus acérée qui s’est engagé dans la presse dès les années 1945, au retour de son service militaire. Il va collaborer avec de multiples journaux, en particulier « Jamanag » (le plus ancien quotidien de Turquie fondé en 1908 au moment de la révolution constitutionnel), puis plus tard avec « Marmara ». Il va écrire des articles qui vont lui coûter des déboires, et même de l’emprisonnement, au point qu’il émigre en 1949 et tente sa chance à Beyrouth. Cependant, c’est pour lui une expérience qui va être désastreuse. Il est extrêmement déçu par l’attitude des Arméniens de diaspora, quel que soit leur bord politique, même ceux qui sont proches de son camp, c’est-à-dire les gens du parti Hentchag et Ramgavar. Il est très déçu par l’accueil qu’il reçoit et l’exploitation qu’il subit de la part de la communauté arménienne. Tout cela peut expliquer pourquoi il revient à Istanbul en 1953. Désormais, il fera sa vie à Istanbul et ne cherchera plus à émigrer ailleurs. Cela peut aussi expliquer pourquoi il va ensuite s’engager dans la vie politique turque, puisqu’il va être élu au conseil municipal d’Istanbul pour le compte du Parti turc des travailleurs. Et en parallèle, il continuera son activité de journalisme dans la presse arménienne, mais aussi turque. A ce propos, il faut aussi préciser qu’il a traduit un certain nombre d’œuvres de littérature étrangère en turc, dont notamment l’œuvre de Flaubert.
« NH » – L’œuvre de Zaven Biberian est-elle lue et traduite aujourd’hui en Turquie ?
G. M. – Tout d’abord, il faut préciser que nous avons la chance en France de pouvoir lire plusieurs de ses textes en français. Une de ses nouvelles, « Le fils de son père » a été traduite dans l’ouvrage « Nos terres d’enfance : l’Arménie des souvenirs », une anthologie compilée par Anahide Ter Minassian et Houri Varjabédian aux éditions Parenthèses. Ce texte s’appuie d’ailleurs sur ses souvenirs scolaires au lycée français, où il semblerait avoir subi une forte ségrégation sociale, car il était issu d’un milieu modeste. Et grâce à Hervé Georgelin, historien et traducteur du grec et de l’arménien, nous disposons de la traduction en français de son roman phare, « Le Crépuscule des fourmis », mais également de son premier roman, « La Traînée ». En Turquie, autant que je sache, un processus est en cours pour la diffusion des œuvres de Zaven Biberien. Il faut dire que lui-même avait commencé, car il a traduit l’un de ses premiers romans « La Traînée » en 1966, mais sous un titre différent, « Les Esseulés ». Ses autres romans ont été publiés en arménien par les éditions Aras ou bien sont en cours de traduction vers le turc. L’accessibilité de son œuvre en Turquie est en train de se construire, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour qu’un lectorat turc assez large s’intéresse à cet auteur qui, je pense, leur parlera de manière très forte. Il faut bien dire que l’évolution de la situation politique en Turquie depuis le coup d’Etat manqué de 2016 a quand même beaucoup compliqué les choses dans le domaine culturel en Turquie. Pour finir, précisons que grâce à Zaven lui-même, nous avons aussi en français une autobiographie qu’il a écrite en français dans les années 1960. C’est un document passionnant qui est longtemps resté inédit, jusqu’à ce que Hervé Georgelin réussisse à l’acquérir et à le faire publier aux éditions Aras.
Propos recueillis par
Achod PAPASIAN