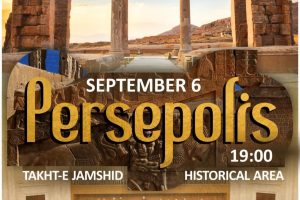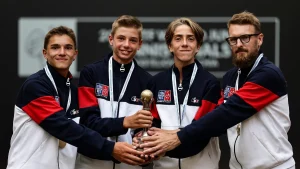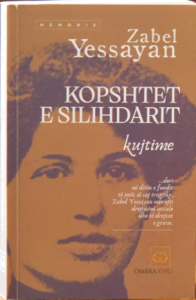En septembre dernier, l’ouvrage « Jérusalem et les Arméniens » (518 pages) d’Armen-Claude Mutafian est paru aux éditions Les Belles Lettres grâce, entre autres, à une subvention de la Fondation Calouste Gulbenkian. À l’heure actuelle, Jérusalem est le plus important conservatoire de la culture arménienne hors d’Arménie. Présentant les relations arméno-hiérosolymitaines dans leur contexte historique et artistique, ce livre en est un reflet. L’iconographie d’une grande richesse n’est pas cantonnée ici à un rôle illustratif : les images deviennent l’élément principal, la trame du livre, guidant le texte qui se trouve essentiellement dans les légendes. Le point culminant du livre est atteint avec l’exceptionnelle production de l’Arménie cilicienne, dont les miniatures sont unanimement considérées comme les chefs-d’oeuvre du genre.
« Nor Haratch » – Votre dernier ouvrage, « Jérusalem et les Arméniens », présente l’histoire des Arméniens à Jérusalem. À toutes les époques, Jérusalem a joué un rôle important dans notre histoire. Elle a toujours été une source d’inspiration et de richesse spirituelle pour notre peuple. À travers près d’un millier d’illustrations, vous avez tenté de « faire parler » l’histoire de la présence arménienne, de Tigrane le Grand jusqu’à la fondation de l’Empire ottoman. Selon vous, dans quelle mesure la publication d’un tel livre est-elle importante ?
Armen-Claude Mutafian – Elle est importante, parce qu’il y a tellement de récits déformés au sujet de Jérusalem que j’ai voulu présenter la réalité historique plus en détail et d’un point de vue scientifique, jusqu’à l’an 1516, car après c’est une autre histoire que je maîtrise moins.
Très tôt, Jérusalem est devenue un centre de la culture et de la foi arméniennes. Aujourd’hui encore, en dehors de l’Arménie, c’est la réserve culturelle la plus riche, à tout point de vue : documents, manuscrits, inscriptions, etc. Le principe de ce livre est l’illustration, c’est-à-dire que j’explique l’histoire par les images. Par exemple, au lieu de transcrire ce qu’un historien a écrit, je le montre par le biais d’un manuscrit, accompagné de sa traduction, des conditions de sa rédaction, de notes… C’est comme une bande dessinée, où l’image joue le rôle central.
J’ai aussi beaucoup utilisé les écrits des voyageurs européens. Ce qui est intéressant, c’est qu’à partir du Xe siècle, ces voyageurs consacraient toujours un chapitre important aux Arméniens dans leurs écrits. C’est en venant sur place qu’ils découvraient l’importance des Arméniens. Ainsi, le premier alphabet arménien jamais imprimé est dû à un voyageur allemand qui l’a appris à Jérusalem. Ici, je voudrais mentionner un fait. Le vieux quartier de Jérusalem est divisé selon les cultes. Par conséquent, il devait y avoir trois quartiers : musulman, juif et chrétien. Mais en fait, il n’y a pas trois mais quatre quartiers, car il y a aussi le quartier arménien, qui est différent du quartier chrétien, et c’est en soi une preuve de l’importance des Arméniens qui, bien que chrétiens, ont leur quartier séparé. Et ce quartier existe toujours.
N’oublions pas que c’est grâce aux croisés que le dernier royaume d’Arménie a pu exister, en Cilicie, et que la cible de ces derniers était Jérusalem. Dans le sillage de la première croisade, les Arméniens ont réussi à établir une principauté en Cilicie, et en profitant de la troisième croisade, le prince Léon II a pu être couronné en 1198 et devenir le roi Léon Ier. Sur les pièces à son effigie, on peut lire « Léon, roi de toute l’Arménie ».
« NH » – Dans quel document les Arméniens à Jérusalem sont-ils mentionnés pour la première fois ?
A.-C. M. – Autant que je sache, la première mention des Arméniens se trouve dans un document en latin daté de 386 rédigé par une prêtresse nommée Paola, qui est enterrée à Bethléem. Elle y mentionne les peuples vivant à Jérusalem. Les Arméniens occupent la première place dans cette liste.
Depuis le IVe siècle, Jérusalem a joué un grand rôle dans la vie des Arméniens. Lorsque le royaume franc a été établi en 1099, les deux premières reines étaient des princesses arméniennes, et la troisième était arménienne par sa mère, la célèbre reine Mélisende. Puis il y a eu des mariages mixtes de princes arméniens avec des princesses latines. Les princes arméniens entretenaient des relations très étroites avec le royaume de Chypre, qui appartenait à la maison de Lusignan. Tous deux étaient des États chrétiens entourés de musulmans. En 1187, Saladin a reconquis la Palestine, le roi Richard Cœur de Lion d’Angleterre est parvenu à en reprendre une partie, mais pas Jérusalem, et un nouveau « Royaume de Jérusalem »
fut établi, sans Jérusalem. Puis, en 1291, les Mamelouks mirent définitivement fin à la présence latine en Palestine. Ainsi, deux « îlots chrétiens » subsistaient alors au Levant : l’Arménie cilicienne et Chypre. Deux des rois d’Arménie étaient issus de la maison de Lusignan : Guy de Lusignan, en 1342, et le dernier roi, Léon V Lusignan. La ville de Sis est tombée en 1375, et Léon V est mort en France. Son cénotaphe se trouve dans la basilique de Saint-Denis. Son titre royal passa à ses parents, les rois de Chypre, qui avaient déjà hérité du titre de « rois de Jérusalem ». Ils furent donc nommés « rois de Chypre, de Jérusalem et d’Arménie » jusqu’en 1489, date à laquelle la dernière reine, Catherine Cornaro, une princesse vénitienne, a été forcée de céder ses titres au doge de Venise. Elle est enterrée à Venise et l’inscription sur sa tombe se lit : « Cendres de Catherine Cornaro, reine de Chypre, de Jérusalem et d’Arménie ». Son titre fut transmis à Charlotte, la sœur de son mari, qui épousa un prince de Savoie, et il passa ainsi à la future maison royale d’Italie. En d’autres termes, jusqu’au début du XXe siècle, le titre de « Roi de Jérusalem, de Chypre et d’Arménie » était toujours mentionné. Il est vrai que ce n’était plus qu’un titre, mais c’est ainsi.
« NH » – Le Patriarcat de Jérusalem a également joué un rôle important dans la publication de votre ouvrage…
A.-C. M. – À vrai dire, j’ai essayé de résoudre le problème de la fondation du Patriarcat de Jérusalem, mais il n’y a pas d’indice suffisant. En tout cas, il est clair que le patriarcat existait déjà aux XIIe-XIIIe siècles. De nombreux patriarches habiles et intelligents ont réussi à collecter les trésors. Par exemple, près de 3 000 manuscrits sont stockés dans la collection de Jérusalem. Dans le monde entier, il existe sept œuvres de Toros Roslin (XIIIe siècle, le plus grand miniaturiste arménien), dont quatre se trouvent à Jérusalem. Il existe également de nombreux autres documents, dont le très intéressant firman (décret) de Saladin. Lorsqu’il s’empara de Jérusalem en 1187, il publia un décret en arabe sur un très long parchemin, assurant qu’il n’opprimerait pas les Arméniens. Pourquoi ? Parce que ses ennemis étaient les Grecs et les Latins, qui étaient les États puissants à l’époque. Dès lors, les autres minorités – les Coptes, les Arméniens, les Assyriens, … – ne constituaient pas une menace et il a préféré les épargner pour ne pas se les mettre à dos.
Il y a aussi des inscriptions très intéressantes, et la preuve de loin la plus importante de la présence arménienne sont les mosaïques avec inscriptions arméniennes datant du VIe siècle retrouvées à Jérusalem. Parmi elles, on peut citer la mosaïque « Mousrara » à la porte de Damas qui a récemment été déplacée dans le futur musée arménien. Il s’agit d’une pièce inestimable.
« NH » – À partir de quand les historiens arméniens mentionnent-ils la présence arménienne à Jérusalem ?
A.-C. M. – Il y a des mentions datant d’un passé lointain. Dans le premier chapitre de mon livre, je parle de Tigrane le Grand, qui se dirigeait vers Jérusalem, mais les Romains ont attaqué l’Arménie et il a été contraint de rebrousser chemin. Les historiens arméniens affirment qu’à l’époque, il y avait déjà des traces de présence arménienne à Jérusalem.
« NH » – Y avait-il une rivalité entre Jérusalem et Etchmiadzine ?
A.-C. M. – On peut dire que ces problèmes sont apparus essentiellement à la période ottomane. À Jérusalem, les Arméniens ont eu des frictions avec les autres chrétiens, Grecs, Latins et Géorgiens, notamment en ce qui concerne le partage des Lieux Saints. Donnons un exemple. Les Mamelouks, venus d’Asie centrale, avaient développé des relations étroites avec le royaume de Géorgie. Alors qu’ils régnaient sur Jérusalem, les Géorgiens étaient pour eux les chrétiens les plus proches. Ces derniers ont utilisé leur position pour obtenir des avantages. Par exemple, dans l’église du Saint-Sépulcre, il y a le célèbre Golgotha, une chapelle appartenant aux Arméniens. Les Géorgiens ont réussi à convaincre le sultan mamelouk de le leur céder. Par la suite, le patriarche arménien s’est rendu au Caire, où il a obtenu l’autorisation de construire une autre chapelle au-dessus de celle-ci, le second Golgotha, qui appartient toujours aux Arméniens.
« NH » – L’une des motivations pour la publication de votre ouvrage est liée à la fondation du musée arménien de Jérusalem…
A.-C. M. – En effet. Jusque-là, le musée du patriarcat était en piteux état et a été obligé de fermer à la fin du siècle dernier. Puis la décision a été prise d’en ouvrir un nouveau. L’inauguration est prévue pour le 23 octobre. J’ai moi-même répertorié les artefacts qui vont être exposés, jusqu’à la période de l’Empire ottoman. L’historien Haroutioun Kevorkian s’est occupé de la période ottomane et postérieure, et le muséographe Harout Bezdjian a mené un travail pratique énorme pour organiser le musée.
En ce qui concerne la publication de ce volume, je dois dire qu’à cause de la pandémie, il m’a été impossible de me rendre à Jérusalem ou ailleurs pendant environ deux ans et demi. Entre-temps, j’ai donc travaillé dans mon bureau et j’ai accumulé tellement de matériel que même un dixième de tout cela n’aurait pas pu être présenté dans un musée. J’ai donc décidé d’en faire un livre.
« NH » – Ce volume est aussi le fruit d’une coopération et de la contribution de divers spécialistes…
A.-C. M. – Bien sûr. J’étais en contact permanent avec des spécialistes d’Europe, d’Amérique et, bien sûr, d’Arménie par téléphone ou par e- mail.
« NH » – Le volume s’adresse à la fois aux Arméniens et aux personnes intéressées plus généralement par Jérusalem…
A.-C. M. – En effet. L’objectif est de transmettre au grand public des informations historiques sur les Arméniens de Jérusalem.
Propos recueillis par
Jiraïr TCHOLAKIAN