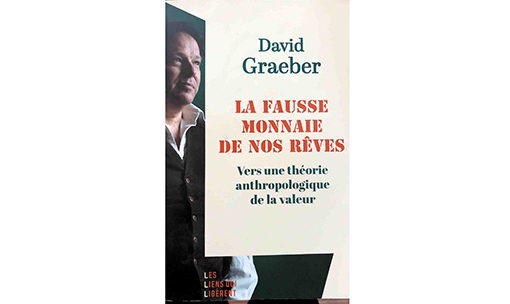David GRAEBER – La fausse monnaie de nos rêves
(vers une théorie anthropologique de la valeur)
(trad. Morgane Iserte)
Les liens qui libèrent, 2022,
457 p., 26,00€
David Graeber (1961-2020), anthropologue et économiste, professeur à la London school of Economics, penseur radical engagé dans Occupy Wallstreet, avait dénoncé les « bullshit jobs » (ou « jobs à la con », titre de l’un de ses livres) et le rôle de la bureaucratie comme rouage des machines de pouvoir visant à nous dérober du temps. Dans un volume enfin traduit (avec vingt ans de retard), Graeber propose une réflexion sur la notion fondamentale de la « valeur ».
Il y a peu la Présidente de la Commission européenne, non élue, Mme von der Leyen prétendait défendre les « valeurs européennes » tout en affirmant dans le même temps que le Président Aliev (Azerbaïdjan) est un « partenaire fiable » pour aider l’U.E. à résoudre les problèmes d’approvisionnement en énergie qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’affirmation de la Présidente von der Leyen révèle la force du langage, puisque l’énonciation par une personne détentrice d’autorité aura suffi à transformer in ictu oculi une dictature pro-génocidaire en partenaire de « valeurs » dites européennes, à savoir la démocratie reposant sur l’état de droit, garantissant les droits de l’homme, etc.
Le livre de Graeber maintient donc son actualité et la gardera puisqu’au fondement du pouvoir réside toujours la question de la valeur. L’auteur souligne, à la suite de l’anthropologue Terence Turner (1935-2015) que « l’enjeu ultime de la politique n’est même pas la lutte pour l’appropriation de la valeur, mais la lutte pour établir ce qu’est la valeur ». Qu’entend-on dès lors par le terme « valeur(s) » ? N’est-ce pas la croyance en la performativité du mot « valeur » lui-même ? D’où la nécessité de percer le mécanisme de cette croyance qui produit « la fausse monnaie de nos rêves », expression faisant référence au célèbre Essai sur le don de Marcel Mauss (1872-1950), auquel Graeber consacre un volumineux chapitre. Relisant Marx et Mauss, Graeber, scrute le néo-libéralisme en tant que créateur d’une « valeur-étalon » à laquelle absolument tout sur la planète a été assujetti. Le livre soutient une critique du capitalisme et de l’individualisme qui lui est inhérent, comme mécanisme de sa propre reproduction et de son maintien.
Le début du livre nous présente un parcours historique des différents courants théoriques en anthropologie, en sciences sociales ou humaines, en passant parfois par l’économie (les survols s’avèrent parfois caricaturaux en ce qui concerne la philosophie et la psychanalyse). Si les différentes théories anthropologiques (fonctionnaliste, économiste, structuraliste, post-structuraliste) ont échoué à définir ce qu’il en est de la « valeur », elles n’en perdent pas pour autant tout intérêt. On apprend des échecs. Ainsi, Graeber s’intéresse-il à l’idée de Karl Polanyi (1944) pour qui « les conditions de ce qui est aujourd’hui considéré comme une vie économique normale sont une pure création du pouvoir d’État ». Graeber relit Georg Simmel et sa Philosophie de l’argent (1907) ; il rappelle la notion « de biens inaliénables » par laquelle Annette Weiner (1933-1997) définissait les objets détenant une valeur transcendantale. La conservation de ceux-ci relevait selon elle de l’exploit car cela équivaut à « entretenir une image d’éternité ». On peut aujourd’hui penser aux monuments de l’Artsakh…
Les théories critiques de la société n’aboutissent en général qu’à des conclusions pessimistes ou aporétiques car elles s’attachent à ne repérer que des structures cachées dans les formes de pouvoir, affirme Graeber. Il se veut plus positif et pense, d’une part, qu’il peut encore exister de « bonnes intentions » et de l’ « intégrité » et, d’autre part, qu’il est possible de concevoir un matérialisme qui partirait « du principe que la société émerge de l’action créatrice, mais que cette action ne peut jamais être séparée de ses moyens concrets et matériels de réalisation ». Loin de revendiquer l’utopique rupture radicale, Graeber demande : comment trouver des mécanismes de régulation les moins coercitifs possibles ? Il propose d’appréhender « les systèmes sociaux comme des structures d’action créatrice, et la valeur comme la façon dont les personnes mesurent la portée de leurs propres actions au sein de ces structures ». Graeber nous mène vers la question du sens de la vie, il nous invite à penser la liberté comme autre chose qu’un choix de consommation individuel qui ne ferait que reproduire la logique du marché.
Tout chez Graeber tourne autour de l’action et non des choses. Il oppose deux perspectives qu’il reprend à l’antiquité grecque : celle de Parménide et celle d’Héraclite. La fixité des choses d’un côté, le mouvement permanent de l’autre (on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite). Nos sociétés – nos théories – ont, selon lui, choisi la voie parménidienne, pensant en blocs stables. La perspective héraclitienne correspond à une pensée marginale, à un « courant alternatif » qui récuse le point de vue totalisant et dominant sur les choses, à l’instar du « réalisme critique » développé par le philosophe des sciences, Roy Bhaskar (1944-2014). Graeber, on l’aura compris, a choisi la voie héraclitéenne et recourt (il ne se prive pas de digressions) à ses analyses anthropologiques faites sur le terrain (le ‘wampum’ des Iroquois ou le ‘hasina’ à Madagascar) pour susciter une réflexion sur le fétiche, la magie, ou certains rituels, nous permettant non pas de trouver un modèle de société mais d’imaginer des actions et des possibilités d’action.
Le « wampum », collier tissé à base de morceaux de coquillage, constitue une monnaie d’échange utilisée par les cinq nations d’Iroquois, et détient selon lui « un intérêt potentiellement énorme pour toute théorie de la valeur ». Créé par les Pequot du Connecticut, massacrés par les colons anglais en 1637, ce collier, adopté par les Iroquois, fonctionne comme insigne, il marque la réincarnation du nom d’un défunt par le porteur du collier. Il revêt une dimension abstraite en tant que médiateur pour la paix et une dimension concrète d’artefact en tant que monnaie d’échange dans le commerce des fourrures avec les marchands européens. Le wampum apparaît comme le rouage essentiel du fonctionnement de la société dans son rapport au cosmos, mais aussi au langage : les motifs mnémotechniques tissés dans le collier de perles rendent visible le discours de paix du locuteur.
Le hasina rituel lié au pouvoir du souverain à Madagascar, montre quant à lui l’acceptation collective d’une fiction – celle de la marque divine du roi – à laquelle personne ne croit mais qui permet de connecter la société à l’action et à une transcendance nécessaire au maintien de la société. Ainsi, la « magie » permet-elle de saisir que « le pouvoir est cette capacité de convaincre les autres que vous en êtes détenteur (en cas contraire, il consiste largement dans l’aptitude à les convaincre que vous devriez l’être) ».
Ces deux exemples nous invitent à regarder les actions comme étant englobées dans un système plus vaste qui leur procure une valeur sociale indissociable de la valeur symbolique. Domination, beauté, honneur, prestige, importance de la « reconnaissance publique » et donc de la participation au processus qui met en mouvement la société (la coordination des activités) dépassent la gratification individuelle : « c’est la raison pour laquelle les modèles économiques, qui considèrent que ces actions visent avant tout la gratification individuelle, restent bien en-deçà de la réalité : ils ne voient pas que dans toute société – y compris dans un système de marché – les plaisirs solitaires sont relativement rares. Les objectifs les plus importants sont ceux qui ne peuvent être réalisés qu’aux yeux d’un public ».
Graeber s’attaque à la justification de l’individualisme de la société occidentale fondée sur l’idée qu’un désir insatiable animerait l’humain et engendrerait nécessairement la concurrence entre les individus. Cette perspective ‘parménidienne’ mène à une opposition insoluble entre la forme sociale et la motivation individuelle. La société de marché prétend contrebalancer ces principes individualistes par des valeurs familiales ou religieuses, mais il n’y a là que les deux côtés de la « fausse monnaie » d’un bonheur dépendant de nos rapports avec les objets (ou les personnes réifiées).
Alors que la valeur dans l’économie de marché se trouve liée à une certaine conception du « désir » (on désire ce qui a de la « valeur ») essentiellement ancré dans une vision individualiste (on peut penser au narcissisme de nos sociétés déjà dénoncé par Christopher Lasch (1932-1994) il y a plus d’un demi-siècle), Graeber propose de se tourner plutôt ver le « plaisir » en pensant à l’économie du don de Marcel Mauss. Au plaisir solitaire du consommateur, il veut substituer le plaisir du don propre à l’acte créateur. Il n’y a pas de don sans un effacement de soi, mais c’est justement cette portion d’effacement qui nous ouvre la possibilité d’une connexion au réel, à ce qui nous dépasse.
Chakè MATOSSIAN