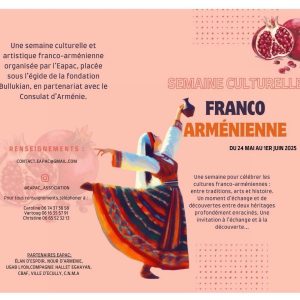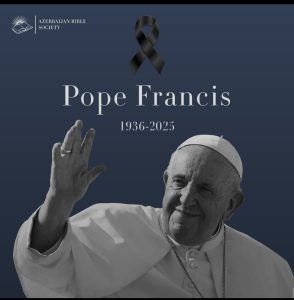– La réticence est mauvaise conseillère –
par Marc DAVO
Comme annoncé, Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a effectué une visite dans la sous-région, Bakou puis Erevan (27/28 avril) et enfin Tbilissi. En Arménie, elle et sa délégation ont été reçues au plus haut niveau (N. Pachinian, A. Mirzoyan, A. Grigorian, …). La ministre a également tenu à se rendre à Jermuk, pour voir sur le terrain les conséquences de la dernière agression azérie (septembre 2022). Le chef d’état-major de l’armée, le Général Edouard Asrian, présent sur place à l’occasion, lui a fourni personnellement des explications nécessaires. Lors de ses interviews et de la conférence de presse conjointe avec le ministre Mirzoyan, Mme Colonna a réitéré le soutien de la France à la souveraineté de l’Etat arménien et a rappelé la nécessité de la mise en oeuvre de la décision de la Cour internationale de Justice concernant l’ouverture du corridor de Latchine. Elle a précisé que la France avait œuvré en faveur de la mise en place de la Mission civile des observateurs de l’UE (Union européenne) en Arménie et son renouvellement dans une version élargie et pour plus longtemps.
>>> Volonté de consolider la position française en Arménie
Tout compte fait, la ministre Colonna n’a rien annoncé de nouveau publiquement si ce n’est l’ouverture d’une mission militaire près l’Ambassade de France (c’est-à-dire la création d’un poste d’attaché militaire). Sa tournée sous-régionale est qualifiée par l’analyste Hagop Badalian, sur la plateforme d’information Zarkerak (28 avril), comme «la recherche par la France de sa réinsertion dans le jeu sous-régional». Il faut reconnaître qu’en octobre dernier à Prague, la France avait réussi à relancer les contacts sous l’égide de l’UE entre les dirigeants arménien et azéri et à s’y introduire par la présence du président Macron. Le refus, par la suite, d’Ilham Aliev, sans doute encouragé par le Kremlin, de voir le président français participer à une seconde rencontre du même type, pouvait être considéré comme une sorte de mise à l’écart de la diplomatie française. De ce fait, elle a oeuvré plus fermement au renouvellement de la Mission civile de l’UE, seconde version. La suite des événements montrera si cette tournée donnera des résultats escomptés.
>>> Diplomatie d’Erevan : réticence ou crainte
La diplomatie française déploie ses efforts dans un moment difficile, comme l’a dit Ararat Mirzoyan lors de la conférence de presse conjointe (28 avril). Elle intervient surtout dans un contexte marqué par des réticences d’Erevan. Les explications du ministre des Affaires étrangères arménien à la même occasion, qui ressemblent plus à une tentative de justification, n’est qu’un pis aller. En effet, dire que Erevan est «en faveur de tous les formats» et donc toutes les médiations ne suffit pas de cacher ses hésitations ou ses fortes craintes à l’égard de Moscou. Ces derniers temps, des analystes plus ou moins proches du gouvernement ont également relevé cette attitude.
Très récemment, le premier à tirer la sonnette d’alarme est Stepan Grigorian lorsque l’Arménie, invitée pour la seconde fois au sommet de la démocratie, a émis des réserves sur la déclaration finale, car, estimait-elle, ladite déclaration n’avait pas qualifié d’agression l’occupation de certains espaces du territoire national par les forces militaires de Bakou. Le second élément indicatif a trait à l’attitude du gouvernement face au projet d’adoption du statut de Rome, dont la Cour constitutionnelle d’Arménie a admis la conformité à la loi fondamentale. Le 3ème exemple concerne les manoeuvres organisées par l’OTAN et surtout celle de nature militaire (Defence 23) à laquelle l’Arménie devait participer. Il a fallu le «coup de main» de l’organisation transatlantique qui a retiré l’Arménie de la liste des pays participants, pour sauver les apparences. La diplomatie réticente d’Erevan sape sa crédibilité comme faisant partie du camp démocratique.
A tous ces sujets, Moscou a réagi fermement en transgressant la formulation diplomatique habituelle. Les déclarations de Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, ont parfois frôlé la menace la plus triviale. A la lecture de ces propos et ceux de certains hommes politiques proches du Kremlin, on a l’impression que Moscou tient l’Arménie pour sa colonie.
>>> Manque de détermination ou surestimation
de la nuisance ? Moscou détient des leviers importants
Des analystes et experts sérieux qui réfléchissent hors l’influence financière et la pression des services de renseignements moscovites ou de leurs acolytes locaux, recommandent aux autorités de sortir de la «posture indéterminée» et de choisir clairement leur camp. Cependant, une telle prise de position ne fait pas l’unanimité chez eux. Lors de l’émission «Analyses dominicales» d’Azatutyun TV (30 avril), deux analystes ont plaidé pour une attitude flexible visant à utiliser toutes les possibilités qui pourraient être bénéfiques aux Arméniens, quel que soit le format de médiation .
Il est vrai que la politique menée, dans le temps, par Robert Kocharian ou Serge Sarkissian consistait à remettre les pans entiers de l’industrie aux intérêts russes (mines, infrastructures ferroviaires, nucléaires, électriques ou gazières, …), contre une hypothétique garantie sécuritaire. L’économie entière du pays est exploitée par le capital russe, sans contrepartie d’introduction d’investissement productif contenant de la haute technologie. Les moyens de pressions sur l’Arménie dont dispose Moscou sont considérables. Pour mener une politique qui ne soit pas de nature coloniale vassalisée, il est indispensable de s’accrocher à la locomotive occidentale, même si le décrochage du navire sombrant lentement a un coût économique et social pour les Arméniens.
>>> Et, l’Occident, que veut-il ?
Les Occidentaux, en particulier les Etats-Unis semblent vouloir affaiblir l’influence russe au Sud-Caucase, qui a été exclusive jusqu’à la guerre des 44 jours (Moscou a concédé à Ankara un certain degré de présence, pour des raisons géostratégiques). Anna Ohanian, enseignante au Stonehill college of Massachusetts, sur TV1, craint qu’un engagement plus poussé de Washington dans le conflit sous-régional, qui comporte intrinsèquement des risques pour Washington même, se termine par des pressions pour obtenir beaucoup de concessions de la part des Arméniens du Haut-Karabagh. A l’adresse de certains experts arméniens qui plaident, sur un ton critique, pour un engagement ferme des Etats-Unis, elle cite les exemples du récent conflit entre Addis-Abeba et le Tigré, rebellé contre le pouvoir central, ou encore comme au Sri-Lanka dans le conflit entre Tamouls et le pouvoir central tenu par les Cingalais, … qui se sont tous terminés par d’importantes concessions de la part des rebelles, suite à la médiation américaine.
La tendance actuelle sur la hiérarchie dans l’applicabilité des trois principes de l’OSCE (intégrité territoriale, droits à l’autodétermination, non recours à la force …) est en faveur du premier principe pour les Etats dans leur majorité. Le régime d’Ilham Aliev manoeuvre très adroitement sur cette tendance et n’en déplaise à Vardan Oskanyan, ancien ministre des Affaires étrangères, l’Arménie n’a pas compris ce phénomène.
En tout état de cause, les ministres des Affaires étrangères arménien et azéri sont invités à se rencontrer à Washington. Auparavant, le Secrétaire d’Etat Blinken a appelé Nikol Pachinian et Ilham Aliev, sans doute pour connaître les instructions qu’ils ont donné à chacun des représentants. MM. Mirzoyan et Bayramov devraient discuter d’un projet de feuille de route à Arlington, près de Washington. Mme Zakharova s’est empressée d’annoncer qu’il était prévu que les deux ministres se voient aussi à Moscou. Depuis un an, les autorités russes n’ont pas réussi à les réunir à Moscou. Restons dans l’expectative quant aux résultats des négociations à Washington et à la réaction russe. ⊆