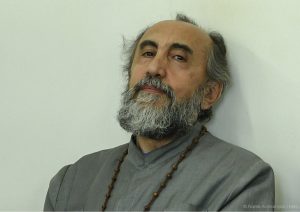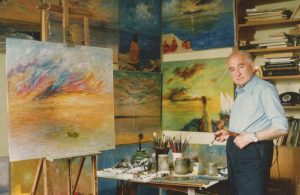Par Stepan BOGHOSSIAN
Aujourd’hui, les Arméniens de troisième et quatrième génération parfaitement intégrés ignorent les diverses composantes de notre identité : langue, culture, religion, tradition nationale, etc, et ne s’y intéressent même pas. Dans leur grande majorité, ils sont totalement ignorants de notre passé, même récent. Ils ne savent pas non plus qu’avant la communauté actuelle, celle résultant du génocide de 1915, Marseille a abrité deux autres communautés, la première au XVIIe siècle, la seconde au XIXe, chacune différente de par son importance numérique, les conditions, les raisons d’établissement et la qualité de vie communautaire. Ils ne connaissent même pas les lieux de leurs racines et ne s’y intéressent point. Dernièrement ayant consulté un médecin spécialiste d’environ quarante-cinq ans et dont le patronyme se termine par le suffixe « ian », j’ai eu la naïveté de lui demander, bien sûr dans la langue de Molière, d’où étaient ses racines. Il m’a répondu avec la plus grande désinvolture : « Aucune idée ». Je pense que tout commentaire est superflu…
Plusieurs auteurs, tant français qu’arméniens, se sont intéressés à ces communautés et ont écrit à leur sujet : Jean Mathorez (« Les étrangers en France sous l’Ancien Régime »), Monseigneur Ormanian, ancien archevêque-patriarche de Constantinople (« Azkabadoum »), le grand historien Arakel Babakhanian, dit Léo (« Histoire complète du peuple arménien »), Théotig (« Dib ou dar : Lettres et imprimerie »),
et Hrand Samuel (« Les Arméniens en France depuis les débuts »). Les auteurs arméniens insistent surtout sur l’imprimerie de l’évêque Vosgan Yerevantzi. L’auteur de ces lignes s’en était largement entretenu dans un long article (voir « Nor Haratch » du 22 mars 2018).
Pour garder l’ordre chronologique, il sied donc de rappeler que du temps du royaume arménien de Cilicie, les nôtres entretenaient des droits de relation commerciale et économique avec l’Occident chrétien (les Franques pour les Arméniens). Après la chute de ce royaume en 1375, d’intrépides négociants arméniens, bravant mille dangers, continuèrent de commercer avec les ports français de Narbonne et d’Aigues (aujourd’hui ensablés), et de Marseille qui, avec le duché de Provence, ne revint à la France qu’en 1481.
Cependant, le premier document officiel attestant l’installation d’Arméniens de notre ville ne date que de 1613. C’est le décret royal de Louis XIII accordant la citoyenneté française à un certain Jean (Hovhannes) Armeny, natif de Constantinople. (En patois provençal, Armény ou Larmény signifie tout simplement « arménien » et ne se rapporte nullement à la notion géographique d’Arménie). Il ne fut que le premier d’une longue série. Il construisit une fontaine dans les vieux quartiers (détruits entre 1855 et 1860), où une rue portait le nom de Rue Fontaine d’Armeny. Il eut une nombreuse descendance : son arrière-arrière-petite fille Marie Lomaca fut la mère d’Adolphe Thiers, le premier président de la IIIe République ! Il y a à Marseille parallèlement à la façade de la préfecture une rue Armény qui porte ce nom suite à une délibération du conseil municipal en date de 1855.
Cependant le véritable élan de cette communauté ne date que de 1669, lorsque Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances de Louis XIV, décréta Marseille port franc. Les négociants arméniens, désormais à l’abri des tracasseries administratives, y affluèrent et ouvrirent des comptoirs fixes. L’évêque Vosgan y apporta son imprimerie. De combien de membres était constituée cette communauté ? Cent peut-être, des hommes presque exclusivement, car à cette époque en Orient, la femme – qu’elle soit musulmane ou chrétienne – voyageait très peu. Et parmi ces hommes, des Arméniens de Perse, des Djoughayetzis (dans la bouche des Français, des « Choffelins »), négociants redoutables et redoutés. Cette communauté fut décimée par la grande peste noire de 1720 qui emporta la moitié de la population de la ville. Dès lors et jusqu’au milieu du XIXe siècle, on entendit plus parler d’Arméniens à Marseille.
Avant de terminer ce chapitre, il sied de rappeler que c’est un Arménien, Haroutioun (Pascal), qui en 1672 ouvrit Rue de la Loge, à côté de la mairie, le premier établissement de café en France. Précisons aussi que Hovhannes (Jean) Altounian introduisit en France la culture de la garance qui fit durant deux siècles la richesse du département du Vaucluse (un village, Althen-des-Paluds, porte son nom).
La Révolution française, dans sa frénésie de détruire tout ce qui provenait de l’Ancien Régime, a gravement endommagé quasiment tous les registres paroissiaux. Et la destruction du vieux quartier (1855-1860 et 1822-1823) a rendu très aléatoires les recherches au sujet de cette première communauté arménienne.
La deuxième colonie, celle du XIXe siècle
Mes parents, et comme eux de nombreuses personnes, appelaient cette communauté « l’ancienne colonie », reconstituée dans la deuxième moitié de ce siècle sur des motifs purement économiques. Après la conquête de l’Algérie en 1830, le port de Marseille avait commencé à s’agrandir. Le traité de Paris de 1856 qui mettait fin à la guerre dite « de Crimée » stipulait la libre circulation dans le détroit des Dardanelles et du Bosphore, et le libre commerce avec les ports de la mer Noire. À partir de là se constituèrent des compagnies de navigation comme les Messageries maritimes et autres. Il y avait dans les ports de la mer Noire – comme ceux de la Méditerranée – de nombreuses colonies marchandes arméniennes, et nos compatriotes revinrent à Marseille, d’abord au compte-goutte.
Un deuxième facteur, l’ouverture du canal de Suez en 1868, donna son plein essor à notre ville. Il est permis de considérer cette date comme celle de la fondation de la deuxième colonie arménienne sous les auspices de la Bonne Mère. Une décennie plus tard, Marseille comptait plus de soixante familles arméniennes (environ 250 personnes), des gens jeunes et entreprenants pour la plupart. À côté des Arméniens originaires de l’Empire ottoman, des gens arrivés de Perse. Et parmi ceux-ci, Siméon Mirzayantz, qui fut consul de cet empire durant quarante ans. Et il semble que tous vécurent en parfaite harmonie. Une seconde vague d’immigration eut lieu en 1895-1896, presque exclusivement des jeunes gens fuyant les massacres hamidiens. Et parmi eux, les survivants du commando de la Banque ottomane, que très gentiment les autorités françaises s’empressèrent d’héberger à la prison Saint-Pierre, jusqu’à leur expulsion vers l’Argentine. À la veille de la Première Guerre mondiale, la communauté arménienne de Marseille était estimée entre 550 et 600 personnes.
Si on considère que ce sont les Kharpertzis qui ont fondé la ou les communautés d’Amérique, ce sont indéniablement les Césariotes (Guéssaratzis) qui ont fondé celle de Marseille. Le Césariote est renommé pour ses talents de négociant avisé, de roublard même. Un dicton dit qu’il a repeint l’âne familial, et le soir l’a revendu à son père ! Et ce sont trois jeunes Guéssaratzis – Hagop Selian (1851-1933), Mihran Tekeyan (1862-1926) et Harout Sahatdjian (1853-1935) – qui toute leur vie resteront en première ligne dans la direction de cette communauté. Mihran Tekeyan était par ailleurs le cousin du grand homme de lettres et homme politique, Vahan Tekeyan.
Qu’il me soit permis ici de citer mes sources d’information au sujet de cette communauté pas si éloignée dans le temps. Pour un peu, Hrand Samuel, mais surtout les petits livres intitulés « Guides arméno-marseillais » publiés de 1928 à 1938 par Hovhannes Varjabetian, et que son fils Hagop, maintenant avocat honoraire, a bien voulu mettre à ma disposition, ce dont je le remercie. Ces livrets contiennent nombre d’informations que l’auteur a recueilli de la bouche d’Hagop Selian, qui vers la fin de sa vie était considéré non seulement comme le patriarche, mais aussi l’encyclopédie vivante de la communauté, et qui en connaissait les moindres détails. L’hebdomadaire « Armenia » que publia ici M. Portoukalian de 1885 à 1921 aurait pu être d’une grande aide si nous avions sa collection à portée de main ; malheureusement, cette unique collection ne se trouve qu’à Vienne (Autriche) au monastère des frères mekhitaristes, donc inaccessible au « commun des mortels ». Il faut ajouter à cela les quelques bribes que j’ai recueilli de la bouche du père Nerses Gadarinian (1888-1962) qui était venu ici encore adolescent et qui avait longtemps servi comme diacre dans la chapelle avant de revêtir la soutane. C’était un remarquable conteur. Qui aurait dit qu’un jour je prendrai la plume pour m’intéresser à l’Histoire ? Aujourd’hui, je me mords les doigts de ne pas avoir rempli quelques cahiers de ce que j’aurais pu cueillir de lui.
La direction de cette colonie est donc restée jusqu’au milieu des années 1920 presque exclusivement aux mains de cette classe de bourgeois commerçants, lorsque cette vieille colonie s’est petit à petit fondue dans la masse des nouveaux arrivants, rescapés du génocide.
L’arménité marseillaise était déjà une colonne structurée lorsqu’en 1885 vint s’installer ici avec sa jeune épouse et ses enfants en bas âge Meguerditch Portoukalian, alors âgé de 37 ans, venant de Van où il avait fondé une Ecole normale et jeté les bases du premier mouvement émancipationniste, le mouvement Armenagan, fuyant de justesse les poursuites turques. Dès son arrivée ici, avec la plus grande ponctualité et jusqu’à sa mort, il publia l’hebdomadaire « Armenia ». Qu’elle accueil trouva-t-il, lui l’intellectuel, auprès de cette bourgeoisie mercantile ? Trouva-t-il auprès d’eux un bon accueil et une aide morale ou matérielle ? Impossible de le savoir. Sa dernière fille, alors d’un âge avancé, et une de ses petites-filles que je connaissais, ne purent me donner aucun renseignement. Son hebdomadaire faisait grand bruit dans tous les milieux arméniens. Si l’on considère les difficultés de l’époque pour la collecte des informations, les problèmes d’impression (manque chronique de linotypistes) et les frais d’expédition, ce qu’il accomplit ici est plus qu’une prouesse, un vrai héroïsme. Ajoutons qu’il était chargé d’une famille nombreuse (dix enfants). Nous trouvâmes dans la cave de sa petite fille, croupissant sous la poussière, l’exemplaire dédicacé que le grand publiciste Théotig lui envoya en 1913 de Constantinople (« Dib ou dar : Lettres et imprimerie ») à l’occasion du 1 500e anniversaire de la création de l’alphabet arménien. Heureusement que cette relique a pu être sauvée et repose maintenant sur les étagères du centre A.R.A.M à Saint Jérôme.
(À suivre – 1)
S. P.