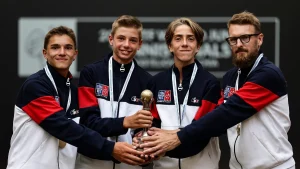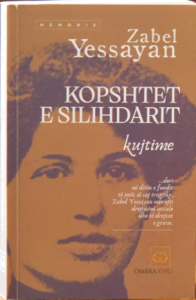A l’occasion du centenaire et de la « nouvelle » communauté post-génocide
Par Stepan BOGHOSSIAN
Mais retournons aux questions d’organisation et de structuration de la communauté. « Là où il y a trois Arméniens, il y a une église, et là où il y a une église, il y a une école », dit le dicton. Surtout avec la mentalité de l’époque, cela ne pouvait se concevoir hors de l’Eglise apostolique orthodoxe arménienne qui, suite à la disparition de l’État, était le ciment de l’unité nationale. Le manque d’un lieu de culte se faisait lourdement sentir. Il n’est pas superflu de souligner que ce sont des hommes jeunes d’à peine la trentaine qui en sont à l’initiative. Une première réunion eut donc lieu en octobre 1878 au domicile d’Hagop Selian, mais qui ne donna pas le résultat attendu par manque de moyens. Une autre eut lieu au printemps 1881 au domicile de Siméon Mirzayantz à laquelle, en plus des personnes en vue de la colonie, participa un riche négociant, Haroutioun Maksoudov, originaire de Londres, qui finança une partie du projet. La première Ephorie de la future chapelle que l’on baptisa déjà Sourp Haroutioun (« Sainte Résurrection ») fut nommée en les personnes de Siméon Mirzayantz, Hagop Selian et Mihran Tekeyan, ce dernier au poste de président. Il y restera plus de quarante ans jusqu’à sa mort en 1926, toujours secondé par Hagop. Ce premier pas effectué, il fallait :
1. Obtenir l’autorisation de l’État : les religions étaient alors régies par ce qu’on appelle le Concordat, signé en 1801 par Napoléon Bonaparte, alors Premier consul. L’État reconnaissait alors trois cultes (le catholique, le protestant et l’israélite), nommait leurs ministres et les rétribuait. Les autres cultes étaient tolérés, mais après autorisation ministérielle. Ainsi, il fallait s’adresser à M. Goblet, ministre des Cultes, par l’entremise du préfet des B.d.R. Celui-ci donna l’autorisation, mais à la condition que le culte soit célébré en grec. Et rebelote ! Il fallait de nouveau écrire au ministre pour lui expliquer que l’Eglise apostolique arménienne est autocéphale et qu’elle a sa propre langue liturgique, l’arménien classique, ou grabar.
2. Trouver un local à transformer en chapelle. Et c’est au 18 rue de l’Ormeau (actuellement rue du Docteur Combalat), une petite rue allant de la place Estrangin à la rue Breteuil, que fut installée la chapelle, déménagée en 1921 au 90 rue Stanislas Torrentz, qui subvint aux besoins religieux de la communauté jusqu’à la consécration en 1931 de la belle église des Saints Traducteurs sur l’avenue du Prado.
3. S’assurer d’un prêtre à demeure. Et pour cela, on s’adressa à l’archevêque-patriarche de Constantinople Monseigneur Nerses Varjabedian, de qui relevaient à l’époque les petites communautés d’Europe. Ce dernier envoya le père Sahag Utujian comme prêtre desservant, qui resta à Marseille dix ans jusqu’à son transfert à Paris. La première messe y fut célébrée le dimanche 8 janvier 1882, comme le relatent les journaux arméniens de Constantinople. Il ne reste de cette chapelle qu’un registre des baptêmes datant de l’an 1900. J’éviterai de nommer un par un les neuf autres prêtres qui se succédèrent jusqu’à l’arrivée en 1927 de Monseigneur Balakian.
Qui dit « Là où il y a une église, il y a une école » : le manque de documents ne nous permet pas d’affirmer qu’il y avait ici une école dite hebdomadaire. J’ai connu dans ma jeunesse jusqu’au milieu des années 1950 des personnes enfants de cette communauté qui parlaient et bien sûr lisaient et écrivaient un excellent arménien. Où l’avaient-ils appris ? Dans le milieu familial ? Parmi eux un excellent homme, Mardiros Gumuchian, qui à 80 ans venait nous enseigner l’arménien, à nous les jeunes de l’époque. Nous savons par des enseignements fragmentaires qu’avant 1914, il y avait ici une petite chorale et une section de l’UGAB (Union Générale de Bienfaisance Arménienne). Cela nous laisse penser qu’il y avait donc ici une vie communautaire assez intense.
Lors des quatre années de la Première Guerre mondiale, ici aussi les Arméniens vécurent dans une grande anxiété. D’une part, les nouvelles alarmantes venu de Turquie – où chacun avait une partie de sa famille – au sujet des déportations et du génocide, et d’autre part la mobilisation de la jeunesse et l’enrôlement volontaire dans la Légion arménienne des non citoyens français partis au front. Le délégué de la Légion était Hagop Turabian (mort en 1943) qui publiait un hebdomadaire bilingue intitulé « Khtan » (L’Aiguillon). De quels montants et sous quelles formes furent les aides de la communauté marseillaise ? Un seul document a survécu au temps : c’est une simple feuille de papier datée du 26 mars 1916 sur laquelle sont inscrits les noms de 35 donateurs. Des gens d’apparence modeste qui ont donné entre vingt et quarante francs (à cette date, toujours en franc or, dit franc germinal). Le salaire moyen de l’ouvrier était de cinq ou six francs par jour. Mais pourquoi cette initiative latérale où l’on ne rencontre aucun nom de la caste dirigeante ? Là aussi pas de réponse.
À la fin de la guerre, trois années de liesse qui firent oublier les horreurs vécues. L’Arménie est indépendante et le fils de Siméon Mirzayantz, Dikran, est nommé consul d’Arménie. La communauté organise des repas et des dîners en l’honneur des personnalités de marque – civiles et religieuses – qui pour se rendre à la conférence de la paix de Paris passent obligatoirement par Marseille. Parmi ceux-ci, une photo montre Vahan Tekeyan attablé chez ses cousins dans leur villa de Château-Gombert.
Ayant dès mon adolescence activement participé à la vie communautaire, j’ai connu jusqu’au milieu des années 1950 des descendants de famille Tekeyan et Sahatdjian qui étaient toujours sur la brèche. Mais pas de Selian. Était-il sans enfant ou sans enfant mâle ? Sa sépulture, en concession centenaire au cimetière Saint-Pierre était déjà il y a quelques années en fort mauvais état. Il y a dans le septième arrondissement, tout près de la Corniche, une rue étroite et parfois en escalier dénommée Traverse Selian. Le « Dictionnaire encyclopédique des rues et places de Marseille » de Adrien Bles – qui n’est pourtant pas avare de détails – n’en a ici aucun. A qui se rapporte son nom ? De quand date cette dénomination ? A-t-il un rapport avec notre Monsieur Hagop ? Nul ne sait. Et un pur hasard a fait qu’un des descendants des Mirzayantz, habitant la région parisienne, se manifeste. Oui, la poussière du temps recouvre rapidement le passé du manteau de l’oubli…
La nouvelle communauté post-génocide
Elle prit corps à partir de l’automne 1922 dans des conditions dramatiques. Les « grandes puissances » – France, Grande-Bretagne et Russie – avaient fait d’innombrables promesses afin d’entraîner les petits États à leurs côtés dans la guerre. Parmi eux, les Grecs, qui rêvaient de reconstituer l’Empire byzantin avec Constantinople pour capitale. Cependant, le traité de Sèvres ne leur avait octroyé environ 15 000 km² autour de Smyrne dans la population était majoritairement grecque. (Les Arméniens de toute cette région n’avait pas été déportés) Croyant aux promesses de la perfide Albion – qui d’autre part aimait Mustafa Kemal – les Grecs partirent à l’offensive, entrèrent assez profondément en Anatolie jusqu’à Eskişehir. Après avoir réglé leurs comptes aux Arméniens sur l’Araxe en 1920, puis en 1921 en Cilicie suite au lâchage des Français, l’armée de Mustafa Kemal passa à l’offensive à l’ouest et remporta la bataille d’İnönü en septembre 1922. Dès lors, l’armée grecque en pleine débandade essaya de se replier sur Smyrne, emmenant avec elle les populations chrétiennes grec et arméniennes. Les Turcs mirent le feu à la ville où 3 000 Arméniens périrent dans l’incendie de la cathédrale Saint-Étienne. Celui qui trouva un bateau ou une barque pu sauver sa peau. Les autres furent exterminés et jetés à la mer…
Et à partir de septembre, d’abord en petit nombre, puis de plus en plus nombreux, les réfugiés arméniens posèrent le pied sur les quais de la Joliette dans le dénuement complet, ne portant parfois qu’un simple baluchon. Ainsi, de 1922 à 1930, plus de 100 000 rescapés du génocide, encore hébétés par les horreurs vécues débarquèrent à Marseille. Environ 25 000 traversèrent la France en transit pour rejoindre les Amériques par les ports du Havre et de Bordeaux. Quelques milliers allèrent dans les pays limitrophes. Plus de 70 000 s’établirent en France tout le long du bassin rhodanien jusqu’à Paris. Et environ 30 000 s’installèrent à Marseille et dans sa banlieue, ou bien dans les villes de Provence, là où il y avait du travail : Avignon, Toulon, La Ciotat, Aix-en-Provence et les autres.Au début, la Croix-Rouge arménienne et le Comité d’Entraide des Dames ont installé les réfugiés dans des hôtels bon marché en allouant à chaque personne un franc cinquante par jour pour la nourriture. Cependant leur nombre augmentant de semaine en semaine, il devient difficile de continuer ainsi dans ces hôtels miteux. Aussi, Dikran Mirzayantz, Consul d’Arménie (la France n’ayant reconnu l’Union soviétique de jure qu’en 1924, les anciennes représentations diplomatiques étaient toujours en place) demanda et obtint des autorités françaises que le camp Oddo fut mis à leur disposition. Ce camp proche des quais dans le quartier de la Cabucelle et formé de 38 grands baraquements avait été édifié comme camp de transite pour les soldats qu’on ramenait d’Indochine pour servir de chair à canon sur le front de guerre. La guerre étant terminée et les derniers soldats rescapés du feu rapatrié, on pensait démolir ce camp. Rappelons que le plus illustre de ses soldats était un certain Nguyễn Ái Quốc, plus tard connu sous le nom d’Hồ Chí Minh, le futur libérateur et président du Vietnam. Le camp Oddo est une exception dans l’histoire arménienne en tout : un lieu géré par les Arméniens, pour des Arméniens, pour l’exemplarité : paix sociale, hygiène, etc, malgré les différences de mœurs entre gens provenant de diverses contrées. Sa haute gestion fut confiée à l’Union nationale créée le 28 septembre à l’initiative de Dikran Mirzayantz et Hagop Selian, dans lequel furent intégrées « quelques personnes ayant du plomb dans la cervelle ». La direction fut confiée à Takvor Khatchikian, ancien volontaire de la Légion arménienne, homme de gauche intègre, qui resta en fonction tout au long des trois années et demi que dura le camp. Un rapport imprimé, aujourd’hui aux archives du centre A.R.A.M., décrit de façon détaillée tous les aspects de la vie de ce camp : culturels, scolaires, cultuels, sociaux, et financiers bien sûr. L’un des baraquements était transformé en semaine en école primaire et servait le dimanche au culte. Un registre, aujourd’hui encore gardé en parfait état, décrit une par une les entrées et sorties du camp, les dates et lieux de naissance des personnes, leur état-civil et aussi les naissances, mariage et décès. Il faudrait un petit volume pour rapporter la vie de cet établissement unique en son genre. Le camp Oddo est la meilleure preuve de la compassion que la « Vieille colonie » apporta à ses malheureux compatriotes. Aujourd’hui la station Gèze, terminus de la ligne de métro No 2, occupe l’emplacement de ce camp. La municipalité avait bien promis une stèle, mais il faut se contenter d’une petite plaque, et encore pas très apparente.
Il faut un volume bien épais pour écrire l’histoire des cent ans de cette « Nouvelle colonie » qui a vite très vite changé de visage. La fermeture du camp correspond à l’exode de la majorité des réfugiés du centre-ville vers les banlieues Saint-Antoine, Saint Loup, Sainte-Marguerite, où des villages arménien poussèrent comme des champignons. D’autres banlieues comme Beaumont et Saint Jérôme attirèrent les plus aisés. Monseigneur Krikoris Balakian, nommé Primat du Midi de la France – lui aussi rescapé du génocide et auteur du « Golgotha arménien » – les dota très rapidement de lieux de culte, de construction sommaire au début, estimant que la maison de Dieu était aussi la maison du peuple. Mais sa disparition prématurée en 1934 laissa cette communauté orpheline. Les mutations sociales de la ville et l’élévation du niveau de vie ont aujourd’hui dépeuplé ces villages arméniens, surtout dans les quartiers Nord. Il y a eu à partir des années 1970 un vrai exode vers les villages comme Bouc-Bel-Air, Septèmes-les-Vallon, Calas et Cabriès, où les Arméniens ont édifié de belles villes. Mais c’est surtout le manque de cohésion qui a porté un rude coup à la vie communautaire, qui s’est étiolée d’année en année.
Il y eut il n’y a pas encore très longtemps dans les centres culturels arméniens de notre ville des colloques, des conférences dédiées à tel ou tel fait du passé des Arméniens. Le centenaire n’est-il pas l’occasion de lui en consacrer un ?
Ce qui permettrait de faire d’une pierre deux coups :
1. Réveiller cette communauté en pleine torpeur ;
2. Apprendre aux jeunes générations leur passé récent.
Marseille,
Juillet 2022
(2 et FIN)
S. P.