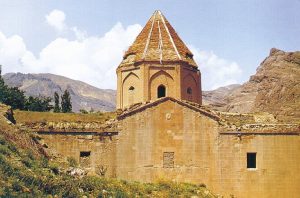Recursive InterNetwork Architecture (RINA)… Un nom à rallonge qui ne vous dit sans doute rien, mais qui pourrait bien révolutionner les échanges numériques à l’avenir. Né en 2008, ce protocole de communication propose une alternative au modèle TCP/IP, fondation d’Internet mais datant des années 1970. Le projet « RINArmenia », initié par G2iA et Philippe Poux, vise à faire de l’Arménie le centre de compétence de cette architecture novatrice et à poser les bases de l’Internet de demain.
« Nor Haratch » – D’où est venu votre intérêt pour l’architecture RINA ?
Philippe Poux – Je connais depuis longtemps Louis Pouzin, un des « papas » de l’Internet, qui était venu une première fois en Arménie en 2016 pour recevoir le « Global IT Award ». Louis me répétait souvent que l’Internet, tel qu’il a été conçu au départ, n’est plus adapté à l’usage qu’on en a aujourd’hui. Comme il disait : « L’Internet des années 70, c’était un immeuble pour quelques scientifiques, mais à présent le monde entier veut être dans cet immeuble ! » Aujourd’hui, Internet fonctionne, mais pas de manière optimale, car il y a d’énormes problèmes de sécurité et de lenteur. Le protocole RINA est donc une tentative de penser différemment l’architecture d’Internet et de faire communiquer les applications entre elles de manière optimisée. Les bases de RINA ont été posées par John Day, un autre pionnier de l’Internet, qui a redécouvert des principes que Louis avait énoncés il y a des années. Louis avait écrit une architecture qu’il avait appelée « Cyclades », inspirée du réseau d’interconnexion des îles grecques. John Day a poussé l’innovation encore plus loin en se disant : « Je pars d’une feuille blanche, j’oublie tout ce que je sais et je réfléchis à comment une application devrait parler à une autre application. »
« NH » – Comment est née l’idée de lancer le projet « RINArmenia » ?
P. P. – Auparavant, j’avais fait quelques tentatives de développer le projet en Europe et en France. La Commission européenne avait aussi mené et financé quelques travaux dans cette optique, mais cela restait dans le giron des scientifiques. Quand j’en parlais à des ingénieurs en France, ils n’étaient pas vraiment intéressés, sans doute parce qu’ils trouvaient l’idée trop « dérangeante ».
Mais en Arménie, lorsque j’ai évoqué le projet avec des officiels après la révolution de Velours, j’ai rencontré beaucoup plus d’enthousiasme. A l’époque, ils étaient en pleine préparation du Sommet de la Francophonie et ils cherchaient un orateur principal pour le Forum économique. Je leur ai proposé d’inviter Louis Pouzin. Et dans son discours d’ouverture de l’événement, il a ainsi pu présenter les perspectives offertes par l’architecture RINA.
« NH » – Concrètement, comment s’est matérialisé le projet ?
P. P. – Après le lancement officiel de l’initiative, j’ai démarché plusieurs donateurs afin de pouvoir embaucher une équipe de développeurs. Pendant deux ans, notre équipe a travaillé à défricher ces idées, à trouver ce qui était réellement bénéfique dans les réflexions, et surtout à passer de l’épure scientifique à la réalité technique. Nous avons ainsi développé un logiciel qui met en pratique cette architecture et dans la foulée, nous avons créé une entité commerciale, « rBlox ». Pour l’instant, nous proposons nos services au monde de la blockchain. Un des avantages de cette architecture, c’est qu’elle est environ 40 % plus rapide. Et comme le monde de la blockchain consomme beaucoup de transactions, il était logiquement très intéressé. De plus, c’est un univers tout récent qui n’a pas peur des idées innovantes.
« NH » – En plus de la rapidité, quels sont les avantages de l’architecture RINA ?
P. P. – Elle est beaucoup plus sécurisée. Ce n’est pas pour critiquer ceux qui ont créé le TCP/IP : à l’époque, les scientifiques se connaissaient tous et ne pensaient pas que les gens utiliseraient un jour ce réseau de façon maligne. Une des manières de nuire à un service est par exemple de repérer son adresse IP et de la bombarder de requêtes avec des ordinateurs-robots. Mais dans notre architecture, il n’y a plus d’adresse IP, ni de DNS (Domain Name System). La façon d’interagir avec un serveur est différente et on ne peut plus connaître le numéro physique d’une machine. L’autre avantage majeur est sa faible consommation d’énergie. Cette architecture sollicite beaucoup moins les processeurs, et consomme donc moins d’électricité. On sait que cet avantage va attirer beaucoup de clients, car à l’heure actuelle, Internet consomme une quantité colossale d’énergie. Les centres de données seront les premiers intéressés, vu les factures d’énergie gigantesques qu’ils payent !
« NH » – Est-ce que cette architecture peut fonctionner en même temps que l’ancienne ?
P. P. – Bien sûr. C’est purement du logiciel : on ne touche à aucun composant électronique, ni aux infrastructures. Un serveur configuré en « rBlox » peut parfaitement continuer à discuter avec le reste du monde. Mais nous ne pouvons pas tout changer d’un seul coup. Nous allons avancer pas à pas, en démarchant principalement les marchés qui sont à l’écoute. Chaque marché trouvera dans nos trois avantages un élément qui l’intéresse plus que les autres.
« NH » – Quelles sont vos perspectives de développement à court terme ?
P. P. – Tout d’abord, nous voulons nous développer commercialement en montrant à différents acteurs que la blockchain utilise déjà nos services et qu’ils peuvent eux aussi bénéficier d’une architecture plus efficace. Nous devons lever suffisamment de fonds pour élargir notre équipe technique et nos capacités de développement. Aujourd’hui, notre architecture ne fonctionne que sur certains systèmes d’exploitation, et nous devons encore l’adapter à d’autres types de serveurs. Quand tout cela sera suffisamment puissant et visible, nous verrons comment monter une école du futur d’Internet en Arménie.
Mon objectif, c’est de mettre l’Arménie au centre du monde des hautes technologies en disant : « Si vous voulez connaître le futur d’Internet, il faut venir l’étudier en Arménie. » Nous devons nous inspirer de ce qu’a fait l’Estonie. Il y a encore quelques années, presque personne ne connaissait ce petit pays. Mais ils ont développé un État numérique performant et ont créé la « e-résidence », un projet qui permet, sans quitter son pays, de devenir un résident virtuel, d’ouvrir un compte bancaire, de créer une société, etc. Aujourd’hui, tout le monde parle de l’Estonie dans le monde des hautes technologies, et l’Arménie a tout à fait le potentiel pour suivre cette voie.
Propos recueillis par
Achod PAPASIAN