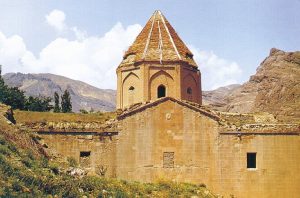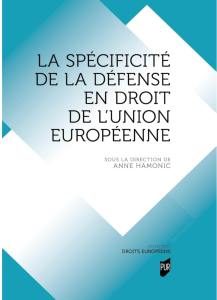Par Édouard MARDIROSSIAN
Il y a tout juste 50 ans, le 4 juin 1972, le premier Mémorial arménien en Europe, dédié aux victimes du génocide de 1915, était inauguré à Décines. Cet événement avait pris cependant une dimension nationale, car ce projet unique en France avait été considéré comme original, ambitieux et exceptionnel par les médias arméniens. Ses trois principaux protagonistes furent Pierre Moutin (1925-2021), maire de Décines-Charpieu et conseiller général du Rhône, pour avoir déployé toute son énergie et ses compétences pour obtenir les autorisations administratives nécessaires, Robert Darnas (1913-1980), le sculpteur qui a mis plus de deux ans pour réaliser son œuvre, et Mesrob Bayendrian (1902-1996), comme membre actif de la paroisse arménienne, le coordinateur qui n’a jamais compté son temps et ses forces pour collecter des fonds dans tout l’Hexagone afin de concrétiser au plus tôt sa mission. Seuls les monuments de Bikfaya au Liban en 1965, de Dzidzernagapèrt à Erevan en 1967 et de Montebello à Los Angeles en 1968 avaient été érigés précédemment.
Le monument décinois est situé place de la Libération, ouverte moins d’une dizaine d’années auparavant pour célébrer le vingtième anniversaire de la libération de la commune. Pourtant, une certaine confusion avait été créée au départ, pour avoir été dénommée « place Jean Jaurès », du nom de l’avenue principale de la ville sur laquelle cette place débouche. Aujourd’hui, les habitants l’appellent plus communément la place des Arméniens, pour être située au cœur du quartier de cette communauté, alors qu’elle avait été occupée pendant des décennies par des jardins ouvriers, exploités principalement par des salariés de l’usine Gifrer et Barbezat, qui se trouvait seulement à une centaine de mètres. Le choix de l’emplacement du Mémorial avait fait l’unanimité en cette année 1965, marquée à la fois par le cinquantenaire du génocide des Arméniens et par la date des élections municipales, au cours desquelles les deux principales listes souhaitaient faire un geste en faveur de la communauté arménienne.
Un cinquantenaire unitaire
C’est ainsi que le maire sortant s’était engagé à dénommer la rue Branly « rue du 24 avril 1915 » (alors que la décision municipale ne fut prise que le 2 juin suivant), car cette voie était habitée par une très forte majorité d’Arméniens, le foyer communautaire et l’Église apostolique arménienne s’y trouvaient également, de même que l’Église évangélique arménienne, à une cinquantaine de mètres plus loin. L’autre liste, qui sortira vainqueur, promit alors d’ériger un monument pour honorer les victimes du premier génocide du XXe siècle. C’est ainsi que le samedi 24 avril 1965, il revenait à la nouvelle municipalité de dévoiler la nouvelle plaque de la rue, puis de procéder aussitôt après à une cérémonie de pose de la première pierre du monument, alors que la délibération du conseil municipal ne donna son accord de principe sur la place de la Libération que le 19 mars 1966. En 1965, un Comité d’organisation, réunissant tous les courants de la communauté locale, avait parfaitement géré l’ensemble des manifestations programmées pour la journée commémorative. L’année suivante, c’est un Comité d’érection du monument à la mémoire des victimes du génocide arménien qui a été constitué (le 10 novembre 1966), sous la présidence de Mesrob Bayendrian, devenu durant les années suivantes la véritable cheville ouvrière de cette entreprise, dont toutes les pièces du dossier furent transmises au préfet de l’Isère Fernand Rude, qui les remit au ministère de l’Intérieur en mars 1968. L’avis favorable, définitif et officiel du gouvernement, fut donc donné le 28 janvier 1969.
1973 : année charnière pour Ankara qui multiplie ses attaques anti-arméniennes
Jusqu’à son inauguration en 1972, on n’entendit jamais les plaintes turques vis-à-vis des Arméniens de la diaspora, jusqu’au début de l’année 1973, où Ankara allait créer une turbulence permanente dans ses relations avec l’Occident, surtout face aux nouvelles actions des Arméniens (inauguration d’un Mémorial dans la cour de l’église arménienne du Prado à Marseille et exécution de deux diplomates turcs à Santa-Barbara à Los Angeles, prémisse de la lutte armée de l’Asala et du Commando des justiciers du génocide arménien) ou à la diplomatie internationale (discussion de l’article 30 à la sous-commission des Droits de l’homme à l’ONU).
Une collecte bien organisée
A propos du monument à Décines-Charpieu, le premier communiqué d’informations du Comité (paru dans « Haratch » du 25 mars 1970) allait signaler que la municipalité avait donné son accord pour ériger le monument sur l’une des places les plus spacieuses de la commune et, malgré une sollicitation faite auprès des sculpteurs arméniens et locaux, afin de présenter leur maquette, le ministère de la culture demanda d’une part que l’œuvre choisie soit réalisée dans un style abstrait et contemporain et d’autre part que le choix de l’artiste soit porté sur les seuls sculpteurs lyonnais d’origine française. M. Mouchègh Djierdjian, de Monaco, avait répondu favorablement à la demande du Comité en participant à hauteur de 20 000 francs (3 000 euros) pour la réalisation du monument, tandis que la collecte auprès des Arméniens de Décines s’élevait alors à 17 000 francs. Dans un second communiqué, publié dix mois plus tard, l’appel du comité s’adressait à l’ensemble des Arméniens de l’Hexagone dans le cadre d’une campagne devenue nationale, bien que le total des dons par les compatriotes de la commune, où devait être érigé le monument, avait atteint depuis le double du montant recueilli en début d’année. Malgré l’âge avancé de Mesrob Bayendrian, il n’avait pas hésité à faire le tour de France des communautés arméniennes, avec sa « deux chevaux » – à ses frais – pour solliciter les âmes généreuses, dans le seul but de pouvoir rapidement terminer la stèle, destinée à « immortaliser le million et demi de déportés et de morts dans les eaux de l’Euphrate ». Cet appel allait être relayé quelques jours après dans un billet-éditorial de « Haratch »
en date du 9 janvier 1971, signé par Herand Samuel, en rappelant que le Mémorial de Montebello a été érigé grâce au soutien de tous les Arméniens des États-Unis d’Amérique. Il reconnaît que cette entreprise est louable et courageuse, puisque les différentes associations parisiennes n’avaient pas eu jusqu’ici les autorisations nécessaires pour en faire de même.
Une participation nationale
C’est ainsi qu’une collecte a pu être organisée un dimanche d’avril 1971 à Vienne avec quatre membres du Comité décinois, accompagnés par l’ensemble de l’Union nationale arménienne locale. Une somme de 5 000 francs avait été recueillie ce jour-là. Le montant total des donations s’élèvera à la fin de la campagne à 157 634,38 francs. L’artiste Robert Darnas avait commencé dès le printemps 1971 l’installation de ce monument expiatoire, place de la Libération, qu’on appelle aussi place du marché (du vendredi). Sans haine, sans violence servi d’un sens de la justice impartiale, l’artiste avait traduit dans cette stèle ascendante, qui s’élève jusqu’à 8,50 mètres du sol, une sorte de tour concentrationnaire où le couple anéanti, dévoré par les flammes et attaqué de toute part, demeure debout cependant. Il avait terminé l’assemblage d’une centaine de pièces, dans son atelier à Tassin la Demi-Lune, avec la collaboration de sa femme. Même si les Arméniens l’avaient beaucoup aidé, l’historien lyonnais Fernand Rude (spécialiste du mouvement ouvrier et des Canuts) a apporté sa collaboration, et Robert Darnas reconnaît qu’ils avaient été quelque peu surpris par son travail presque « abstrait ». Ils ont vite compris la foi et l’enthousiasme qu’ils l’avaient animés pour réaliser cette œuvre, la plus grande jusqu’ici construite en ciment fondu. Dans une chronique de « Haratch » du 31 août 1971, M. Mannig estimait que le Mémorial de Décines allait devenir un lieu de pèlerinage tant pour les rescapés de 1915 que pour les jeunes qui allaient s’imprégner d’une motivation nouvelle. Le témoignage d’un touriste, de passage sur cette place publique, avoue qu’en lisant en langues arménienne et française, la mention « à la mémoire des 1 500 000 Arméniens massacrés lors du génocide de 1915 » sur le socle est bien explicite, bien qu’il comprenne, par ailleurs, que la tolérance administrative ne pouvait aller au-delà….
Quatre mille personnes à l’inauguration
Il était prévu que l’inauguration du monument devait avoir lieu le 23 avril 1972, lors d’une cérémonie qui rassemblerait l’ensemble des associations arméniennes de la région. Mais, ce dimanche-là s’est tenu un référendum sur l’élargissement des communautés européennes. Un communiqué du Comité proposa alors la date du dimanche 28 mai 1972. Mais là encore, l’indisponibilité de certaines personnalités obligea le Comité d’organisation, placé sous l’autorité de Napoléon Bullukian (1905-1984) à revoir une date plus appropriée. Grâce à ses nombreuses relations et à son influence, il retient enfin la date du dimanche 4 juin 1972.
C’est donc en présence d’une foule nombreuse et de plusieurs élus de la République que s’est déroulée la cérémonie inaugurale du mémorial, au cours de laquelle ont pris la parole Arsène Margossian (1928-2007), adjoint au maire à Décines, Pierre Moutin, maire de la commune, Louis Pradel (1906-1976), maire de Lyon, et Hovig Eghiazarian (1921-2008), avocat au Barreau de Paris, qui n’a oublié personne dans ses remerciements envers tous ceux qui avaient largement contribué à concrétiser cette réalisation. Le matin, en l’église Sourp-Asdvadzadine de Décines, Mgr Sérovpé Manoukian (1908-1984), archevêque des Arméniens de Paris, avait demandé « que d’autres communes édifient des monuments en hommage aux victimes du premier génocide de ce siècle ». Une légende, non vérifiée, précisait pourtant que celui de Décines devait rassembler chaque année le 24 avril, tous les Arméniens de la région, comme lieu unique pour se recueillir.
Le règlement définitif étant arrivé à son terme, le Comité remit les clés du monument à la mairie en 1973, comme site communal désormais, afin d’assurer également son entretien et sa préservation. La municipalité eut la délicatesse de préserver le mémorial, en aménageant en juillet 2013 son pourtour par des végétaux, nécessaire pour un accès plus facile les jours de marché, qui encombrait les lieux. Cela n’a pas empêché que le monument ait subi des tags à la peinture en 1984, une seconde fois en 1987, et plus récemment encore par les Loups gris du pouvoir turc en novembre 2020.