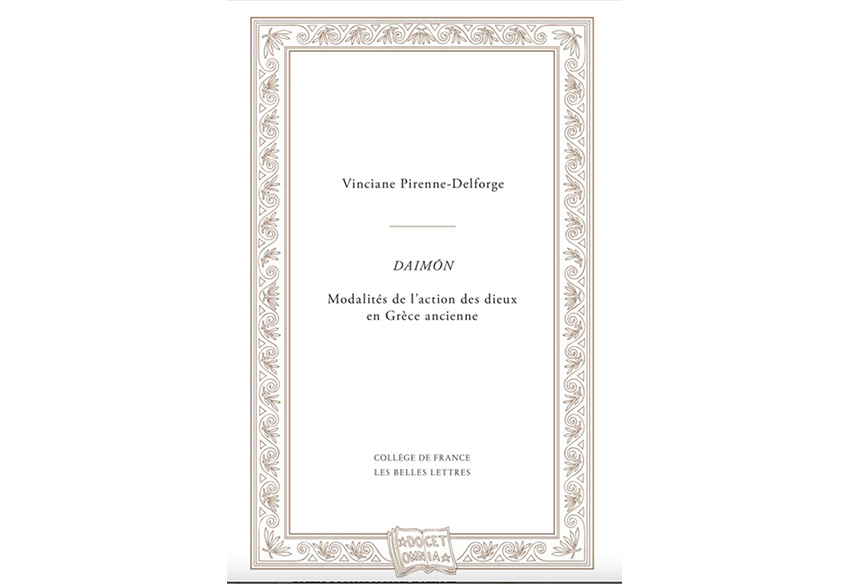
Vinciane Pirenne-Delforge
Modalités de l’action des dieux en Grèce ancienne
Collège de France / Les Belles Lettres,
(Collection Docet omnia), 2025,
337 p., 25,00€
Vinciane Pirenne-Delforge, professeure au Collège de France spécialiste de la Grèce antique, étudie ici une puissance divine du troisième type, le daimōn, entité difficile à aborder et pour cela-même parfois délaissée au profit des deux autres, les dieux et des héros. Ce que recouvre daimōn n’est rien de moins que l’énigme de la distribution du bonheur, des bienfaits, dont chaque humain aimerait recevoir une part, la plus grande possible. Le daimōn se définit comme un « vecteur », un « distributeur » chargé par un ou plusieurs dieux de répartir des biens ou des maux, il effectue une action divine dont l’origine reste inconnue. La vie se montre fragile, pleine de souffrances imprévisibles et, frissonnant dans l’incertitude de son avenir mortel, l’humain implore des forces supra-terrestres, celles des dieux de l’Olympe où règne Zeus tout-puissant. C’est dans ce contexte existentiel (celui de la cité, de la famille et de l’individu) qu’intervient le daimōn, puissance agentive des dieux qui répartit sur ces trois niveaux non seulement les bienfaits mais aussi les malheurs. L’autrice rappelle au passage que les mots grecs en –μων (« mon ») désignent la capacité d’action des êtres et elle consacrera plus loin l’un des chapitres du livre à l’étymologie de daimōn.
Pirenne-Delforge annonce d’emblée qu’elle ne traitera pas des daimones de la philosophie présocratique et qu’elle analysera plutôt ceux de la tradition poétique. Elle scrute, entre autres, Homère, Hésiode, Pindare, les auteurs de tragédies Eschyle, Sophocle, Euripide sans exclure, puisqu’il est question de théâtre, quelques incursions chez Aristophane. Elle emprunte parfois quelques détours anachroniques nécessaires à la démonstration. L’interprétation de ces documents – où l’autrice dissèque toutes les nuances grammaticales et syntaxiques – éclaire ce qu’il en est du polythéisme et de son fonctionnement, qu’elle considère comme un « système pluriel et non dogmatique ». De fait, Pirenne-Delforge veut rapprocher poésie et religion en démontrant – preuves à l’appui – que le daimōn jouit d’une « consistance cultuelle » résultant de son association avec un dieu (principalement Zeus).
L’autrice s’attache à circonscrire la notion de daimōn à travers les différents contextes dans lesquels les auteurs anciens l’utilisent. Le daimōn homérique déterminera la tradition poétique ultérieure, il importe dès lors de commencer avec lui le parcours. Dans l’Iliade, le daimōn surgit comme une force fulgurante de source divine donnée à un guerrier à un moment donnée, une puissance qui fait de lui un « humain augmenté ». L’humain animé par le daimōn devient une sorte d’agent de la divinité dont on constate l’action. Chez Homère, nous dit l’autrice, cette puissance n’est pas seulement physique, elle peut aussi agir « dans le registre de la persuasion, de l’audace, de la ruse ou de l’aveuglement ». L’agentivité du daimōn se révèle également chez Hésiode qui, d’une part, en installe trente mille sur terre pour garder les mortels et appliquer les volontés de Zeus et qui, d’autre part, dépeint le personnage de Phaeton (né d’un accouplement humain-divin) comme un « daimōn divin » créé par Aphrodite. Phaeton incarne l’ « l’immanence du pouvoir divin », écrit Pirenne-Delforge.
L’idée que l’humain reste soumis à une « alternance de biens et de maux » qu’imposent les dieux se prolonge dans la poésie mélique (c’est-à-dire non épique). Il faut prier les dieux pour qu’ils daignent mobiliser un daimōn nous protégeant des malheurs : « Les dieux eux-mêmes ne sont ni bons ni mauvais, mais les effets de leurs actions le sont pour les humains qu’elles affectent », précise l’autrice. Pindare (518-438 av. J.-C.) écrira sur le caractère transitoire de la faveur des dieux et rapprochera le daimōn du « destin » dans une perspective positive. A l’inverse, la poésie tragique fera davantage surgir un daimōn vengeur (dans les familles d’Œdipe et d’Agamemnon, par ex.). Ainsi, dans le théâtre d’Eschyle, Sophocle ou Euripide, de même que dans la comédie d’Aristophane, les daimones interagissent avec les hommes. Le terme daimōn « identifie une qualité particulière des êtres divins, à savoir leur capacité à intervenir parmi les hommes, autour et à l’intérieur des êtres humains ». Une hiérarchie des êtres supra-humains est à l’œuvre (Platon la mentionne dans l’Apologie de Socrate), dominée par les dieux olympiens dont les daimones sont synonymes sans leur être identiques, car ils n’ont pas le même « statut ». En effet, la puissance des daimones demeure circonscrite, limitée et l’ordre hiérachique décroissant demeure strict : dieux, daimones, héros.
Une fois le terme daimōn bien dégagé, il s’agit, pour Pirenne-Delforge de chercher à comprendre comment les Grecs percevaient cette entité et comment elle a pu participer au « contexte cultuel » car, soutient l’autrice, il y a « une étroite solidarité […] entre chant poétique et pratique cultuelle ». Au rebours de ce qu’affirmait Marcel Détienne, Pirenne-Delforge tient à démontrer la réalité d’une « consistance cultuelle » du daimōn. Elle se base sur de nombreux objets concrets (et reproduits en illustration) : l’existence de « certaines lamelles mises au jour sur le site de l’oracle de Zeus à Dodone », des bas-reliefs, des vases, des graffitis, des tessons de céramiques, dans diverses régions de la Grèce (Thasos, Athènes, le Pirée, l’Arcadie, les bords de la mer Noire…). Rappelant le rituel du double nom des dieux (le nom et un attribut – l’épiclèse – comme dans « Zeus sauve-cité », ou l’association de deux noms de divinités), l’autrice explore minutieusement les invocations à l’« Agathos Daimōn » en association avec à l’Agathē Tychē (la bonne fortune, le bon sort). Elle en conclut que le dédicant doit cibler sans se tromper la divinité compétente pour obtenir l’intervention bénéfique espérée. S’il revient parfois à l’Agathos daimōn d’exprimer la puissance de Dionysos, c’est en réalité à Zeus, pourvoyeur de bienfaits, un Zeus Meilichios (doux), que s’adresse l’expression. Grâce à l’enquête serrée de Pirenne-Delforge, le lecteur découvrira de surcroît pourquoi le roi de l’Olympe, dispensateur des bienfaits est parfois figuré aux côtés d’un serpent : il existait pour les Grecs un serpent bénéfique, le « drakon » (qui donnera lieu au mot français « dragon ») gardien des récoltes et, de ce fait, honoré par l’offrande des gâteaux de miel.
Le daimōn « agit en secret », écrivait Euripide. Aujourd’hui, le daimōn habite l’espace virtuel, il circule dans les applications et les programmes informatiques. Étonnamment, la définition qu’en a donnée Nicolas Nova montre que le daimōn du XXIe siècle a conservé le caractère de son ancêtre archaïque : « les daemons sont bien des entités agissantes », écrit l’anthropologue, ajoutant : « Ils collectent des informations, les traitent et interviennent sur le monde numérique, produisant des effets sur le fonctionnement des machines et sur les réseaux. Lorsqu’ils tombent en panne, leur déficience se fait sentir. En d’autres termes, ce recours au mot ‘démon’ n’est pas qu’une simple métaphore » (1). Reste à savoir au nom de quelles divinités agissent les démons de l’espace informatique et pourquoi nous paraissons en être « d’autant plus éblouis qu’ils sont plus ténébreux », pour reprendre les mots de Victor Hugo dans Sur l’Olympe.
Chakè MATOSSIAN ■
_____
(1) Nicolas Nova, Persistance du merveilleux – Le petit peuple de nos machines, éditions Premier Parallèle, 2024, p. 39. Nous avons fait un compte-rendu de cet ouvrage dans NH n°445, 30 janvier 2025.