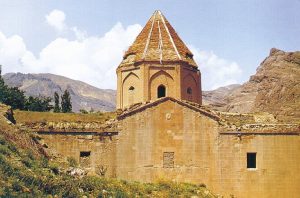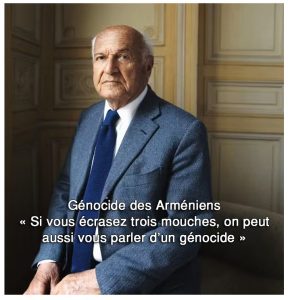Serge Uzan
Dans les pas de Jonas
(L’algorithme de Jonas)
Sorbonne Université Presses, 2023,
194 p., 18,00€
La période pascale nous offre l’occasion de méditer sur l’histoire du prophète Jonas dont l’enfermement durant trois jours dans les entrailles d’un énorme poisson (souvent appelé « baleine ») préfigure la Résurrection du Christ.
Serge Uzan, professeur de médecine, spécialiste du cancer, ancien doyen de la Faculté de médecine et également juif pratiquant, publie ses réflexions personnelles sur le passage biblique de Jonas qui ne cesse de l’accompagner depuis l’enfance et qu’il a le privilège de chanter/réciter à la synagogue lors du Kippour (jour de repentance, le plus saint de l’année juive). Pour lui, Jonas a laissé une trace de rébellion, il est le prophète qui ose discuter avec Dieu.
Le sous-titre, « l’algorithme de Jonas », paraît curieux car il assemble une méthode mathématique au nom d’un prophète dont le rôle consiste à annoncer la parole de Dieu et dont le langage n’est pas forcément clair. Un algorithme se définit par « une instruction ou une séquence d’instructions simples », écrit Uzan, notant au début du livre : « Algorithmes : séquences d’instructions pour aller d’un état A à un résultat B. Il est courant d’utiliser comme comparaison la cuisine et de dire qu’un algorithme est une recette qui permet de partir d’ingrédients pour aboutir à un plat ». L’on comprendra mieux la réunion de ce terme (‘algorithme’) et de ce nom (‘Jonas’) en tenant compte du fait que le Prof. Uzan avait été chargé de veiller au rôle de l’intelligence artificielle dans le domaine de la médecine. Il avait alors travaillé avec le mathématicien Cédric Villani qui a rédigé la préface du livre. Le modèle algorithmique qui doit prendre en considération la « boîte noire », la nécessité de l’analyse, et admettre qu’on ne peut tout comprendre, se voit également convoqué pour illustrer le rapport à la foi dans le monothéisme (le pari de Pascal) et particulièrement ce qu’est « être Juif » (le lecteur apprendra beaucoup sur la religion de l’auteur) :
« on pourrait assimiler la religion à une boîte noire, mais c’est en appliquant les ‘commandements’ qui en découlent, en les disséquant et en les commentant, que l’on peut progressivement en saisir le sens profond ou pour la kabbale le sens ‘caché’ (ou du moins… s’en rapprocher) ».
Il s’agit d’un ouvrage à la fois touffu et décousu, écrit de façon orale, en vue de toucher un large public. Mais peut-être s’accorde-t-il en cela avec l’objet même du livre puisque le texte de la prophétie de Jonas a été considéré comme « hétéroclite ou plutôt composite ». Il se pourrait aussi que l’aspect désarticulé marqué par des longueurs de chapitres très inégales ait pour finalité d’offrir au lecteur une image du rythme indissociable de la récitation chantée, la cantillation sur laquelle insistera l’auteur.
Serge Uzan rend compte de sa relation au prophète Jonas dont les Juifs racontent l’histoire le jour de Kippour. Pour rappel, en résumé (mais il faut (re)lire les quelques pages de cette courte prophétie) : Dieu enjoint Jonas de se rendre à Ninive afin de convertir ses habitants. Jonas désobéit (il écoute son intuition et se méfie des intentions des Assyriens contre Israël) ; il prend la mer, chemin opposé à la route qu’il aurait dû emprunter. La tempête divine lancée sur le bateau ne le tue pas mais il finit dans le ventre d’un gigantesque poisson qui le vomit après trois jours et trois nuits. Dieu accorde une deuxième chance à Jonas et lui ordonne une nouvelle fois d’aller à Ninive. Là, il voit que les habitants témoignent d’une grande piété ce qui engage Dieu à les épargner. Jonas n’est pas satisfait de ce revirement divin. Irrité par l’annulation du châtiment contre Ninive, renfrogné, il s’installe hors de la ville, sous un soleil qui l’accable. Dieu fait pousser un arbre inconnu, le Kikayon (souvent traduit par « ricin »), dont l’ombre réjouit Jonas ; mais voilà que le lendemain Dieu élimine cet arbre, ce qui agace à nouveau Jonas. Dieu fait remarquer au prophète qu’il s’afflige pour un arbre d’un jour alors qu’il n’a éprouvé aucun chagrin pour Ninive, ses cent vingt mille habitants et son bétail.
Si chacune des trois religions monothéistes interprète différemment la prophétie de Jonas, elles s’accordent néanmoins pour « faire la part belle au repentir ». Pour les juifs, le thème central de la prophétie de Jonas sera le pardon (la clémence divine), pour les chrétiens, le « signe de Jonas » annonce la venue du Christ (mort, rédemption, résurrection) et aux yeux des Protestants, il témoigne de la nécessité d’évangéliser, comme Jonas à Ninive, ville de Oannès le dieu-poisson. L’interprétation des musulmans varie de celle des juifs et des chrétiens : Jonas (Yunus) commence par obéir (Dieu lui promet le paradis) et ne transgresse que dans un second temps où survient alors la punition avec la tempête et le poisson. L’arbre est devenu un pied de courge et Yunus, repenti, finit paisiblement ses jours à Ninive en compagnie de sa famille que Dieu lui rend. Uzan apprécie cette seconde chance donnée à Jonas, laquelle révèle la nécessité absolue d’analyser les échecs pour que les événements indésirables ne se reproduisent plus. Il a conservé, dans sa pratique, le refus d’obéir sans comprendre et Jonas lui procure une méthode de travail, l’« algorithme de Jonas ».
L’auteur repère la présence de Jonas dans la littérature, les arts et la philosophie. Voltaire, Melville, Jules Verne et Camus, Carlo Collodi et son Pinocchio, le Robinson de Daniel Defoe se trouvent hâtivement convoqués. Parmi les innombrables œuvres d’art dédiées au prophète, Uzan détache une base de table sculptée, un bas-relief, une enluminure du XVe siècle, et la fresque de Michel-Ange à la chapelle Sixtine auxquels il ajoute un bas-relief du Léviathan, monstre auquel s’oppose Jonas pour sauver le poisson dans lequel il avait pu trouver refuge et méditer. Une tapisserie des premiers siècles du début de notre ère et une peinture d’Hippolyte Flandrin illustreront la fin du livre.

Jonas rejeté par la baleine (Lectionnaire du roi Het’oum II de 1286),
Erevan, Matenadaran, ms n°979, fol. 200 v°, source Utpictura18.
La méditation, le questionnement ne sont pas sans lien avec le rythme de la parole. Ainsi Uzan, signale-t-il l’importance de la cantillation, le respect du rythme dans le chant des textes sacrés. Une virgule déplacée peut changer radicalement le sens d’une phrase, comme le notait du reste Kierkegaard exaspéré par les ajouts des typographes : « je suis en constant combat avec les typographes qui, pleins de bonnes intentions, mettent des virgules partout et, de la sorte, détruisent le rythme ». A quoi s’ajoutent le rôle des voyelles à insérer dans les textes sacrés hébreux formés de consonnes, ainsi que le rôle de la traduction (araméen, hébreu, grec, latin) qui frôle nécessairement la trahison, comme on le sait, et donne lieu à des débats, des interprétations infinis des textes sacrés (la Torah est traduites dans toutes les langues utilisées ou parlées, note Uzan). Pour l’auteur, il conviendrait de lire la prophétie de Jonas en hébreu afin de capter les rapports entre les noms de Jonas, de Ninive et du poisson, et comme il vaut mieux lire une traduction qu’ignorer ce texte, il loue et privilégie celle qu’a faite Jérôme Lindon.
Uzan consacre une grande partie de son livre à la reprise du texte en vue d’un commentaire historique et comparatif. Iil situe le voyage du prophète et localise a ville de Ninive (Mossoul, en Irak) dont la chute aura lieu en 612 av. J.-C. Les occurrences de Jonas dans le texte Biblique permettent à l’auteur de signaler la relation qu’il entretient avec d’autres personnages, soulevant ainsi des interrogations autour de la justice et du pouvoir divin de la résurrection. Les descriptions données dans le texte, dont l’auteur reprend chaque verset, engendrent également des questions qui semblent prosaïques et pratiques mais qui, à la réflexion, s’avèrent spirituelles et symboliques (notamment le « grand poisson », les poissons en général, la tempête… ).
Serge Uzan se sent proche de Jonas à qui il pense dans sa pratique médicale : faut-il suivre son intuition, obéir aveuglément aux injonctions ? Refusant l’autorité absolue des algorithmes, Uzan rappelle qu’on ne domine pas tout, que les algorithmes recèlent une « boîte noire » et que la médecine peut-être assistée par les algorithmes mais non dirigée par elle. L’on peut penser aux récents propos du Pape François : «nous ne pouvons pas permettre aux algorithmes de limiter ou de conditionner le respect de la dignité humaine». Uzan prône la décision partagée avec le patient, la concertation et la fin du pouvoir absolu (celui du médecin comme celui de l’algorithme) : « l’incertitude est inhérente aux progrès de la science » (ce qui ne veut pas dire qu’on ne sait rien et qu’on flottaille constamment).
Rappelant que la prière de Jonas se rattache à une situation de « détresse », Uzan nous alerte peut-être sur l’état du monde actuel, se faisant en quelque sorte porte-parole du prophète. Heureusement, la prophétie de Jonas est également un éloge de la dérision et l’humour y est présent. Ce qui importe, in fine, et Jonas qui dormait allongé au fond du bateau nous le montre, est de se réveiller, de se mettre debout, de se jeter à l’eau sans crainte de se perdre car « les erreurs de chemin peuvent être porteuses d’innovations ‘involontaires’ » (la sérendipité).
Prônant la vertu didactique des contes auprès des enfants et notamment celle de la prophétie de Jonas, Uzan souligne l’importance de la transmission et de son apprentissage, lequel confère à l’adulte ce que Ricoeur appelait « une seconde naïveté ». Le plaisir que l’enfant éprouve à l’écoute de la narration, surtout si ce moment d’enchantement est lié à une célébration collective, s’inscrit dans la mémoire pour y laisser un souvenir de bonheur dont la force aidera l’adulte à surmonter les moments douloureux de son existence.
Chakè MATOSSIAN