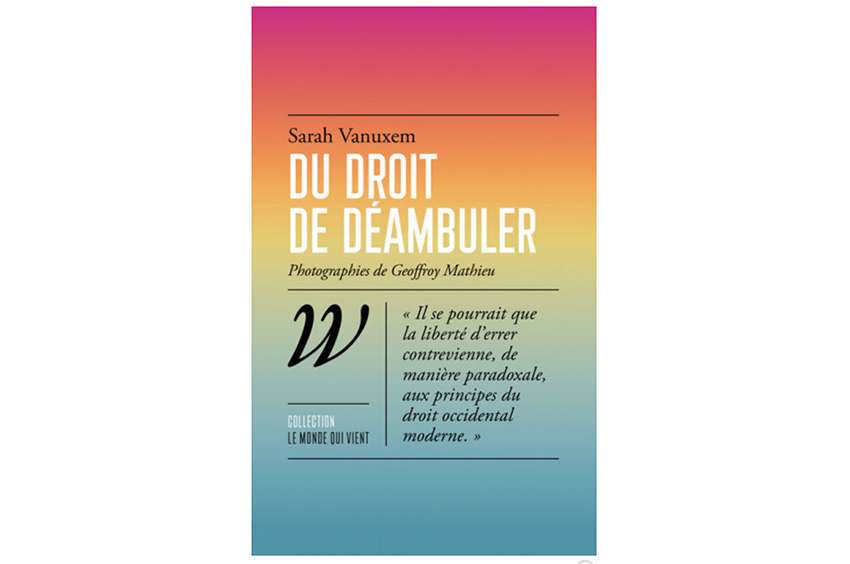
Sarah Vanuxem
(photographies de Geoffroy Mathieu)
W éditions Wildproject,
225 p., 24,00€
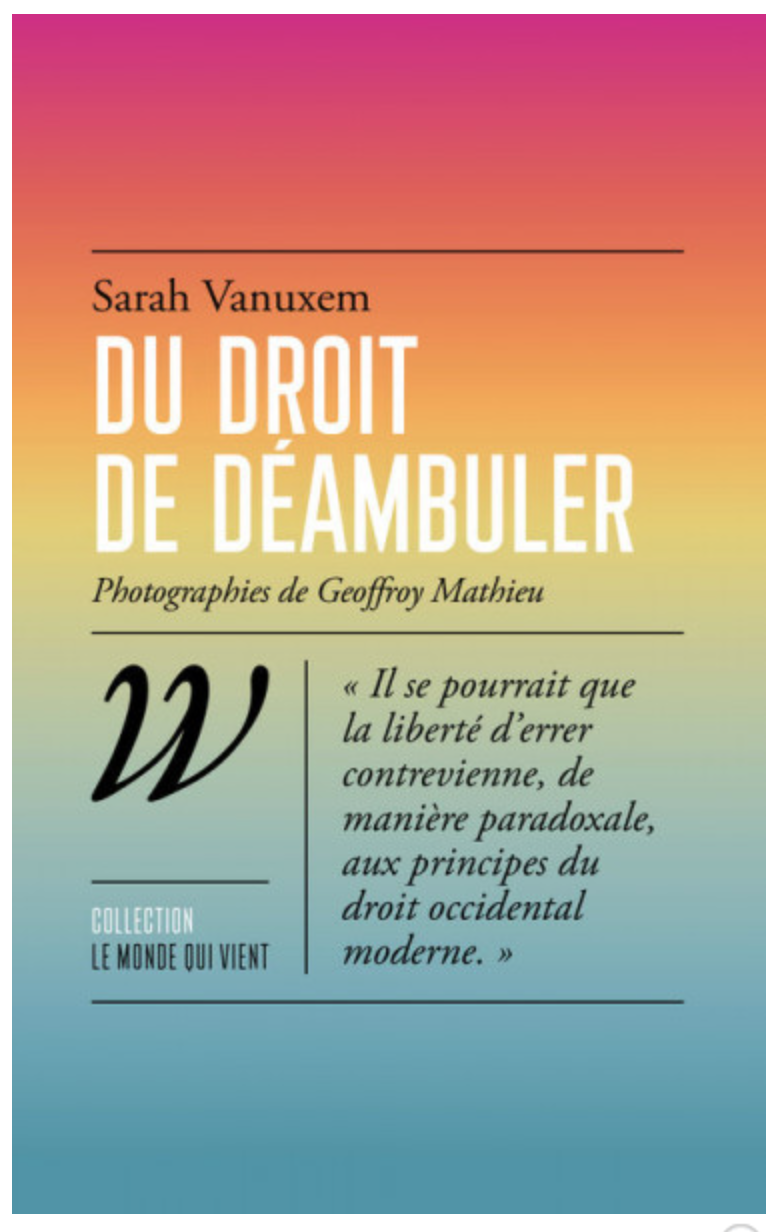
« Et si la déambulation était aux origines du droit ? », demande Sarah Vanuxem, maîtresse de conférence à la faculté de droit de l’Université Côte d’Azur. Pour aborder sa recherche sur le ius deambulantis ou right to roam, elle cite dès les premières lignes de son livre l’arrêt de 1887, « Ville de Rome contre villa Borghèse », par lequel la Cour de cassation de Rome avait reconnu « un possible droit de déambuler, au peuple romain dans les jardins privés du prince Borghèse que celui-ci avait fermés ». L’auteure reviendra du reste à cette affaire dans un chapitre à la fin de son étude, pour considérer qu’il y a eu là une victoire du « milieu », c’est-à-dire de la ville comme lieu de passage. Vanuxem voit son travail comme « une refonte écologique du système juridique occidental moderne ». On pourrait retrouver à l’arrière-plan de sa recherche l’idée rousseauiste de la terre appartenant à tous et du premier propriétaire qui, en délimitant un espace, aura engendré tous les malheurs du genre humain (1). La clôture, indissociable de la propriété, entrave le passage qui dépendra alors du droit. Selon l’auteure, « le délit de vagabondage accompagne l’essor de la société industrielle, du capitalisme et l’adoption d’une conception bourgeoise et absolutiste de la propriété ». Se référant, entre autres, au Michel Foucault de Surveiller et punir, Vanuxem s’attache à montrer que l’errance représente un danger pour les « sociétés disciplinaires ». Si le vagabondage n’est plus un délit aujourd’hui, l’interdiction de divaguer des animaux n’a, quant à elle, pas disparu. Son évolution dans le droit s’avère du reste « comparable » à celle du vagabondage humain. Et il en rira de même des végétaux, des eaux et des minéraux dont le vagabondage est également abordé ici sous l’angle juridique.
Comment concilier la liberté d’arpenter la terre et le droit à la propriété ? En relisant les Codes et en prenant en considération le « principe de solidarité écologique » (par ex. les tunnels pour batraciens, les ponts pour les cervidés…). Reprenant le Code Napoléon ainsi que les Codes civil et rural ou celui de l’environnement, Vanuxem met en évidence la complexité de la relation entre propriété et droit de passage (les servitudes pour pallier les inconvénients de l’enclave), ce qui ne l’empêche pas de faire quelques incursions dans la mythologie (la divinité romaine Terminus).
Elle souligne le lien qui rattache l’exercice des droits à la sédentarité, le Code civil à la domiciliation. Il existe au fondement du droit une opposition entre le monde domestique et le monde sauvage, opposition que le « droit de l’environnement, notamment les règles relatives à la protection des espèces vivantes, nous inviterait aujourd’hui à dépasser ». Examinant « la manière dont notre droit [= le droit français] traite du vagabondage des animaux, domestiques et sauvages, et, tout d’abord, humains », l’auteure en retrace l’histoire, allant du moyen-âge (où les déambulations humaines et animales étaient acceptées) à l’époque moderne. Dès le XVIe siècle, le manque de main d’œuvre et l’afflux de vagabonds transforment le vagabondage en délit. Des dispositifs disciplinaires (même pendant la Révolution) se mettent en place pour combattre l’oisiveté attribuée au vagabond qui subit une condamnation préventive allant de l’enfermement à l’envoi dans les colonies.
Les pauvres voyaient pourtant le vagabondage comme un droit à la subsistance faisant partie « de ces droits premiers » pour lesquels ils « étaient prêts à s’insurger ». A l’opposé, le pouvoir bourgeois, exigera le droit absolu de la propriété et prescrira une justice faisant sortir le vagabond « de l’État de nature dans lequel la paresse l’avait plongé, en le rendant actif et travailleur ». Parallèlement, la « logique bourgeoise, sécuritaire et hygiéniste » modifiera le rapport aux animaux domestiques, toujours liés à leur propriétaire et qui, errants, comme les chiens et les chats, pourront être saisis et abattus. Le Code rural reste très instructif à cet égard, Vanuxem le scrute pour voir ce qui advient aux caprins, volaille, lapins, poissons ou pigeons et essaim d’abeilles qui s’évadent de la propriété mais non du propriétaire. Elle en déduit que l’animal, « tel l’esclave ayant fui sa case », n’échappe juridiquement pas au « domaine de son maître » et que « le droit rural […] n’imagine pas qu’il puisse devenir, tout au moins de manière pérenne, un animal sauvage ».
La division des animaux en domestiques et sauvages recouvre celle qui existe entre les « états de cité et de nature », mais elle « pourrait être remise en cause aujourd’hui à la faveur, notamment, de l’émergence du droit de l’environnement ». En témoigne le cas du loup, espèce protégée qui a fait l’objet (ou le sujet) d’un arrêt de la Cour de Justice de l’U.E. le 11 juin 2020 donnant ainsi droit aux animaux sauvages protégés à « habiter la Terre et, partant, à la parcourir ». Il faut alors admettre que la vache n’a pas le même droit que le chevreuil.
Qu’en est-il des activités humaines guidées par « les droits transnationaux de l’Organisation mondiale du commerce », par la libre circulation des biens et des personnes dans l’UE, au regard du « droit à l’environnement » ? On l’aura compris, l’auteur, dans son idéal d’« écocratie », apprécierait une restriction de la libre circulation : « la liberté d’aller et venir ne signifierait plus la liberté de prendre l’avion ou d’emprunter un ferry, mais celle de se déplacer à pied ou à vélo, dans une optique tout à la fois décroissante, conviviale et écologique ». Si le réseau européen Natura 2000 et d’autres dispositifs mis en place pour préserver la circulation d’ « animaux non-humains » l’enthousiasment, Vanuxem n’en signale pas moins la contradiction existant entre ce quadrillage de l’espace, comme celui des randonnées, et le droit à la déambulation. Mais plus qu’une aporie elle y voit un accès au nomadisme qu’elle semble prôner en prenant en exemple quelques peuples étudiés par les anthropologues (Descola, Ingold, Stepanoff) pour mettre en avant le lien pouvant unir le nomadisme au droit et à l’écologie : « en dépit de leur caractère contraint et administratif, les chemins de randonnée pourraient demeurer un point d’entrée pour penser un droit de parcourir la terre qui soit un droit nomade ». Ce droit entraînerait les « droits de passer, chasser, cueillir et pêcher en de multiples lieux ». Il nous faudrait en somme renouer avec les droits coutumiers des pauvres, en accord avec un « projet de société émancipé de l’objectif de croissance économique ».
Convoquant le Code de l’environnement et la Convention européenne du paysage, Vanuxem rappelle que le paysage consiste en un lieu façonné par l’interaction des « êtres humains et non humains » dont font partie les objets (déchets) et les végétaux. En conséquence, d’une part, les randonneurs devraient pouvoir intervenir pour la préservation du paysage et, d’autre part, il faudrait prendre la défense de la végétation sauvage en proscrivant « d’attenter aux terres naturellement revégétalisées ».
Pour concilier le droit de déambuler et celui de la propriété, tout en respectant le caractère de bien commun du paysage, l’auteure analyse de façon créative et originale les aspects juridiques des droits de passage (les servitudes). Sur base de raisonnements juridiques, Vanuxem pense qu’il serait possible de parvenir à obtenir des servitudes légales de passages non seulement pour les piétons, mais aussi, éventuellement, pour les cavaliers, cyclistes, grimpeurs ou skieurs sur les domaines privés en appliquant aux propriétaires l’abus de droit. Elle propose audacieusement de combiner des articles de différents Codes entre eux et de transposer au domaine terrestre le « droit de passage inoffensif » provenant du droit maritime et déjà étendu au droit aérien. Vanuxem, telle un nouveau Lycurgue, ne cache pas qu’elle rêve « d’un droit cosmopolite de la nature, qui serait relié ou rattaché au principe de solidarité écologique ». Il est vrai que le nom de Sparte, la ville sans muraille qui n’a d’autre maître que la loi (2), signife ‘semée’, ‘parsemée’, ‘éparse’.
Chakè MATOSSIAN ■
____
(1) Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité, (1754) : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne ».
(2) Signalons l’article de Françoise Ruzé, « L’utopie spartiate », Kentron, n°26, 2010
https://doi.org/10.4000/kentron.1313