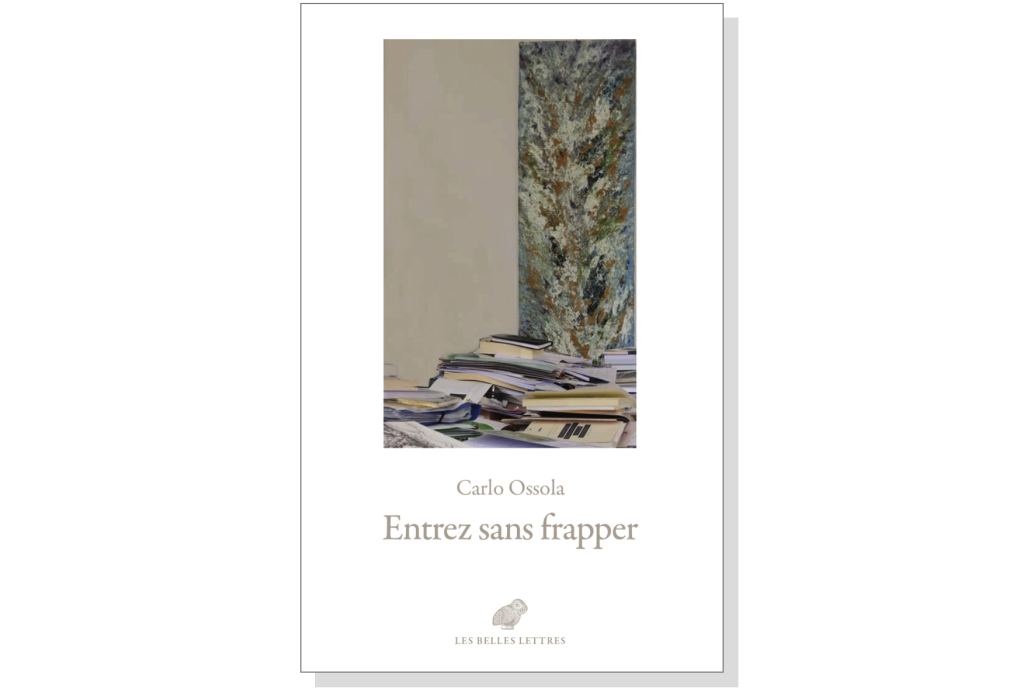
Les Belles Lettres, 2025,
302 p., 19,00€
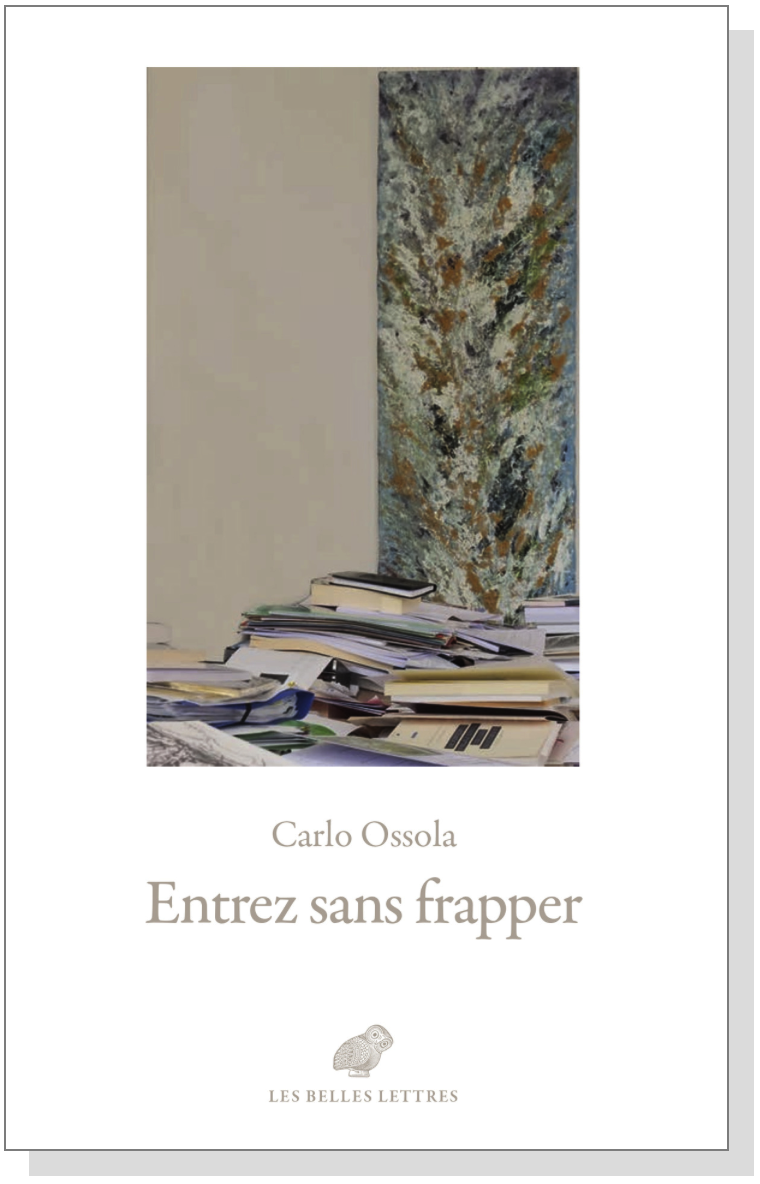
Dans Entrez sans frapper, Carlo Ossola nous mène, par l’écriture, dans l’atmosphère du bureau qu’il a occupé au Collège de France de 2000 à 2022, le « bureau 16 ». Plus qu’à l’espace, c’est au temps, à la conscience du temps vécu, que se rattache ce lieu lumineux. Ossola s’entoure de fantômes actifs, des esprits qui ont marqué sa pensée, son travail. Marcel Bataillon, Henri Focillon ou Vladimir Jankélévitch, Roland Barthes, Gaëtan Picon, Yves Bonnefoy et Marc Fumaroli (partageant une passion pour Poussin), Eugenio d’Ors, Roger Caillois, Bossuet (avec Dante et Angelus Silesius), Jean Starobinski, Marguerite Yourcenar, le poète Giovanni Giudici, les cinéastes Robert Bresson et Otar Iosseliani, le critique littéraire et ancien recteur de l’Université d’Urbino, Carlo Bo. C’est du reste là, à Urbino, dans la bibliothèque de la Fondation Carlo Bo, dans « le merveilleux Palazzo Passionei, joyau du XVIe siècle », que les livres du bureau 16 se trouveront désormais.
L’auteur se regarde en étant regardé – (il rappellera combien le mouvement du « regard » prophétisé par Léonard de Vinci agira chez des cinéastes comme Eisenstein ou Bresson) – il a inséré dans cet ouvrage dont l’élégance rend visible la beauté intellectuelle et morale intrinsèque à la discrétion, les photographies d’Edouard de Pazzis, Nicola Giuseppe Smerilli et Panthéa Tchoupani. L’une des photos (l’humour n’est pas interdit) nous montre Ossola submergé par un amoncellement de livres qui recouvre le bureau. Assurément les livres dépassent les auteurs. De surcroît, affirme l’habitant du bureau 16, « quand on a vraiment le désir de lire les livres, on n’a pas le temps de les ranger ».
La question du temps marque tout l’essai (l’ « admirable tremblement du temps », comme l’écrira G. Picon) et, avec elle, nécessairement, ce qu’il en est de la vie, de la présence répondant à la « soif de plénitude » secrètement rattachée à l’impératif absolu que Giudici concentre dans un vers : « tu sais pourquoi résister ».
Sur la photo, la partie émergée du corps de l’auteur se compose de la tête et de la main qui accompagne la parole (on voit qu’Ossola est en train de parler). La main, sans laquelle la tête ne fonctionne pas, la main que la culture a pu faire passer de la poigne violente à la poignée pacifiante (« Entrez sans frapper »). Libérée du sang, la main s’ouvre au don et il lui vient des « doigts-pensées » Fingergedanken, selon l’expression de Paul Celan, convié, lui aussi dans ce lieu-livre-bureau-en transit. L’abandon docile aux mains divines est « le legs le plus profond de la tradition chrétienne à notre civilisation », écrit Ossola.
L’œuvre dépasse son auteur en ce qu’elle ressortit à l’« inachevable », cet « interminato » dévoilé par Galilée et Pascal et relancé par Yves Bonnefoy, cet ami de l’Italie, auquel Ossola consacre un chapitre pour dire combien l’écriture du poète a su prendre en charge les « espaces sans fin au-delà d’elle ». Le seuil, plus qu’une image devient ici l’incarnation de l’accès inachevable au « bel espace de création » (qu’illustrerait sans doute l’ «univers délicat » d’Iosseliani, capable de transmuter le détail insignifiant en icône). A travers l’écriture, Ossola parvient à faire revivre aux oreilles de ceux qui ont eu le bonheur de l’écouter, la voix-même de Bonnefoy, si profonde et prenante (1). Le timbre de la voix en lien avec les silences et le rythme de l’enchaînement des mots donnent accès aux « murmures de la lumière » ou au « monde comme il se montre quand il se défait du songe », au « dieu en nous que nous n’aurons pas eu ». Rencontrer la présence, l’artiste Roman Opalka l’aura réalisé dans une œuvre infinie, obstinée, qu’Ossola intitule « L’innombrable ». Opalka, rappelons-le, a tracé des suites de chiffres (à l’infini) en blanc sur des fonds allant, au fil des toiles, du noir absolu au blanc. Rigoureuse, dominatrice, l’œuvre dépasse la temporalité du corps de l’artiste (qui, en parallèle, se capture en photo), pour entrer en connexion avec la vie comme flux : « J’ai délaissé les artifices de la matière, de la couleur et du geste, pour ne plus conserver que ce qui a trait à l’essence de la peinture, à savoir la présence et la temporalité », écrivait l’artiste, cité par Ossola.
La présence comme envol, la temporalité comme poids, rendent compte de la dualité paradoxale analysée par Eugenio d’Ors dans ses études célèbres sur le baroque qu’Ossola relit ici. La tradition baroque et l’héritage chrétien auront impliqué le besoin d’élévation dans toute humiliation, comme l’avait formulé Bossuet dont Ossola a choisi le mot d’ordre « Egredere » (« Sors ») pour l’un des chapitres du livre nous encourageant pourtant à ‘entrer’ sans frapper. Mais voilà, avec cette injonction, « Bossuet nous met en chemin, sans arrêt et sans trêve ». Ce qui semble contradictoire ne l’est pas, car l’inachevable tient du paradoxe. Chez Starobinski, il apparaît intrinsèque à la condition humaine : penser l’individu en termes universels. Il surgit sous l’expression de « l’éloquence muette » qui marque l’œuvre de Marc Fumaroli désignant ainsi « le désir de contrôler la profusion éloquente par une ascèse de la parole ». Paradoxe encore dans la question que posait Michel Butor, autre « grand ami de l’Italie », en décrivant San Marco : « Comment creuser le texte en coupoles ? ». De même, Le Greco, vu par Ors, rappelle-t-il « dans le monde des formes qui s’envolent celui des formes qui pèsent », ce qui entraîne Ossola à mentionner en passant le titre d’un livre de Simone Weil (1909-1943) La Pesanteur et la Grâce. Du côté pesant, il y a les pierres qu’il reviendra à Roger Caillois d’avoir introduites « au cœur du langage de l’univers » afin que les hommes y lisent « l’histoire entière de leur espèce ». Ossola repère dans l’écriture de Caillois, un principe aujourd’hui disparu, « la stupeur que la nature, si on l’observe avec délicatesse, suscite copieusement en nous ». C’est pourquoi, écrit l’auteur, « lire Caillois […] c’est consentir au don d’effleurer l’origine et d’accéder à l’immuable ». L’on se souviendra que Dante, décrivant la révélation du mystère trinitaire qu’il lui est donné de contempler « au sommet de son voyage au Paradis » ne peut qu’être frappé de « stupéfaction ».
Le texte-lieu-bureau d’Ossola laisse entrer, sortir et revenir tous les penseurs qui ont compté pour lui, pour la dignité de l’humain, la finesse, la délicatesse, l’amitié. Certains se sont liés d’amitié durant la vie, nombre d’entre eux se sont rencontrés autour d’un même auteur, d’un même artiste. Ils ont pénétré le monde de la musique et de la poésie, connu, savouré et transmis l’écriture des auteurs anciens, des classiques, des modernes ou des contemporains. Le livre d’Ossola nous fait découvrir une exigence que tous semblent partager et qui s’exprime dans le paradoxe de la « naturalité du surnaturel ». Le par-
fum de l’esprit autour de l’existence ne suffit pourtant pas à écarter la question difficile que posait le titre d’un livre de Marguerite Yourcenar, Quoi ? L’éternité, tiré d’un poème de Rimbaud. Question ardue et probablement aporétique. L’éternité pourrait être conçue, écrit Ossola, comme « quelque chose qui n’aurait ni de commencement ni de fin, qui dépasserait le temps en l’englobant, qui ne connaîtrait pas la mort ». Indéfinissable, l’éternité fait irruption dans l’expérience d’un spasme temporel. Parmi les livres empilés, il y en a qui insistent pour revenir en surface et vous fixer du regard. Vous saurez alors que les doigts-pensées ne sont pas encore la main agissante et c’est peut-être l’un des enseignements du
« regard de l’Autre ».
Chakè MATOSSIAN ■
———
(1) Ecouter, par exemple, sa lecture de La Maison natale, https://www.youtube.com/watch?v=gd4OTJDTm2k