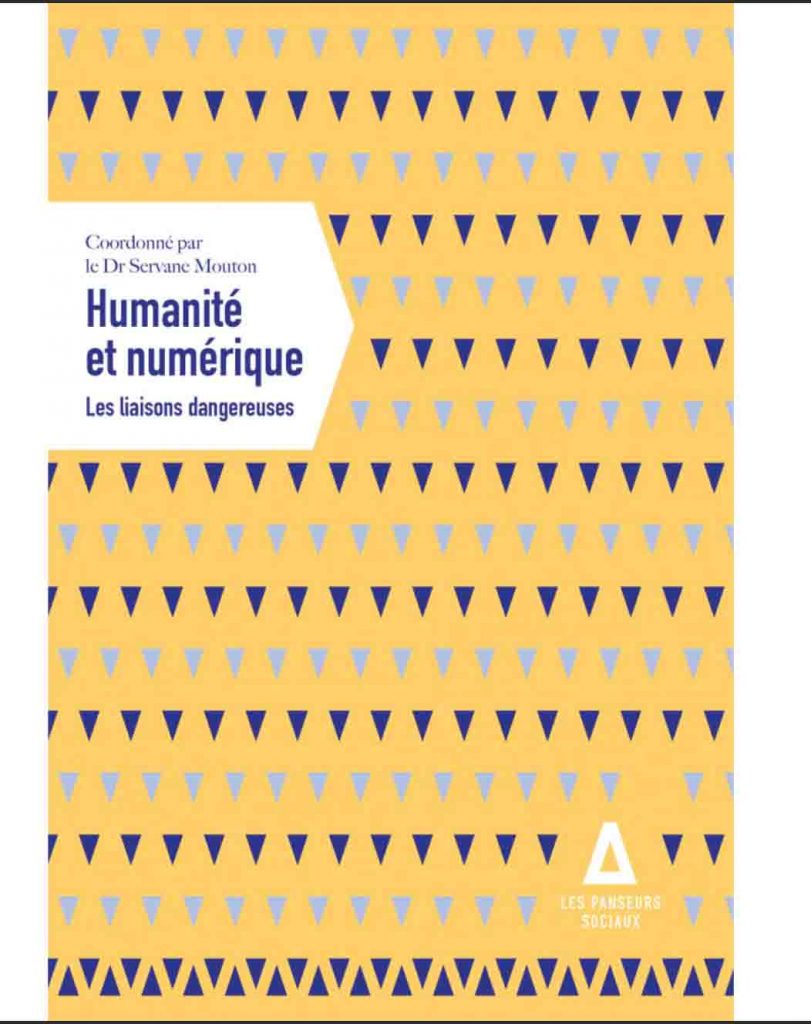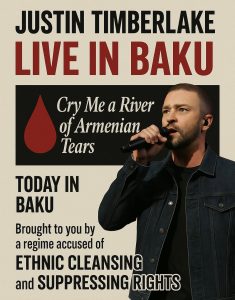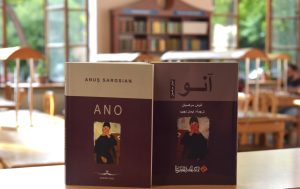Servane Mouton (Coordinatrice)
Editions Apogée, collection « Les panseurs sociaux », 2023,
335 p., 25,00€
Nous le voyons, le savons et le pratiquons : presque toutes nos activités passent aujourd’hui par un écran. Tout le monde regarde son téléphone dans les transports, même au restaurant certains ne peuvent s’en empêcher, le jour, la nuit, au travail ou en vacances. Nous nous doutons bien que cette pratique intensive de l’écran ne doit pas être très favorable à la santé physique et psychique. Toute la société, les institutions, les hôpitaux et les banques, les administrations, absolument tout dépend aujourd’hui du numérique.
L’ampleur du pouvoir des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sur les enfants, les individus et la société exigeait une étude scientifique approfondie, ni phobique ni édénique mais critique, menée sous divers angles, en majorité médicaux. Servane Mouton, neurologue, l’a bien heureusement réalisée, avec d’autres professionnels, certains médecins comme elle (neurologue, endocrinologue, pédopsychiatre, neuropédiatre, interniste, ophtalmologue) et à leurs côtés, une ingénieure en informatique, un polytechnicien, des orthophonistes, un diplômé de sciences politiques, une biologiste, des juristes, un professeur de psychologie moléculaire, un journaliste, une mathématicienne, un économiste.
Tout commence avec la petite enfance où les écrans détiennent désormais un rôle négatif important. Ils altèrent les capacités cognitives des enfants qui ne se sentent plus prioritaires aux yeux des parents trop occupés sur leur écran, c’est l’amoindrissement du « caregiving ». Parce qu’ils s’interposent entre les parents et l’enfant, les écrans perturbent l’ « attachement », lié à la figure rassurante dont a besoin l’enfant en cas de détresse, alerte Célia Levasseur (pédiatre). Accordage visuel, pointage du doigt, travail des mains, présence d’une personne, découverte de l’environnement sont essentiels au développement de l’enfant. Or, selon les chiffres de 2021 (France) un enfant âgé de moins de trois ans passe en moyenne 1h22 par jour devant la télévision ou bien 44 minutes sur un smartphone, indiquent les orthophonistes Adeline Ancenay et Fanny Simonin. Parallèlement, les auteures notent l’augmentation des troubles du langage et de la communication, y compris visuelle. L’écran ralentit la capacité à interagir, c’est une perte de temps qui est néfaste au développement des fonctions sensorielles et motrices. Les écrans forment des récepteurs non des acteurs, ils perturbent l’apprentissage difficile de la concentration qui, rappelle Dr Mouton, nécessite de distinguer les stimuli entre « distracteurs » et « utiles », tout en ne se laissant pas emporter par le flux de nos pensées. Nous recherchons le plaisir que procure la nouveauté en lien avec la « libération de dopamine » : « Lorsqu’un niveau de dopamine est maintenu élevé pendant un long temps, par exemple par des stimuli agréables répétés, les connexions avec les structures de récompense à long terme dégénèrent, au profit de celles à court terme. C’est un cercle vicieux, qui nous fait en quelque sorte courir après les ‘shoots’ de dopa-
mine », écrit Dr. Mouton. Les GAFAM font de la neuro-économie, activent les stimuli, rendent les écrans irrésistibles tant pour les adultes que pour les enfants : « mais pour les moins de 25 ans, la difficulté est décuplée car le cortex préfrontal n’est pas mature ». Nous sommes tellement accros au smartphone que même silencieux il parvient à nous distraire et donc à altérer nos performances cognitives (« brain drain »). Les écrans servent évidemment de support formidable à la publicité qui marque la mémoire de l’enfant par les logos, tout en le poussant à désirer des aliments nocifs favorisant l’obésité. Suivent l’incitation au tabac, à l’alcool, aux jeux d’argent, à la pornographie. Le pédopsychiatre Louis Forgeard dénonce les conséquences
« émotionnelles, affectives, fantasmatiques et relationnelles » de la pornographie en ligne chez les adolescents. Les sites tendent à remplacer la femme par la jeune fille, montrent des corps qui ne correspondent pas à la réalité, vantent la violence masculine, engendrent des traumatismes et une addiction, de même qu’un accroissement de la violence envers les femmes et une prostitution adolescente : « La pornographie désensibilise à la violence, à l’usage de la force, à l’humiliation dans les relations sexuelles. Elle banalise la déviance », sans nécessairement faire de l’adolescent un futur délinquant. Le porno s’offre comme solution aux questions identitaires et sexuelles des adolescents, il se substitue également à l’imaginaire, comme le font les jeux vidéos. Olivier Phan analyse les troubles occasionnés par ces derniers, leur usage excessif étant classé sous le nom de « gaming disorder »
par l’organisation mondiale de la santé. Le pédopsychiatre retrace les profils des joueurs, allant du « normal » (qui maintient ses liens sociaux, le sport, la scolarité, etc.) jusqu’au joueur « en situation de réclusion » qui sera suivi pour « refus scolaire anxieux ». Le jeu vidéo est éminemment rentable, il invite le joueur à faire des achats en ligne pour mieux performer. C’est alors aux parents et à l’entourage éducatif que revient « la lourde tâche de contrebalancer cette pression industrielle », écrit Phan.
Les études ont établi un lien entre l’usage grandissant des écrans et la perte de temps et de qualité de sommeil chez l’humain. Aurore Guyon (neurosciences), Laure Peter Derex (neurologue) et Patricia Franco (neuropédiatre) rappellent quelles sont les différentes phases du sommeil et le rôle de la sécrétion de la mélatonine. Elles décrivent la différence des effets que produisent la lumière naturelle et l’artificielle, particulièrement celle des écrans (lumière bleue) engendrant des troubles du sommeil eux-mêmes liés à des risques accrus de maladies, à quoi s’ajoutent les effets négatifs sur la mémoire et le risque d’obésité associé à la sédentarité (la fatigue n’invitant pas au sport). La présence des écrans (lumière bleue, également celle des LED, aux effets phototoxiques) la nuit constitue un « changement de régime lumineux », une « pollution lumineuse » susceptibles d’abîmer l’œil et « son élément noble, la rétine », ainsi que l’étudient l’ophtalmologue Francine Behar Cohen et la toxicologue Alicia Torriglia, qui constatent, chez les enfants, « la grande augmentation des cas de myopie dans le monde ».
La sédentarité renforcée par le temps passé devant les écrans menace la santé cardiovasculaire (AVC, infarctus cérébral) dont les neurologues Maurice Giroud, Gauthier Duloquin et Yannick Bejot analysent les augmentations en France. L’impact de l’usage des écrans sur « le fonctionnement du système hormonal », s’avère quant à lui très préoccupant chez des jeunes en pleine croissance, comme le montre l’endocrinologue Jean-Paul De Filippo. De son côté, la biologiste Barbara Demeneix se penche sur les perturbateurs endocriniens (PE) « ces agents toxiques qui diffusent incognito » et sont suspectés de produire des effets délétères sur la santé : elle en établit une liste. Les PE, dont les lobbies de l’industrie chimique et pétrolière tentent de minimiser la dangerosité, se trouvent dans les matériaux informatiques, les appareils électroménagers, les voitures, les avions, etc. Certains sont omniprésents et non bio-dégradables, ils se libèrent en poussière invisible, nous les absorbons, ils coulent dans notre sang, bref, ils sont partout, atteignent le fœtus, marquent les enfants (épigénétique) qui les récoltent aussi lors de leurs jeux au sol.
Il y a aussi les RFR, les « rayonnements radiofréquences des télécommunications mobiles » que David Gee considère à l’aune de l’histoire de l’amiante dont les effets néfastes avaient été détectés par Lucy Deane en 1898. Le lien entre RFR et cancer du cerveau, très étayé dans les études indépendantes abondamment citées ici, paraît bien être pris au sérieux par les compagnies d’assurances : ne voulant pas débourser des sommes colossales comme elles ont dû le faire avec l’amiante, elles refusent d’assurer « contre les risques de dommages causés par les RFR ». C’est un « signal fort ».
Là encore, les enfants sont « susceptibles d’être les principales victimes »
(seul le pays de Galles dispose d’une « loi sur les générations futures » de 2015), là encore règnent les conflits d’intérêt et le pouvoir de l’argent, même si de nombreuses procédures sont en cours. Pour David Gee, les RFR représentent un « cas d’école pour le principe de précaution » dont il examine les critères et les définitions. Ce principe, prévu dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fait aussi l’objet de l’étude menée par les juristes Nicolas de Sadeleer et Gauthier Martens qui analysent ici son évolution et les controverses qu’il suscite, de même que le vocabulaire variable qui manque parfois de précision : « approche » plutôt que « principe »,
« risque », « précaution » ou « prévention »…. : « Alors que la prévention est basée sur l’existence d’un risque certain, la précaution institue un nouveau paradigme en ce qu’elle introduit la possibilité d’un doute ». Le principe de précaution admet que la « suspicion d’un risque suffise pour instiguer la prise des mesures nécessaires à la prévention de ce risque », ce qui entraîne les auteurs à se demander si ce principe ne devrait pas dépasser le cadre du droit de l’environnement et devenir « un principe général de droit applicable en toute situation » mais cette fois sous forme d’ « approche » (moins contraignant).
L’ingénieure Françoise Berthoud questionne le rapport entre le numérique et l’environnement, en listant de manière précise et technique toutes les étapes du processus de fabrication et d’utilisation des « équipements terminaux » (ce que nous utilisons : smartphone, ordi, tablettes etc., soit en moyenne 8 équipements par personne dans les pays riches), jusqu’à la « fin de vie » des appareils. Gaz à effet de serre, radiations ionisantes, accélération du commerce mondial grâce à la logistique, accélération de l’obsolescence des équipements connectés (qui pénètrent aussi les foyers via la domotique), quasi-monopole de grandes entreprises et absence de « volonté politique réelle », manipulation du consommateur par le marketing créant du désir transformé en besoin, rien de ce bilan écologiquement désastreux n’est contrebalancé par le recyclage ou l’économie circulaire qui ne sont, pour Berthoud, qu’une « illusion ». Ce résultat catastrophique ne changera pas « tant que nous poursuivrons notre développement dans le même paradigme économique, tant que la nature sera envisagée comme une ressource indépendante de l’homme, et qu’une partie des femmes et des hommes sera envisagée comme une ressource pour les plus riches, que cela soit dans le métavers ou dans la réalité ». L’industrie du numérique soudée au secteur minier a besoin d’eau et le « stress hydrique » s’avère bien présent dans plusieurs régions du globe, constate Guillaume Pitron qui montre, chiffres et enquête sur le terrain à l’appui (en Mongolie intérieure), les conséquences sanitaires de la pollution des extractions et raffinages de minerais dont la demande ne fait que croître, ce qui crée par ailleurs des tensions sociales. Aussi les entreprises minières lorgnent-elles les fonds marins, ce qui augure du pire : « la prétendue ‘dématérialisation’ de nos existences pourrait avoir pour effet collatéral une destruction irréversible des derniers espaces non investis par l’homme sur la planète Terre ». C’est à l’environnement scolaire cette fois, lui aussi inséparable du numérique, que la professeure de mathématique Jane Prattico s’intéresse tant du côté positif puisqu’il peut dynamiser l’apprentissage, que du côté négatif (perte de la qualité des relations humaines, diminution des règles de politesse, pertes dans l’apprentissage de la graphie, débordement chaotique d’informations, augmentation du plagiat). De son côté, l’infectiologue Laure Chauffrey explore de façon
« technocritique » l’importance croissante du numérique dans le domaine de la santé où il occasionne une dépendance des soignants, une perte de temps, une perte de sens, la perte de qualité de la consultation. Asservi au système capitalisme, le système de santé perd son humanité.
C’est du reste un système commercial inédit qu’inaugurent les réseaux sociaux par l’exploitation des données des utilisateurs, comme le dénonce Christian Montag (psychologie moléculaire) dans une approche éthique en faveur d’un accès payant aux contenus. Les internautes qui naviguent « gratuitement » croient maîtriser le gouvernail alors que leur attention est dirigée (push, publicités, etc. sur quoi travaille la neuro-économie) et leurs mouvements calculés (algorithmes). Montag écrit : « Les médias sociaux peuvent être source de satisfaction sociale et de plaisir pour les utilisateurs. On peut même imaginer qu’utilisés et conçus correctement, ils puissent être bénéfiques à la société ». Se pose pour nous la question de la définition du terme « correctement »… Comme l’écrit plus loin le polytechnicien Philippe Compagnion, nous ne sommes plus dans « des questions de degrés » mais
« face à des ruptures ».
Observant les limites du capitalisme et l’usage des NTIC sous régime capitaliste, l’économiste Gilles Rotillon prend en compte la baisse des gains de productivité qui « se traduisent par une redistribution biaisée en faveur des capitaux plutôt que du travail, conduisant à un spectaculaire accroissement des inégalités ». Les NTIC apparaissent comme le socle sur lequel se développera désormais le capitalisme dans trois directions : les pays en développement (Afrique principalement), le secteur des loisirs (rentabiliser le temps qui ne participe pas à la création de valeur pour le capital), le domaine du vivant (génétique, pharmaceutique). Si le capitalisme de plate-forme a pu donner une illusion d’indépendance au travailleur, dans la réalité celui-ci s’auto-exploite. Le monde connecté a créé un sous-prolétariat avec les travailleurs des « fermes à clics » ou ceux (parfois des enfants) des sociétés minières dont les matériaux sont indispensables à la construction de ce monde « virtuel ». L’épuisement du secteur matériel mène les entreprises liées aux NTIC à se saisir de l’imaginaire, à promouvoir et rentabiliser le virtuel (1) comme on le voit avec les NFT dans le domaine de l’art et la promotion du métavers. C’est la « 4e Révolution industrielle » programmée par le WEG (World Economic Forum) sur laquelle nous alerte Philippe Compagnion en signalant que, pour les NTIC, l’humain se réduit à un « mélange d’animalité et de raison raisonnante » oubliant les besoins relationnels et spirituels propres à l’humain. Dans sa perspective quelque peu apocalyptique il soutient que « l’on ne fera bientôt plus la différence entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel ». N’était-ce pas dans l’effet envoûtant des « luisantes images » qu’Etienne de La Boétie, l’ami de Montaigne, repérait l’une des racines de la tyrannie ? (2)
Chakè Matossian
_______
(1) On se souviendra des passionnantes et admirables analyses, toujours d’actualité, de Jean Baudrillard (sur le simulacre et le capitalisme) et de Paul Virilio (sur le monde virtuel et l’homme suréquipé, augmenté, connecté). Voir également FRAU-MEIGS Divina, « Technologies de la fascination », Les cahiers de médiologie, 2000/2 (N° 10), p. 178-187. DOI : 10.3917/cdm.010.0178. URL : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-mediologie-2000-2-page-178.htm
(2) Etienne de La Boétie (1530-1563), Discours sur la servitude volontaire (1576): « Ainsi les peuples, assotis, trouvent beaux ces passe-temps, amusés d’un vain plaisir, qui leur passait devant les yeux, s’accoutumaient à servir aussi niaisement, mais plus mal, que les petits enfants qui, pour voir les luisantes images des livres enluminés, apprennent à lire ».