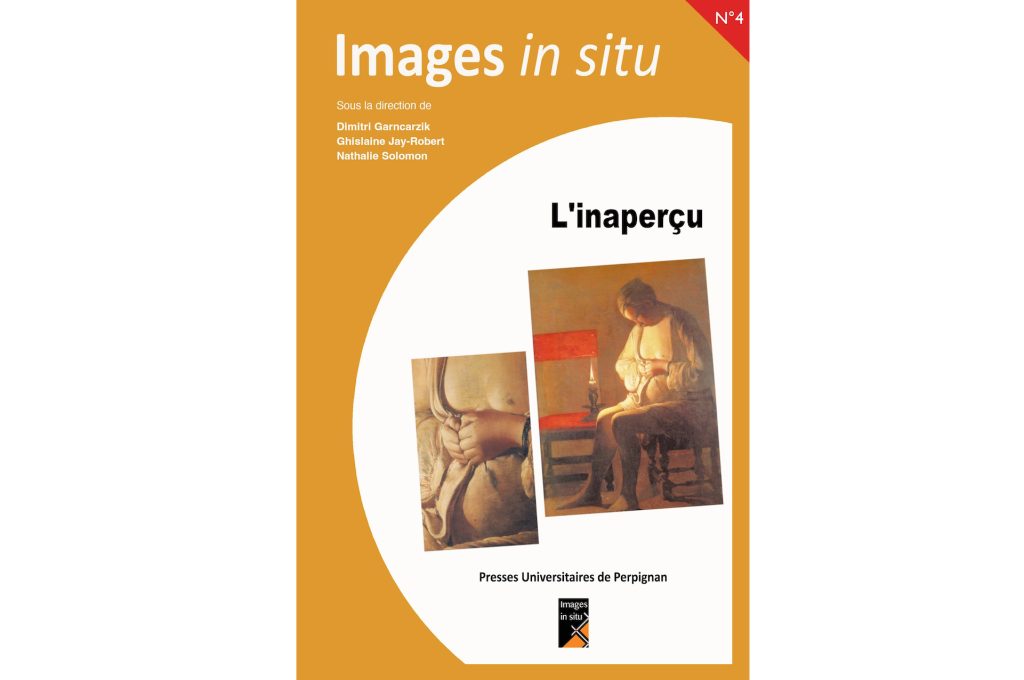
Presses Universitaires de Perpignan, 2025,
300 pages, 26,00€
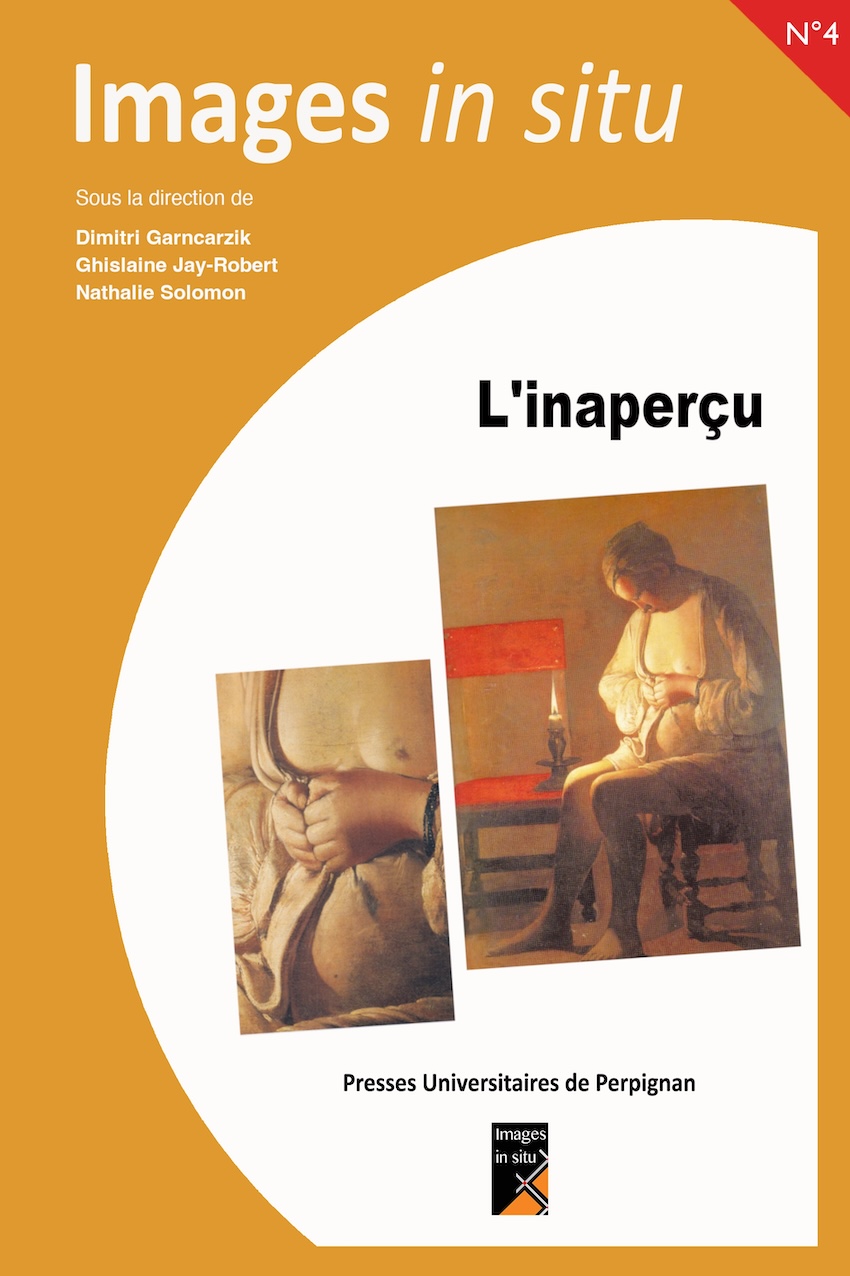
Le terme « inaperçu » désigne ce qui n’a pas (ou pas encore) été perçu, ce qui a été caché ou invisibilisé, pour des raisons multiples, allant du ludique au politique. Pour déceler l’inaperçu le lecteur, le regardeur ou le chercheur se font détectives. Aussi, l’ensemble des contributions réunies dans ce
volume rappelleront-elles ce qu’avaient théorisé Daniel Arasse, Carlo Ginzburg ou Julia Kristeva, à savoir l’importance du détail, de l’indice, de la trace et de l’intertextualité. Il faut donc distinguer l’inaperçu et l’interpréter, comme l’écrivent G. Jay-Robert et D. Garncarzyk dans l’introduction de l’ouvrage : « Postuler l’inaperçu, c’est un geste herméneutique qui consiste, par un bouleversement de nos cadres épistémiques, à se rendre disponible à des aspects insoupçonnés du réel ».
L’inaperçu peut être voulu par l’auteur, ainsi que l’observe Anne-Lise Blanc dans sa lecture des récits de Claude Simon, Patrick Modiano et Maupassant qui, dans Une vie, crée « une inaperçue structurelle » et organise l’effacement de ce personnage insignifiant appelé Lise (on s’apercevra que l’auteure porte en partie ce prénom).
La photographie fait ici l’objet de plusieurs articles (le photographe est en principe inaperçu dans la photographie et celle-ci est un révélateur de l’inaperçu). Ainsi, Barbara Bourchenin remarque-t-elle « un apparaissant, spécifiquement photographique, propre à la pratique » de l’artiste Sophie Calle qui renoue avec la question philosophique de la vision associée (depuis Descartes) au personnage de l’aveugle qu’elle met en scène. Calle demande aux aveugles : « quelle est votre vision de la monochromie ? » et déduit de leur réponse qu’il est impossible de stabiliser l’image par des mots.
L’instabilité se trouve également mise en évidence dans deux vidéos de Jacques Perconte que Cécile Delignou analyse. En compressant d’une façon particulière les données numériques des vidéos, Perconte a créé deux œuvres, Àrvore da vida et L’écume du phare, dans lesquelles il cadre, d’une part, un bosquet dans une forêt à Madère et, d’autre part, l’eau agitée de la Manche. Pour Delignou, « dans les deux œuvres de Perconte, l’instabilité des images et le caractère transitoire des formes permettent de réfléchir la notion d’inaperçu ». En ramenant tout à la surface, l’artiste essaie, selon ses propres termes,
« d’écraser les plans et de rapprocher les éléments pour ramener leurs vibrations lumineuses à un seul espace ».
L’inaperçu demeure perceptible et laisse des traces, il affecte le vécu corporel, explique Christine Leroy qui souligne son intervention dans le rapport à l’autre, en tant que « phénomène d’empathie kinesthésique » (en référence à l’Einfühlung conceptualisée par Edith Stein), soit encore « une aptitude fondée neurophysiologiquement et kinesthésiquement ».
La fadeur pourrait s’apparenter à l’inaperçu. Youyou Guitard-Wu nous apprend qu’elle est un critère esthétique majeur de la création picturale et poétique en Chine. Les peintures classiques « Montagne-Eau » font vibrer en elles les lois fondamentales de l’univers en répondant à une exigence de « fadeur », « valeur la plus recherchée » qui tient d’une sorte de vide, se rattache au souffle-énergie (le qi) et que l’auteur rapproche du « certain vide constituant » de Merleau-Ponty. C’est le principe du Vide ou « l’esprit du chán, qui engendre la beauté de la fadeur », écrit Guitard-Wu. Une tout autre forme du vide est travaillée dans le tableau de Jean-Léon Gérôme (1824-1904), Jérusalem dans lequel les ombres portées se substituent au sujet (la Crucifixion) et qu’Emma Sutcliffe interprète selon une « triple symbolique », en insistant sur la modernité de l’artiste.
Ce qui nous entoure au quotidien reste souvent inaperçu. Amélie Adde repère l’intérêt que lui a porté Velasquez dans son tableau de la période sévillane, Vieille femme faisant frire des œufs (1618). Les objets modestes, relevant de l’inaperçu, créent une insertion de la nature morte dans le tableau et l’ambiance austère ainsi que les gestes des personnages donneraient lieu à une allégorie de la charité. Mais plus que tout, les ébréchures et autres traces d’usure se font empreintes de la temporalité (la répétition des gestes) tout en conférant une dimension esthétique au « défaut ». C’est la présence de la gravure anglaise dans les descriptions du décor du quotidien des intérieurs allemands au XIXe qu’observe pour sa part Violaine Gourbet. Les auteurs et la qualité artistique des œuvres passent inaperçus, les gravures n’ont d’autres fonction que de remplir un vide, sauf pour l’amateur qui y recourt afin d’étudier à son aise le tableau absent. Est inaperçu ce qui se « perd dans les replis du quotidien » dont Christophe Reig examine les multiples dimensions dans l’œuvre de Perec et de la littérature perecquienne des années 1960-1970. La démarche, d’apparence triviale, parvient à recenser les « angles morts » en contestant les invisibilisations dont font partie les « marginalisations sociales ».
La mouche, détail dans la peinture, a une longue histoire. Katalin Bartha-Kovács l’examine, avec la puce, dans deux tableaux de Georges de La Tour (1593-1652), Le vielleur à la mouche, La femme à la puce (où la présence de l’insecte n’est pas démontrée mais seulement supposée). Adoptant, lui aussi, l’attention au détail, Marcin Skibicki étudie les affiches publicitaires des villes balnéaires de la Belle époque pour y déceler un « processus de légitimation culturelle ». Liées au développement du chemin de fer, les affiches révèlent d’abord une profusion de détails répondant à une exigence narrative et à une horreur du vide propre à l’art nouveau pour privilégier ensuite un style plus austère en accord avec l’art déco. Dans tous les cas, l’ajout ou la suppression du détail restera soumis à la nécessité de donner à l’image une « force de suggestion ».
La suggestion et l’invisibilisation font partie des régimes autoritaires. Virginie Gautier N’dah Sekou et Sabrina Grillo étudient le hors-champ du photo-journalisme afin de révéler comment les regards photographiques portés sur la « semaine sanglante » de Séville en juillet 1931 ont pu façonner « un véritable imaginaire de la contestation, basé sur le registre de la suggestion et des émotions plutôt que sur celui de la preuve et de la démonstration ».
Les photographies répertoriées dans les magazines de l’époque mettent l’autorité en spectacle et participent « à un phénomène de décontextualisation voire de dépolitisation des événements ». Elles concluent : « La construction dans la presse d’une imagerie ‘en creux’ de la violence révolutionnaire, associée à la peur, contribua ainsi à nourrir les fantasmes d’une ‘légende rouge’ autour de la jeune République espagnole, fantasmes qui présidèrent au coup d’État militaire du 18 juillet 1936 ». La violence existe aussi comme « hors-scène » dans le théâtre d’Aristophane dont Emmanuelle Jego détaille la construction, tout comme elle constitue l’objet central du photographe de guerre. Si celui-ci reste inaperçu dans les photographies, il sort néanmoins de l’invisibilité à travers la narration de l’exploit que consiste sa présence héroïque en zone de conflit. Comme le montre Jean Kempf, ce processus d’auctorialité s’avère crucial au moment où l’IA étend son pouvoir. La violence réside aussi dans l’exercice du « discours dominant », lequel décide d’ignorer la réalité que recouvre le nouveau pronom « iel », défendu par Béatrice Alonso. Elle en appelle aux écrits de Paul (Beatriz) Preciado pour décréter l’advenue d’une « nouvelle perception du réel » fondée sur une pensée « débinarisée et décolonisée », « forcément antispéciste ».
Fabrice Parisot se réfère à la pratique de l’intertextualité pour explorer le roman de l’écrivain cubain Alejo Carpentier, Concert baroque (1974) dans lequel fourmille une multitude de citations et d’allusions parfois masquées, parfois clairement désignées. Parisot en découvre la portée esthétique, culturelle et messianique. De son côté, Giulia Verardi propose une lecture de la dystopie écrite par Mary Shelley, Le Dernier Homme (1826), récit parsemé d’éléments biographiques plus ou moins cryptés et d’allusions littéraires, offrant une interprétation originale de l’apocalypse (1). En effet, le protagoniste principal « invisible aux yeux des êtres humains », n’est autre que l’élément vivant à l’origine d’une épidémie de peste. Si la propagation de la peste sous-entend la fin de l’empire britannique, elle signifierait aussi que la fin de l’homme n’est pas la fin du monde. L’inaperçu serait alors la fin de l’anthropocentrisme.
Chakè MATOSSIAN ■
———
(1) Voir également les interprétations originales de l’Apocalypse développées dans le n° 71 de la revue Terrain. Nous en avons fait le compte-rendu dans Nor Haratch, n°465, 19 juin 2025.