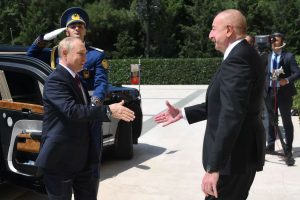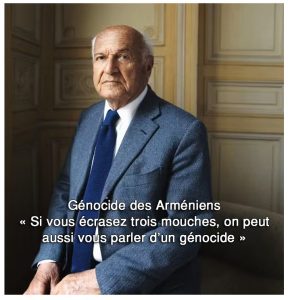Textes réunis et présentés par Bertrand Rougé
Presses universitaires de Pau et des pays de l’Adour,
259 p., 20,00€

Pline l’Ancien raconte qu’Apelle, le plus grand peintre de tous les temps (passés et à venir, souligne l’auteur latin), admirant le travail de Protogène, lui trouvait « un fini excessif » et disait « que tout était égal entre lui et Protogène, ou même supérieur chez celui-ci ; mais qu’il avait un seul avantage, c’est que Protogène ne savait pas ôter la main de dessus un tableau : mémorable leçon, qui apprend que trop de soin est souvent nuisible ». Le
« charisme » des peintures d’Apelle provient du non-fini qui les habite. L’on voit ainsi que dès l’Antiquité s’est posée la réflexion sur l’inachevé et le caché qui sous-tendent la création artistique. Le titre de ce beau volume, Inachever/cacher annonce, par l’infinitif, l’action d’inachèvement. La question sera celle du rapport entre l’art et la vie, qui engage celle de l’énergie.
Ce livre collectif réunit des études sur le « geste soustractif censé présider à la production d’une œuvre », ainsi que l’écrit Bertrand Rougé qui en est le coordinateur. Il dédie l’ouvrage à des penseurs de l’esthétique qui, aujourd’hui disparus, ont marqué la théorie de l’art, comme Louis Marin, Daniel Arasse, Raymond Court, Jean-Louis Leutrat, Françoise Escal. « Inachever », transcrit ici comme un verbe annonce déjà l’action comme une mise en mouvement paradoxale de l’œuvre d’art qui soustrait et ajoute, comble une absence et la révèle tout à la fois. La complexité de l’inachèvement se trouve interrogée selon des perspectives théoriques, esthétiques, poïétiques et historiques, dans différents domaines artistiques. Si « inachever » une œuvre revient à ne pas imposer un produit fini, surchargé, clos sur soi, à savoir retirer sa main du tableau au moment opportun, « cacher »
revient aussi à cacher la maîtrise derrière une apparence de naturalité, ce qui est l’« effet d’inachèvement », lequel revient à un accomplissement caractérisant l’esthétique classique de l’achèvement.
Soustraire et additionner, construire et détruire par « le dernier coup de pinceau qui fait tout disparaître » (Giacometti), considérer l’effacement comme « un pas de plus dans le processus de création » (De Kooning), manifestent le besoin de faire une « œuvre ouverte » non pas en vue d’un public qui y interviendrait mais bien en tant que tentative de renouer avec l’énergie de l’ouverture intrinsèque à l’œuvre : « la dynamique ou l’énergétique supplémentaire de sa dimension soustr-active », écrit Rougé.
Dans sa profonde réflexion philosophique, Isabelle Thomas-Fogiel propose une compréhension « positive » du terme « inachever », faisant passer la notion du passif à l’actif » : « inachever » au « sens fort » est l’acte d’inachever, qui n’est ni l’accomplissement (effet d’inachèvement) ni l’impossibilité (échec), mais bien un « processus volontaire qui serait à lui-même sa propre fin ». Inachever pourrait être compris comme la relation dynamique entre le spectateur et l’œuvre (d’où son questionnement final sur la « perception »), un nouage qui « ne signifie pas que l’œuvre dépend de celui qui la regarde […] mais signifie que tout art entraîne un processus, ne vit que de ce processus, est ce processus même qui doit sans arrêt se continuer, en un mot s’inachever ». A cette vision phénoménologique correspond, dans l’histoire de l’art, la position d’un Daniel Arasse pour qui l’œuvre se continue à l’infini, réunissant les interprétations passées mais aussi futures, déjouant l’univocité, faisant reculer les limites. Des dispositifs créés par des artistes comme Turrell, Rauschenberg produisent, par l’interaction avec le spectateur, « un produit fini qui rendra possible une infinité de variations », tout comme l’avait fait l’écrivain Laurence Sterne (1713-1768), laissant le soin au lecteur d’écrire l’une des pages de son Tristram Shandy, œuvre littéraire que cite également Ronald Shusterman dans sa réflexion sur la mise à nu et le caché dans l’art. Thomas-Fogiel repère dans les Works in progress de l’artiste américain Robert Irwin (né en 1928) les « deux dimensions d’illimitation de la limite et de démultiplication perspective » se confrontant avec
« l’intentionnalité comme visée ». Inachever « pourrait bien être la structure même de l’intentionnalité humaine ; si le mot n’existe pas, c’est peut-être parce qu’il est l’une des conditions de possibilité ultime de toutes nos prestations cognitives ».
Joëlle Zask étudie l’inachèvement comme fondement et moteur de la démocratie libérale ; il est intégré dans la Constitution américaine (1787) sous le terme d’« amendement ». Ainsi : « la démocratie apparaît moins comme un régime politique fixe que comme un ensemble de dispositifs légaux garantissant leur propre suppression quand les intérêts du peuple le requièrent ». Alors que les lois tendent vers la fixité en s’accrochant à leur pouvoir, l’expérimentation utilise des données qu’elle met en relation, créant des interactions productrices de changements, de transformations, recherchées mais aussi parfois imprévisibles. C’est ce qui permet à l’auteur de rapprocher le politique, la science et l’art qui interagissent avec un passé, une tradition en vue de leur transformation : l’achèvement ne peut avoir lieu que du point de vue d’un absolu idéologique ou religieux, alors que « du point de vue du raisonnement expérimental, l’expérience est d’autant plus conclusive qu’elle est convertible en ressources d’investigations ultérieures ». Ronald Shusterman examine, l’inachèvement, en se référant à des œuvres précises, selon quatre catégories (dont il reconnaît qu’elles sont « labiles) :
inachèvement matériel (intentionnel ou accidentel), inachèvement narratif (l’œuvre est achevée, mais pas la chose qu’elle relate, comme la Tour de Babel), l’inachèvement herméneutique (le sens est à rechercher par le lecteur ou le spectateur), l’inachèvement perceptuel (instabilité de la perception de l’œuvre). Affectionnant les catégories, Shusterman en propose huit autres dans la partie du livre consacrée au cacher, l’auteur les veut « rhizomatiques » et non rigides, pour « dégager les grandes lignes du phénomène » : ne pas montrer les astuces, effacer les défauts, garder un secret, bloquer la réception de l’œuvre, provoquer une désorientation, « cacher par excès d’information », « crypter le sens ».
Dominique Chateau, convoquant de très nombreux philosophes, des écrivains, des œuvres musicales et filmiques, veut appliquer « la logique de l’in- au fragment », à savoir l’indétermination ouverte à l’infini des possibles. L’inachèvement, dans sa relation à l’infini, s’avère essentiel à l’esthétique du romantisme allemand comme le montre Oliver Schefer dans une analyse serrée où domine Novalis et ses lectures de Fichte, notamment. Chaque œuvre est à la fois une « petite totalité » et un « fragment d’une totalité à venir », désarticulant par là-même l’Absolu qui, loin d’être auto-suffisant, ne peut être connu qu’en énigme et en miroir.
L’inachèvement (le non finito de Michel-Ange) est, en plusieurs façons, intrinsèque aux sculptures de Rodin, comme le montre Aline Magnien qui établit aussi des rapprochements avec Cézanne. Pour Rodin, seule la « masse »
importe, aussi en vient-il à considérer ses fragments et esquisses comme des œuvres en ce qu’elles laissent, métonymiquement, appréhender le tout, donner à voir un mouvement qui n’est, finalement, que l’incarnation de la durée. Il pose donc, en occupant l’espace, la question du temps et de l’émergence de la forme. La temporalité étant la « dimension naturelle » de la musique, comme l’écrivait Jankélévitch, la longue étude historiquement contextualisée de Marie-Noëlle Moyal sera consacrée à « achever-inachever ? » chez Pierre Boulez pour qui l’achèvement des créations reste « provisoire », dès lors que le principe de leur développement relève de la « spirale ».
Constatant l’impossibilité de posséder la vie qui est en nous, Yves Klein reste hanté par la nécessité de performer l’absence d’œuvre et la dépersonnalisation de l’artiste au bénéfice du « prestige » de la vie. Filippo Fimiani, faisant appel à Michel de Certeau et à la phénoménologie, décortique habilement les modes opératoires auxquels recourt Klein, dans ses discours comme dans l’ « Exposition du vide » qui s’était tenue dans les milieux chics et branchés du Paris des années 50 : « le lieu vide de la galerie réaliserait, selon Klein, une réalité picturale invisible », qui consiste finalement en un climat pictural ou une feintise d’atmosphère.
La poétique de l’inachever fait tourner le film Two-Lane Blacktop (Macadam à deux voies, 1971) de Monte Hellman, réalisateur attaché au mythe de Sisyphe, comme le signale Suzanne Liandrat-Guigues. Tenant compte de l’image-mouvement théorisée par Gilles Deleuze, elle analyse cette histoire de courses automobiles comme monstration de la durée qui procède techniquement de l’inachever : « le film devient la parabole du récit qui lui-même se calque sur ce modèle ». Il met « en crise » l’image-action. Le cinéma sera également étudié par Alban Pichon qui se concentre sur l’œuvre de Jean-Louis Leutrat (Liandrat-Guigues et lui ont consacré un ouvrage à Alain Resnais), qui « invite à réévaluer la part d’invisibilité au cinéma ». Pichon étudie chez Leutrat le goût de l’implicite, l’observation des systèmes déviants (construit par les grands cinéastes au sein même du cinéma hollywoodien), sa démarche de « micro-analyse », le pouvoir du détail, la composante arachnéenne, la « visibilité hors du regard », la stéréoscopie,
C’est le mouvement constitutif de la figure (définie par Aristote comme déplacement) qui permet à Bertrand Rougé de poser un « paradigme de Pénélope ». Par son double travail de fidèle épouse (tisser le jour et détisser la nuit) Pénélope inachève, elle œuvre en fonction de la vie (puisqu’il s’agit du linceul de son beau-père). Rougé en vient alors à questionner le vandalisme réalisé par des artistes : certains par intérêt financier touchent ainsi l’assurance qui donne officiellement une valeur artistique à un objet ready-made ; d’autres, par esprit révolutionnaire, futuriste ou avant-gardiste, posent une altérité à détruire. Somme toute, la question n’est pas de savoir comment commencer une œuvre, mais quand l’arrêter, écrit Rougé en citant Arshile Gorky (en 1948) : « When something is finished, that means it’s dead, doesn’t it? […] The thing to do is to always keep starting to paint, never finish the painting”. L’œuvre ne finit pas plus dans l’espace que dans le temps, elle questionne le « contour » qui doit cerner sans finir, comme le sfumato de Vinci produisant « un état diffus d’émergence » (Chastel, cité par Rougé). L’inachever actif est le processus d’altération que Rougé examine chez Rauschenberg (l’effacement), Oldenburg (l’ambiguïté) et chez le génial Gordon Matta-Clark (1943-1978). Celui-ci pratiquait des « découpes spectaculaires » dans des bâtiments désaffectés, proposant ainsi une expérience esthétique, « anarchitecturale », associée à une « réflexion socio-politique sur la ville et l’architecture », bref il a fait bouger les repères du langage architectural même dans les documents de propriété, transformant le « real estate » en « fake estate ». La citation de Rauschenberg « Painting relates to both art and life. Neither can be made (I try to act in the gap between the two)”, ne fait que confirmer l’importance de la question qui occupe toute l’histoire depuis l’Antiquité : « la question difficile et paradoxale du stockage de l’énergie ».
Pour Jean-Pierre Cometti, « montrer, cacher, révéler se conjuguent à la croyance et par conséquent à un certain type de rapport à la vérité » qui délivre une injonction morale : ne pas tromper, qui sous-tend la critique de la mimesis depuis Platon. La couleur, en tant que fard, trompe elle aussi, mais Georges Roque relève son ambivalence : elle peut également se montrer pour elle-même. Il se penche sur « les modalités du montrer chromatique » et le principe de lisibilité du processus de construction (échafaudage), en recourant par exemple aux propos de Malevitch sur la Cathédrale de Rouen peinte par Monet. Malevitch y voit la monstration des pousses de couleur, il y a là, la peinture de la couleur même.
Si le camouflage ressortit au caché, il pourrait aussi n’être qu’une « détermination particulière d’un mode d’être plus profond, un éthos du caché qui donnerait toute sa singularité au mode d’être animal », écrit Bertrand Prévost qui cherche avec enthousiasme « ce que cacher ou dérober au regard signifie en profondeur ». Au-delà des traits formels et chromatiques, le camouflage concerne tout un milieu. Parce qu’il réalise une mise en retrait de l’individualité, il permet de réfléchir aux « processus de différenciation », aux
« dynamismes individuants » ; la désindividualisation du corps qui s’effectue chez les animaux par un camouflage qui peut être collectif (les flamants roses) les transforme en « authentique apparence », par quoi Prévost relie le cosmétique au cosmique.
Ce qui paraît évident n’en détient pas moins de mystère : les arts mimétiques sont, pour Bertrand Rougé, indissociables du caché. « Encrypter » s’avère « une condition figurative nécessaire à la mimèsis », révélant un goût du mystique (au sens ce qui a trait au secret) dans le jeu de double lecture (chez Jasper Johns), dans l’anamorphose et l’encryptage (Holbein), l’abstractionnisme et ready-made (Marcel Duchamp), la démarche poétique de Tom Phillips (I have to hide to reveal). Finalement, ce sont peut-être les cavernes préhistoriques ornées qui sont à même de nous révéler l’encryptage comme mode de production et d’accès aux œuvres visuelles. Relisant la Poétique d’Aristote, Rougé repère le cacher comme « condition nécessaire pour répondre à la fonction première de la mimèsis », celle de procurer le plaisir qui accompagne le geste de « faire venir à l’évidence ». Plaisir de la découverte associée à l’énergie vitale. Découvreur de la vie des formes artistiques, Henri Focillon, alertait : « L’achèvement, le fini, le fait de tout dire sans rien omettre, c’est la limite et la mort ».
Chakè MATOSSIAN ⊆