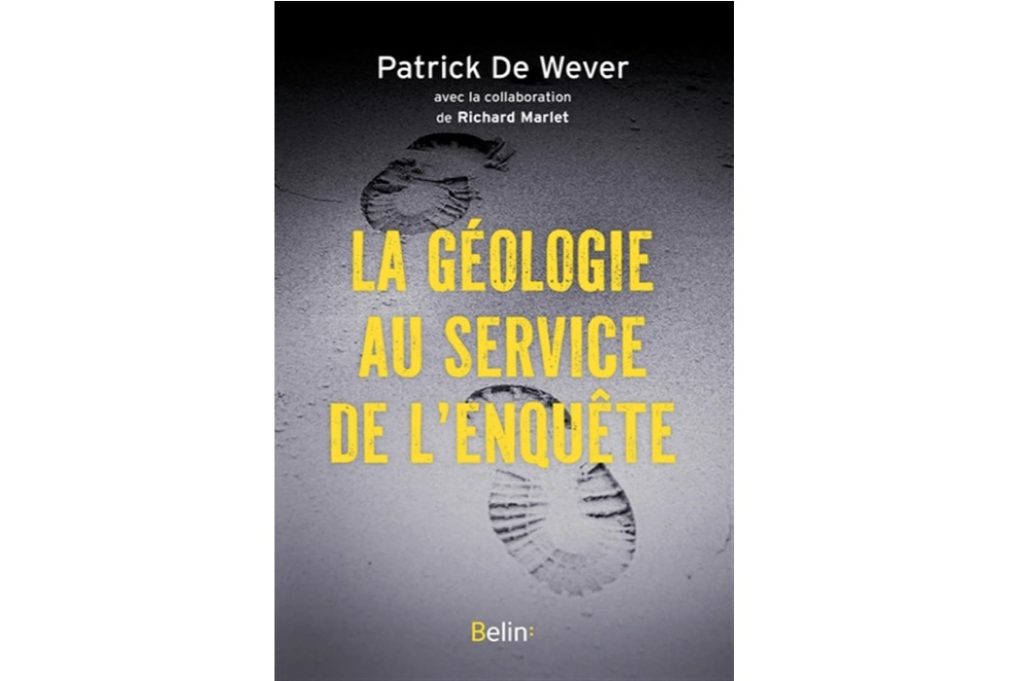
Patrick De Wever
Avec la collaboration de Richard Marlet
Editions Belin, 2025,
287 p., 23,00€
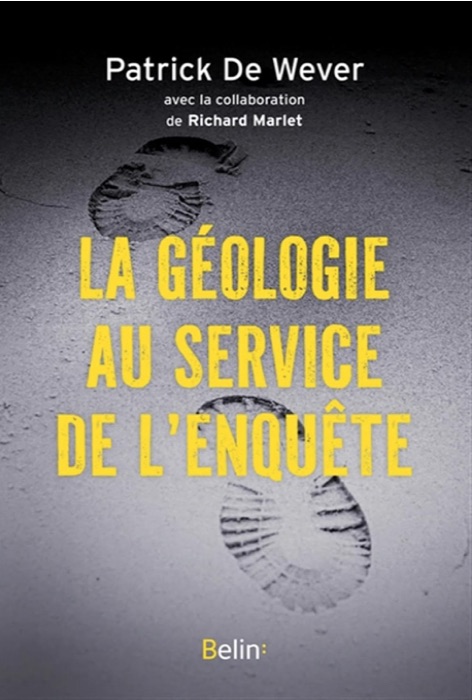
« Un caillou n’est qu’un caillou pour le profane », affirme Patrick De Wever, géologue et professeur émérite au Muséum national d’histoire naturelle, qui étudie ici le rôle des géosciences ou plutôt des sciences forensiques (étymologiquement du latin « forensis », devant le forum, judiciaire), à savoir les sciences dures utilisées dans les enquêtes de la police. Mais, comme le signale l’auteur, les géosciences sous-tendent aussi l’activité militaire, les fouilles archéologiques ou l’ingénierie civile. Elles permettent la lecture et l’interprétation des indices, elles révèlent le rôle majeur de l’infiniment petit.
Dans ce livre instructif qui se lit comme un polar, l’auteur reste pédagogique sans être ennuyeux, il rappelle rapidement quels ont été les criminologues scientifiques pionniers, parmi eux : Edmond Locard (1877-1966) qui a fondé le premier laboratoire dédié aux sciences du crime en se basant sur les interactions entre le criminel et la scène du crime. Paul Leland Kirk (1902-1970) pour qui chaque objet de notre environnement est unique ; Keith Inman (généticien) et Norah Rudin (biologiste) qui recourent à la divisibilité de la matière dans laquelle ils scrutent les propriétés physico-chimiques et enfin Pierre Margot attaché aux traces.
De Wever nous met en garde contre l’opposition couramment établie mais artificielle et fausse entre le monde minéral et le monde vivant. Il nous faut penser la durée hors de la temporalité humaine. Si la déformation des pierres s’avère lente, elle n’en existe pas moins. La vie éphémère des fossiles ne s’étend que sur 50000 ans, signale au passage l’auteur. Il lui a donc paru nécessaire de consacrer quelques pages à rendre compte de l’étendue du monde des « cailloux », des différentes catégories de roches qui le composent et du vocabulaire précis qui les désigne. Les pierres vivent et parlent.
Un caillou, sa poussière et ses grains, proviennent d’un lieu, ils constituent une trace, un révélateur unique et objectif sur lequel se base l’enquête policière. C’est en trouvant d’infimes particules et en les lisant, que l’enquêteur pourra éclaircir un mystère, accéder à la cause d’un événement. De Wever retrouve le vertige (quasi pascalien) devant les infinis en constatant « que ces infiniment petits et infiniment vieux à l’échelle de l’homme revêtent une importance de plus en plus grande à l’aube du XXIe siècle ». Les géologues de la police utilisent bien évidemment les méthodes et les outils propres aux sciences de la terre : machines et moyens optiques ou acoustiques, tels que rayons X, spectromètres, exoscopie, sondes électroniques, géoradar, drones équipés de capteurs d’imagerie multispectrale. De plus en plus performants, ces moyens ouvrent l’accès à l’intérieur de la matière, dévoilant la richesse inouïe d’éléments obtenus dans un fragment infime, rendant tangible l’invisible. L’auteur insiste sur les possibilités qu’offre la télédétection par laser (LiDAR : laser imaging detection and ranging) utilisée dans la topographie, la géologie, la météorologie, l’astronomie, l’agriculture, l’archéologie (d’antiques complexes urbains ont ainsi été découverts en Amérique du sud). Sans oublier bien sûr son usage militaire : « Le Lidar est un outil précieux notamment lors des conflits armés, car il permet de détecter des blindés mis à couvert dans les bois, sous la végétation ».
S’appuyant sur de nombreux exemples (94 « Affaires »), De Wever montre combien une particule invisible permet de retrouver la trace des criminels, de confondre des faussaires en art, de découvrir l’endroit exact où ont été commis un meurtre, un viol, une substitution de cargaison (du parfum ou de l’or remplacés par du sable ou des pierres), de retrouver des dépouilles de soldats, de comprendre un accident, de déceler dans un ensemble de dalles en pierre lesquelles ont été creusées pour transporter de la drogue, de mettre au jour les supercheries scientifiques concernant des météores, ou de fausses sources de pétrole détectées dans des pierres trafiquées. Pour comprendre l’origine et le déroulement d’un meurtre ou d’un accident, il faut lire les traces matérielles inévitablement laissées par un objet : un contact a eu lieu en un endroit à un certain instant et ce contact unique dans le temps et l’espace laisse une trace, même invisible. Grâce à l’analyse de la terre, du pollen et des pierres l’enquêteur connaît le type de végétation qui en dépend et peut ainsi déterminer, par exemple, l’origine du vol d’une quantité d’arbres, de même que la provenance de poteries dans les fouilles, les fausses antiquités, la provenance d’un marbre et sa datation, ou encore établir l’histoire d’un échange de marchandises, de circuits commerciaux. Les grains de sable diffèrent selon leur emplacement géographique et chaque type de verre détient ses caractéristiques optiques. Ainsi, l’exoscopie permet-elle d’examiner la « mémoire des grains de sable ». Les fossiles fournissent également d’utiles renseignements : « les expertises micropaléontologiques, en cas de vol ou de crime, sont délicates mais souvent révélatrices d’indices précieux », affirme De Wever. Certains microfossiles s’avèrent quant à eux essentiels pour déterminer le plan de creusement d’un tunnel (le tunnel sous la Manche) ou la programmation d’explosion de galeries et de grottes (celles où se cachait Ben Laden).
De Wever satisfait l’attrait du lecteur pour le mystère en incluant quelques « affaires » célèbres. Parmi elles se détache l’aventure du vol et de la dis-
parition/réapparition du « diamant bleu » que Louis XIV avait acheté en Inde en 1665 par l’intermédiaire de Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689). L’enquête (1) qu’a menée François Farge (professeur au Museum national d’Histoire naturelle) se conclut sur une fin lumineuse. Étudiant les archives, Farge découvre que la pierre était sertie d’or et, grâce à un logiciel de création virtuelle qu’utilisent les diamantaires, il voit apparaître sur son écran l’image de ce qu’était le bijou à l’origine : « un soleil royal, rayonnant, majestueux », en somme un portrait royal, un « instrument de pouvoir ». Le diamant s’ajouterait alors aux autres représentations du monarque (galerie des glaces, portrait en peinture, monnaie, typographie…) visant à réaliser la mise en présence constante du roi à travers son Portrait, comme l’avait montré Louis Marin (2).
De Wever mentionne d’autres cas célèbres élucidés grâce aux techniques de la géoscience, comme la spectrométrie de fluorescence des rayons X qui a servi à déceler les faux Vermeer réalisés par Han van Meegeren (1889-1947) dont la duperie « a fait progresser l’expertise des œuvres d’art, devenue multidisciplinaire et scientifique ». La construction des pyramides d’Égypte sera vraisemblablement déchiffrée grâce à la thermographie et à la muographie (qui détecte le flux de muons, lesquels « sont créés par collision entre des rayons cosmiques et des noyaux d’atomes de notre atmosphère », ces muons « traversent notre corps chaque jour » par millions). D’autres outils et leurs apports sont mentionnés, à l’instar du spectomètre de Raman grâce auquel on peut
« étudier les modes vibrationnels d’une molécule » sur des matériaux naturels ou synthétiques (il intervient par exemple dans l’exploration spatiale et dans l’analyse des encres grâce à laquelle on identifie les imprimantes). L’auteur décrit également les applications de la « sismique » qui aura d’heureuses répercussions dans la médecine : l’échographie en dérive directement. Les découvertes géologiques ne sont pas étrangères aux champs juridiques et économiques : établir le lieu d’origine d’un crime, d’une cargaison frauduleuse ou d’une attaque, déterminera quel droit national devra être appliqué et quelles assurances devront intervenir.
L’on devine que la preuve objective ne peut plaire à tous (« Dire la vérité est utile à celui à qui on la dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, parce qu’ils se font haïr », écrivait Pascal) et il arrive, comme le remarque De Wever, que des pressions politiques, idéologiques ou une sorte de narcissisme de caste entravent le recours à la preuve matérielle, aussi irréfutable qu’encombrante. En somme les pierres ne mentent pas, d’où peut-être leur lien profond avec la poésie : « Car contempler la pierre, la toucher, la sentir, l’écouter, c’est toujours faire l’expérience dépossédante d’un double creusement : la plénitude substantielle du minéral s’ouvre sur une déhiscence, un nœud de souterrains ou un ensemble de sillons, qui répondent parfaitement à la propre béance du sujet et aux corridors géologiques de son corps » (3).
Chakè MATOSSIAN ■
_______
(1) https://www.mnhn.fr/fr/le-spectre-du-diamant-bleu-de-louis-xiv
(2) On rappellera à ce sujet l’analyse essentielle de Louis Marin, Le Portrait du roi, éd. de Minuit, 1981.
(3) Anne Gourio, Chants de pierres, UGA Éditions, 2005,
© 2025 Tous droits réservés