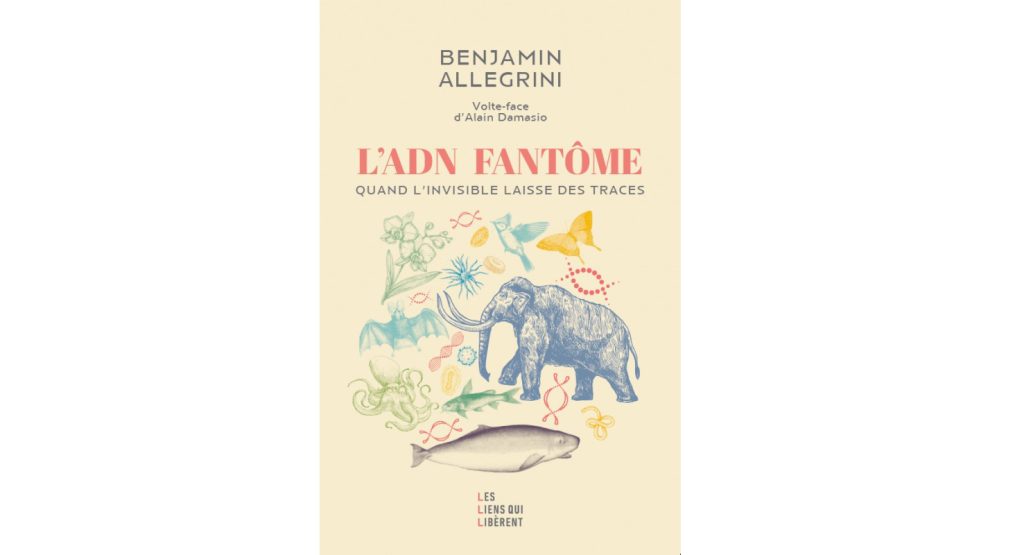
Les Liens qui Libèrent, 2025,
285 p., 22,00€
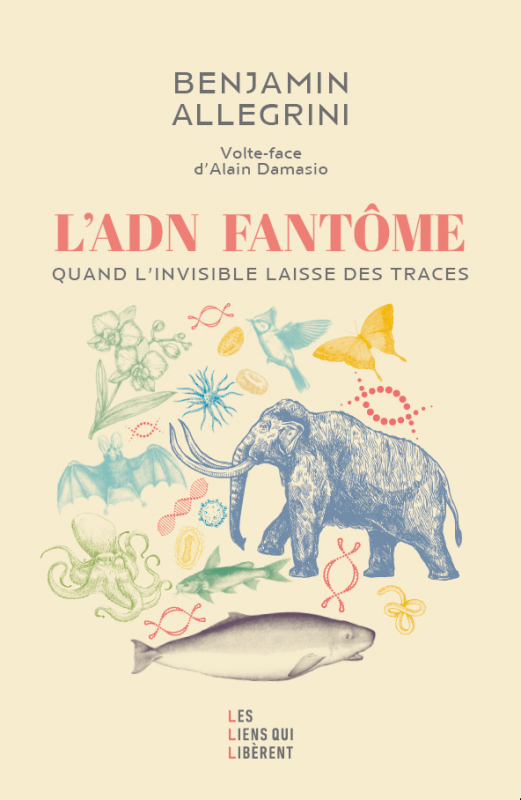
Encouragé par son grand-père alors qu’il était enfant, Benjamin Allegrini s’était pris de passion pour l’ornithologie. Adulte, il préfèrera les chiroptères aux oiseaux, mais c’est bien sûr le vivant dans sa globalité qui l’attire et l’intéresse. Au reste, de nombreuses descriptions d’oiseaux apparaissent dans le livre lorsque l’auteur plante le décor de ses promenades seul ou en compagnie d’amis comme Vinciane Despret (philosophe du vivant, pour le moins médiatique) et Alain Damasio (auteur de science-fiction, dont un texte est inclus dans ce volume). On notera à propos des chants, autres cris animaux et bruits dans la nature, que depuis plusieurs années des « paysages acoustiques » s’intègrent aux données des sciences naturelles (elles font partie des études urbanistiques depuis de nombreuses décennies, notamment avec la parution, en 1977, du livre The Soundscape du musicien et environnementaliste Raymond Murray Schafer).
Revendiquant la double casquette de naturaliste et d’entrepreneur, Allegrini montre le bouleversement bénéfique engendré par le recours aux analyses ADN et aux outils technologiques en général, dans l’observation de la nature. Récusant les attitudes binaires, il valorise tout autant le contact direct et sensible avec la nature.
Tout corps laisse des traces qui signalent une présence invisible (1) et qu’il revient au naturaliste d’interpréter à la manière du chasseur. Non seulement l’ADN permet de repérer la présence passée ou actuelle d’un corps, mais en tant que « langage commun » pour tout le vivant, il donne une clef de lecture de la nature, établit « une base commune pour lancer un premier recensement de la diversité végétale, fongique et animale du système-Terre ». C’est également un langage scientifique précis – (Allegrini ne donne pas seulement les noms vulgaires des animaux ou des plantes, il tient à mentionner toujours l’appellation scientifique en latin) – joint à une méthode de description comparable à une grammaire. Ce langage commun renforce l’internationalisation des découvertes et les échanges d’informations auxquels l’auteur souhaite associer les amateurs.
L’analyse ADN de l’eau a provoqué une révolution en permettant, à partir d’un échantillon minime, de détecter la présence d’espèces parfois inconnues (il en reste des millions à répertorier [2]), rares ou menacées, ou de prévoir l’extension d’espèces invasives. Désormais, les « espèces » ne sont plus étudiées en tant qu’entités isolées mais bien dans une interrelation avec les organismes vivants (un peu comme l’intertextualité en littérature). Comme l’écrit Allegrini, l’on privilégie aujourd’hui « une vision plus écosystémique, celle des écosystèmes et de leurs interactions ». Un bel exemple d’interaction apparaît dans l’étude consacrée à la pollinisation menée par des chercheurs danois, faisant découvrir, grâce aux ADN, non seulement la relation plante-insecte mais une relation inattendue entre insectes : « Ces interactions entre plantes et insectes sont souvent peu connues, ces derniers constituant un petit peuple invisible révélé par les molécules qu’ils laissent derrière eux, hors de notre champ de vision […] En examinant plus en détail la liste des espèces associées à chaque plante, les chercheurs ont découvert une concordance intéressante : la présence simultanée d’un Hyménoptère parasitoïde Praon volucre et de son hôte, le Puceron farineux Hyalopterus pruni. »
L’auteur rattache son livre à ce qui préoccupe sa génération : « l’effondrement actuel de la biodiversité » ou ce que certains ont baptisé « la sixième extinction de masse ». Pour y faire face, il importe de prendre en considération le mode de vie des espèces et leurs variations spatio-temporelles, ce qui nécessite des missions sur le terrain associant présence et technologie. Dans son livre (quelque peu désordonné, aux nombreuses répétitions et sans effort notable quant à l’écriture), Allegrini en cite quelques-unes, comme celle effectuée sur le fleuve Maroni. Elles incluent des analyses en laboratoire dont il détaille la méthodologie et toutes les étapes indispensables à l’étude de l’ADN, de l’arrivée des échantillons au laboratoire jusqu’au séquençage. Un grand nombre d’appareils se trouve mobilisé pour la recherche laquelle s’appuie désormais sur la bio-informatique.
Si le recours à l’ADN permet de surveiller l’état des eaux des mers, l’analyse des sédiments révèle quant à elle des « archives vivantes » et la paléontologie nous offre un accès à la représentation de la vie au cours des millénaires passés : « Par exemple, les Mastodontes consommaient principalement des aiguilles d’épinette et des samares de bouleau, des indices cruciaux sur la végétation et les interactions écosystémiques». Les outils technologiques rendent de moins en moins nécessaire la présence de l’humain « tout comme le contact physique avec ceux que nous étudions », ils permettent d’inventorier les espèces, d’analyser, de surveiller les écosystèmes, d’augmenter le nombre de données qui gagnent en précision et qualité. Les applications sur smartphone, le GPS, l’imagerie satellitaire, le piège photographique, la biophonie, le drone collecteur d’ADN, la robotique, génèrent des découvertes cruciales quant aux changements de comportements ou d’environnement dont l’examen est facilité par le « deep learning » (un sous-domaine de l’IA).
Allegrini retrace, d’un point de vue très occidental, l’histoire des progrès techniques en mettant en avant le grand tournant opéré à la Renaissance avec les découvertes maritimes, l’invention de l’imprimerie, la révolution copernicienne (qui a affaiblit l’anthropocentrisme). Si l’exploitation des ressources et le commerce en étaient les moteurs, la volonté de connaître les formes nouvelles de la vie en faisait également partie. Ainsi, le premier véritable voyageur naturaliste reste, selon l’auteur, Pierre Belon (1517-1564), suivi par les Francis Drake, Georg Wilhelm Steller, Jussieu, Linné, Darwin, Wallace (le « père » de la biogéographie)… Surgit une femme dans l’histoire, Jeanne Barret (qui embarque sous le nom de Jean), la première à faire le tour du monde pendant l’expédition (1766-69) de Louis-Antoine de Bougainville. De tous les naturalistes voyageurs, Darwin occupe naturellement une place centrale en ouvrant la voie à la génétique.
S’il prône l’usage des technologies, Allegrini refuse néanmoins d’en occulter les inconvénients. Les big data restent un outil pour anticiper l’évolution des forêts ou l’extinction des espèces mais ce désir du contrôle sur la nature se fait au détriment de la compréhension des dynamiques écologiques spécifiques et contextuelles. A trop se focaliser sur la quantification, l’on oublie le rôle de l’imprévisible dans la recherche et surtout le contact magnifique que l’homme peut avoir avec la nature. Allegrini, avec une vision parfois très idyllique des relations entre humains, une croyance dans le pouvoir du « local » contre le global, et des injonctions moralisantes sur « nos » modes de consommation – (oubliant qu’une bonne partie de la planète meurt de faim, n’a pas d’eau et que même en France il a fallu instaurer un programme d’aide « petit-déjeuner gratuit » pour les enfants qui partent à l’école le ventre vide) – entend réaffirmer l’importance de la sensibilité et du contact direct avec la nature. Il propose de repolitiser la question du vivant trop souvent réduite « à un simple problème de gestion », alors qu’il importe selon lui de prendre en considération les « rapports de force économiques et sociaux qui sous-tendent la crise écologique ». Fort de son anti-capitalisme, Allegrini se garde de critiquer l’impact de certains monuments écologiques comme les éoliennes. Ses chauves-souris apprécieront.
Il en va des espèces comme des civilisations, elles disparaissent, laissent des traces, se font oublier. Être répertorié, classé, ce n’est pas vivre, assurément. Alors, Allegrini ne veut pas se contenter « des statistiques, des taux de présence ou des indices d’abondance », mais enthousiasmer son lecteur, éveiller le désir de connaître « ce moment de présence partagée où chaque mouvement d’aile ou de feuille parle de la vie ».
Chakè MATOSSIAN ■
_____
(1) L’interprétation des traces invisibles s’exerce également dans le domaine judiciaire, cf. le livre de Patrick De Wever, La géologie au service de l’enquête, dont nous avons fait la recension dans NH 469 du 17 juillet 2025.
(2) L’auteur nous informe que le Museum National d’Histoire Naturelle de Paris abrite plus de 65 millions de spécimens…
© 2025 Tous droits réservés