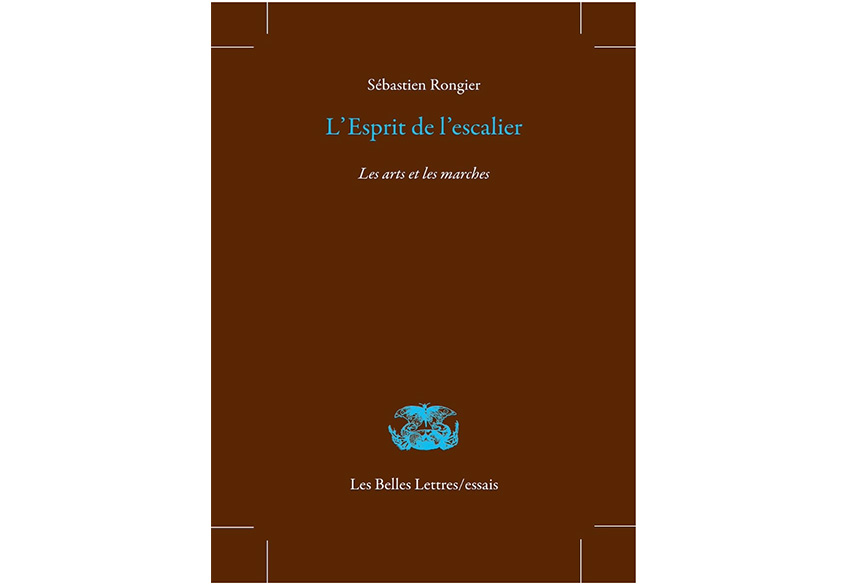
Sébastien Rongier
Paris, Les Belles Lettres / essais, 2025,
166 p., 23,00€
Alors que l’échelle a bénéficié d’une « fortune iconologique, mystique et artistique », l’escalier n’a pas vraiment attiré les chercheurs. Aussi Sébastien Rongier a-t-il choisi de montrer « la puissance de l’escalier » dans les arts plastiques, la littérature et au cinéma qu’il privilégie nettement ici. L’escalier est le lieu du déséquilibre, de la chute, des rencontres amoureuses ou mortelles, des instants érotiques ou des expériences mystiques. Il fait partie de ce que Georges Perec nommait « Espèces d’espaces » – que Rongier prend pour clef de lecture de La Vie mode d’emploi (1978) – et que Sam Szafran (1934-2019) traduira en peinture dans une série d’escaliers.
Cet élément de l’architecture se fait lieu plastique, propice à la transition, il offre un point de vue, nous oblige à l’équilibre, rythme notre mouvement. D’où sa présence au cinéma, plus peut-être que dans tout art, comme le montrent les nombreux films décrits ou analysés par l’auteur. Rongier n’en néglige pas pour autant les autres pratiques artistiques et repère des escaliers représentés en peinture, porteurs d’une valeur religieuse, celle de la chute et celle de l’élévation, comme chez Breughel (Tour de Babel : l’escalier mis en parallèle avec la perte de la langue adamique), le Titien ou le Tintoret (Présentation de Marie au Temple) et Fra Angelico (Annonciation). Certains escaliers ressortissent à la sculpture, à l’instar de celui dessiné par Oscar Niemeyer pour le palais Itamaraty (1970) au Brésil, ou celui jouant sur la transparence de Guillaume Saalburg.
L’escalier accompagne la montée des corps et des regards, il incarne un cheminement spirituel ou une élévation, comme chez Dante, il symbolise par ailleurs les degrés de l’initiation, dans la franc-maçonnerie, par exemple. Dans La Divine Comédie, consacrée à l’ascension céleste, Dante représente trois lieux que sont l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Les sublimes illustrations de Botticelli révéleront le purgatoire comme « le véritable lieu des escaliers » : Dante gravit trois marches pour entrer dans l’espace menant à la lumière, « l’escalier n’est pas un spectacle du déplacement mais une mesure de l’esprit de pénitence qui règne au purgatoire ». Il n’y a pas d’escalier dans l’Enfer, seulement des éboulis, nous dit Rongier, et il ne faut plus d’escalier dans l’espace du paradis lieu de l’échelle céleste ou de l’envol.
Dans un tableau qui jouira d’une fortune immense, Rembrandt peint un escalier en colimaçon. Il s’agit du Philosophe en méditation (1632) dont écrivains, poètes et philosophes s’inspireront. Le mouvement en spirale de l’escalier devient ici « infini dans ce cadre (de pensée) pictural », soutient Rongier, notant que Victor Hugo en ravivera le souvenir dans Notre-Dame de Paris (1). A la suite de Lotte Eisner (L’écran démoniaque, 1952), l’auteur étudie l’influence de Rembrandt sur le cinéma expressionniste allemand dont le metteur en scène Leopold Jessner (1878-1945) demeure un exemple notable. Il réalisa, avec Paul Leni, le film Escaliers de service (Hinterstreppe, 1921). Quant à Fritz Lang, ses « escaliers annoncent des dérèglements ou disent la folie qui ronge le monde », affirme Rongier, ajoutant que l’escalier en colimaçon restera un signe de « folie et du chaos » dans plusieurs films des décennies suivantes.
Au contraire de la montée, toujours admirée et valorisée, la descente, sauf peut-être dans le cas du music-hall, reste négativement connotée. L’œuvre de Duchamp, Nu descendant l’escalier (1912), inspirée par la chronophotographie de Muybridge et Marey, avait provoqué un scandale lors de l’exposition américaine de l’Armory Show (1913). La descente annonce des lieux maléfiques, hostiles ou dangereux, sinon même l’Enfer, comme l’évoquent les catabases de l’Antiquité avec Ulysse, Orphée, Énée qui seront réinterprétées au cinéma. Sébastien Rongier n’oublie pas l’enfer politique et rappelle le rôle central de l’escalier d’Odessa dans le film d’Eisenstein, Le Cuirassé Potemkine (1925) qui sera ensuite cité par de nombreux cinéastes. Eisenstein a su inscrire « la violence dans la composition formelle », à travers la mise en scène et surtout le montage, il opère une « défiguration de la stabilité » de l’escalier d’Odessa, et intensifie la célèbre descente infernale du landau. En 2010, comme le note Rongier, Bansky, maître du street-art, rendra hommage à Eisenstein en peignant un landau noir et son bébé sur un mur de Chicago.
La chute dans l’escalier fait de celui-ci le lieu privilégié des scènes de poursuites, de bagarres et de tous les films de cape et d’épée. Mais il y a aussi les chutes comiques traitées par Charlot et Buster Keaton qui « connaissent la valeur d’un bon escalier pour tomber, remonter et tomber encore » et qui ont su capter les ressorts de la modernité en imaginant « très tôt un usage comique de l’escalier mécanique ».
L’un des chapitres du livre répertorie de nombreux films montrant la relation entre les escaliers et la mort tragique ou comique. Dans ces mises en scène, l’escalier devient un « enjeu déterminant pour penser les formes artistiques », « un modèle plastique permettant d’inventer des lignes, des axes de plan et des effets de montage », principalement chez Hitchcock qui est « incontestablement le maître des escaliers » et auquel l’auteur consacre de nombreuses pages. Pour tenter de trouver « la pierre de rosette des escaliers hitchcockiens », Rongier liste tous les films et décrit les scènes où cet élément du décor apparaît. Il montre que des premiers films de la période anglaise au dernier film testamentaire, Complot de famille (Family Plot, 1976) s’achevant par le clin d’œil que Barbara Harris, assise sur une marche, adresse à la caméra, l’escalier « est un espace de l’imaginaire et un lieu pour mettre en scène le monde ». Du début à la fin, Hitchcock aura créé un « cinéma d’escalier ».
Les escaliers se font aussi lieu de rencontre, d’un croisement soudain du regard qui va du coup de foudre à la pétrification. Le célèbre escalier du château de Chambord (« la Joconde des escaliers ») est conçu pour éviter la rencontre. Léonard de Vinci l’a pensé selon une « logique hélicoïdale doublée » permettant à « celui qui monte de ne pas croiser celui qui descend ». Le château de Chambord élabore, par l’esthétique de son escalier, un discours politique duquel s’écarte le château de Meaulnes (XVIe s.) entièrement tourné vers le secret : on ne peut « rien voir du puits autour duquel s’organise un escalier à vis ». Les châteaux exposent le rôle dévolu à l’escalier dans la représentation du pouvoir. De fait, c’est un « outil politique », écrit Rongier qui cite en exemple l’« escalier des Ambassadeurs » que Louis XIV a fait construire à Versailles. L’auteur observe également les rapports de force exprimés par le point de vue de l’escalier dans des films comme Jules César de Mankiewicz (1953) et La Reine Christine (1933) de Rouben Mamoulian. Aux côtés du pouvoir politique apparaît le pouvoir de l’argent que le bourgeois du XIXe portraituré par Balzac aime étaler, notamment par l’exhibition d’un décor dans lequel l’escalier devient « signe » de cette ascension sociale.
L’auteur offre encore une fine analyse d’une œuvre de Godard, Le Mépris (1963), en décrivant la villa de Malaparte qui sert de décor à ce film « métafilmique » où se donne à voir une mise en abîme du cinéma et dans lequel les escaliers « disent superbement » – en réinventant Chambord – la rupture du couple, l’impossibilité de la rencontre.
Il existe enfin des escaliers impraticables, invraisemblables et cauchemardesques, tels que ceux d’un Escher ou d’un Piranèse dont les Prisons imaginaires (1745) ont pu inspirer le Voyage au pays de la quatrième dimension (1912) de Gaston Pawlowski et, auparavant un grand nombre de poètes romantiques, ainsi que l’avait démontré Luzius Keller en 1966 (2). Au fait, n’est-ce pas à l’escalier même que s’identifie Victor Hugo écrivant ces vers : « Moi qu’on nomme le poète, je suis dans la nuit muette l’escalier mystérieux… » ?
Chakè MATOSSIAN ■
______
(1) Jules Michelet s’identifiera au Philosophe de Rembrandt en y associant son lieu d’enfance (la cave de l’imprimerie), ainsi que nous l’avions montré. C’est aussi ce qu’aura saisi Y. Chahine en recréant l’atmosphère du tableau dans son film Le Destin, montrant Averroès dans la cave avec un escalier. Cf. notre Fils d’Arachné – Les tableaux de Michelet, La Part de l’Œil, Bruxelles, 1998. Rappelons que Marc Richir voyait dans ce tableau de Rembrandt le cadre-même de la philosophie. Cf. « Phénoménalisation, distorsion, logologie », Textures, n°4-5, Braine l’Alleud, 1972, p. 64.
(2) Luzius Keller, « Piranèse et les poètes romantiques ». In: Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 1966, n°18. pp. 179-188. Cette belle étude nous mène jusqu’à Mallarmé avec Igitur. www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1966_num_18_1_2316