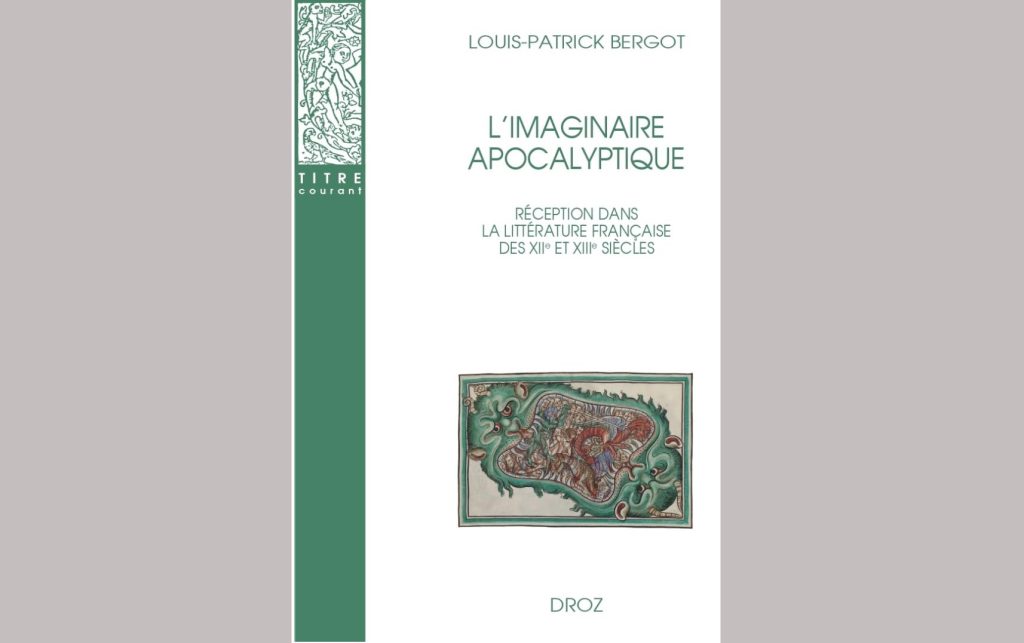
(Réception dans la littérature française
des XIIe et XIIIe siècles)
Genève, Droz, 2025,
690 p., 24,00€
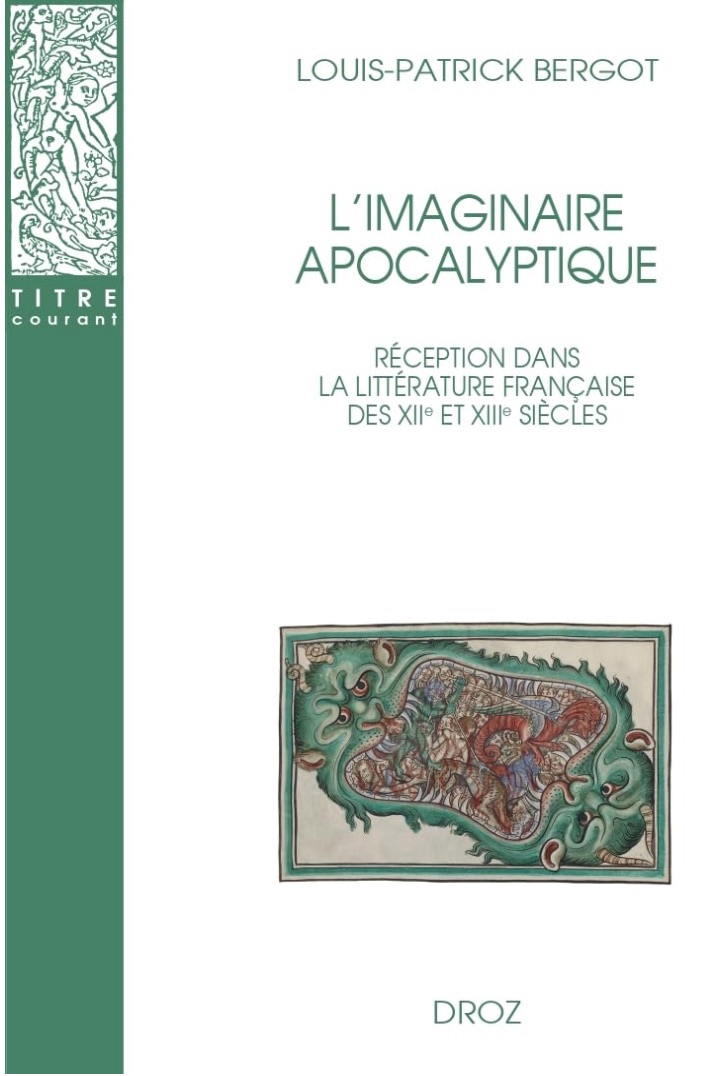
L’Apocalypse – qui a le sens de « dévoilement voilé » – est une structure transhistorique que Louis-Patrick Bergot étudie dans la littérature médiévale française de 1100 à 1327 pour montrer qu’elle a permis « aux médiévaux d’avoir une emprise symbolique sur leur histoire et son devenir ». Les textes appartenant au genre apocalyptique ont ceci en commun : ils relatent la révélation qu’un être humain a reçue « d’une réalité transcendante de nature temporelle ou spatiale » et, précise Bergot, « cette révélation concerne le sort des âmes dans l’au-delà, du temps présent jusqu’au Jugement dernier ». Ils ont aussi une fonction sociale : « Au Moyen Âge, une apocalypse est souvent le fruit d’une préoccupation collective ».
L’Apocalypse de Jean (canonique, elle aborde le Jugement dernier) et l’Apocalypse de Paul (apocryphe et centrée sur le Jugement individuel) qui étaient traduites en français forment l’essentiel de son corpus dont il mène l’analyse en recourant à la littérature religieuse et didactique, à la littérature visionnaire et hagiographique, à la littérature allégorique, à la littérature arthurienne de même qu’à la littérature prophétique, notamment la Sibylla Tiburtina. Celle-ci prophétise l’avènement de l’Antéchrist durant le règne du Dernier Empereur, la libération des 22 royaumes de Gog et Magog, et son discours inclut un acrostiche sur les signes qui précéderont le Jugement dernier.
Rappelant l’importance des textes proto-apocalyptiques dans l’Ancien Testament (Livres d’Amos, de Daniel, d’Ézéchiel, de Zacharie), Bergot retrace le contexte historique et culturel des XIIe et XIIIe siècles afin de tenter de comprendre quels peuvent être les facteurs ayant contribué à « l’enthousiasme apocalyptique ». Le succès de l’Apocalypse est dû avant tout à la qualité des enluminures (1), mais l’auteur préfère chercher et mettre au jour les filiations textuelles, bien différentes des filiations iconographiques.
Pour cerner la réception textuelle de l’Apocalypse de Jean (l’un des textes les plus traduits au Moyen Âge) et celle de Paul, Bergot répertorie toutes les versions tant de la première que de la seconde. Il examine les traductions en prose, en vers, la version glosée, les commentaires, les lacunes, l’origine des textes sources de la traduction mais, ces bases objectives ne suffisent pas à « appréhender l’imaginaire apocalyptique, car celui-ci s’étend au-delà des limites de la translatio. Réfléchir sur l’imaginaire apocalyptique suppose aussi de s’interroger sur les textes qui entrent en relation avec la littérature apocalyptique, à une échelle non plus textuelle, mais intertextuelle ». Aussi l’auteur s’attache-t-il à définir l’intertextualité : il prend pour « boussole »
la terminologie que Gérard Genette énonçait dans Palimpsestes (1982), mais l’adapte à sa manière pour définir « les frontières transtextuelles de l’imaginaire apocalyptique ». Il annonce privilégier « l’hypertextualité », c’est-à-dire la transformation d’un texte A pour s’intégrer à un texte B et l’« architextualité » qui détermine le « statut générique » d’un texte.
Bergot consacre un chapitre à exhumer les « vestiges de l’Apocalypse canonique » qui existent dans de nombreux textes de la littérature française des XIIe et XIIIe siècles, à travers les allusions, la paraphrase, les citations, résumés, réécriture. Parfois l’intertextualité est implicite, car elle dépend beaucoup de la mémoire individuelle et collective. Parmi les images apocalyptiques qui ont marqué l’imaginaire, l’auteur en détache deux qu’il analyse, celle de la Femme vêtue du soleil et celle des douze pierres précieuses à l’origine d’une véritable « litholâtrie ».
L’immensité du corpus consacré à la figure de l’Antéchrist (épreuve indispensable avant le Jugement divin) entraîne Bergot à restreindre l’analyse en se concentrant sur « l’influence qu’a pu avoir l’Apocalypse de Jean sur les représentations médiévales de l’Antéchrist ». Il relève avant tout la
« popularité colossale » d’une sorte de « biographie » de l’Antéchrist composée par le moine bénédictin Adson de Montier-en-der vers 954. Une comparaison pourra être établie entre cette « biographie » et le passage d’une encyclopédie célèbre (qui sera mise en vers au XIIIe siècle), l’Elucidarium d’Honorius Augustodunensis (1080-1157) reproduisant le canevas de la biographie de l’Antéchrist.
La légende des quinze signes du Jugement dernier semble quant à elle « issue d’une nébuleuse de textes bibliques, apocryphes et populaires » que Bergot examine pour mettre en évidence, à l’aide de tableaux comparatifs, les occurrences des signes dans les différents textes. L’Apocalypse de Paul, qui fait partie de toute une littérature « visionnaire » rendant compte de la réalité de l’au-delà, a été la source d’une description des peines de l’Enfer et des délices du paradis. Bergot rappelle ces vers de Dante au deuxième chant de l’Inferno : « Io non Paulo sono ». Cette Apocalypse complète celle de Jean en répondant aux préoccupations individuelles quant au sort de l’âme. Les schèmes de la littérature apocalyptique pénètrent la littérature arthurienne, signale l’auteur, notamment dans le prologue de l’Estoire del saint Graal qui en inclut les signes tels que trompettes, visions, éclipses, etc.
Bergot insiste à diverses reprises sur la prépondérance de la mémoire : « Au Moyen Âge, l’intertextualité est mentale », indissociable donc de la mémoire qui est aussi celle du lecteur. Cet « univers mental » est produit par un réseau d’images qu’il se propose de cerner. La transmission de la révélation nécessite un « relais subjectif » ou « principe de médiation », qui donne seul accès à la vérité apocalyptique. Se pose alors la question de savoir qui voit et comment il voit, question liée à celle du rapport corps /âme, dès lors que seul le spirituel permet d’accéder à la vérité apocalyptique. La représentation implique une spatialisation (plutôt un « lieu », dans le vocabulaire d’ Aristote), d’où l’intérêt de l’auteur pour les « topographies apocalyptiques ». Si l’Apocalypse de Jean différencie l’espace terrestre du céleste, celle de Paul se rapporte à « la spatialisation de l’au-delà infernal » et se construit à travers la juxtaposition de différents lieux, décrits de façon concrète et pittoresque, privilégiant la dimension symbolique plus que la cohérence topographique. Les textes médiévaux réfléchissent à la question des frontières et de la profondeur de l’enfer. Ils décrivent les objets nécessaires aux épreuves atroces, comme la roue et plantent dans le décor des constructions comme le « pont » dont la présence est « incontournable ». La vision de Jean a certes lieu sur l’île de Patmos, mais cela ne dit rien de l’espace dans lequel elle intervient. Bergot note que cet espace « est pensé en fonction de Jean », que « le premier indice topographique se rapporte à lui », que cet espace indéfini se décrit par les objets qu’il contient (comme les sept chandeliers d’or) et par ce que Jean voit. Il s’agit d’un espace céleste uniforme (avec la porte du Paradis et la description de la Jérusalem céleste) opposé à l’espace terrestre composé de mer (lieu de la Bête), de terre (Pseudo-prophète) et de ciel (Dragon), les trois espaces de la Création.
L’imaginaire apocalyptique véhicule bon nombre de créatures merveilleuses, comme le « Fils de l’homme », le Tétramorphe, l’Agneau et, du côté diabolique, les criquets appelés « locustes », le trio formé par le Dragon, la Bête et le Pseudo-prophète. Enfin surgissent l’avatar le plus connu du diable, l’Antéchrist et toutes sortes de monstres diaboliques multipliant les horreurs en nombre parfois inouï. Inouïes aussi ces vérités extraordinaires qui ressortissent à l’indicible, alors que le langage reste la seule voie offerte aux auteurs pour tenter de les restituer. C’est ce qui explique leur attirance pour une figure de style particulière, l’adynaton, une hyperbole dont l’exagération est si poussée qu’elle touche à l’impossible. Figure complémentaire de l’indicible, l’adynaton réduit l’« écart entre le monde terrestre et les vérités surnaturelles ». Bergot cite en exemple un passage du chant VI de l’Énéide qui aura également marqué l’histoire de la représentation du monde infernal.
Dans son étude érudite dont l’enthousiasme et la vigueur ne peuvent qu’attirer le non spécialiste, Bergot démontre la faiblesse des cloisonnements culturels pour approcher les textes d’un Moyen Âge où domine l’imaginaire, seul capable d’éveiller ce qu’un Pascal appelait l’œil de derrière la tête. Enfin, lorsque Bergot nous dit que l’au-delà infernal était parfois conçu « comme le miroir inversé de l’ici-bas terrestre », l’on saisit l’actualité du sujet traité.
Chakè MATOSSIAN ■
_____
(1) En ce qui concerne les miniatures arméniennes illustrant le Jugement dernier, voir Levon Chookaszian, “The Last Judgment in certain Armenian Miniatures of the 13th & 14th centuries”, In: Art of the Byzantine World, Individuality in Artistic creativity, A Collection of Essays in Honour of Olga Popova, Moscow, 2021, p.590-609. En ligne sur https://www.academia.edu.
© 2025 Tous droits réservés