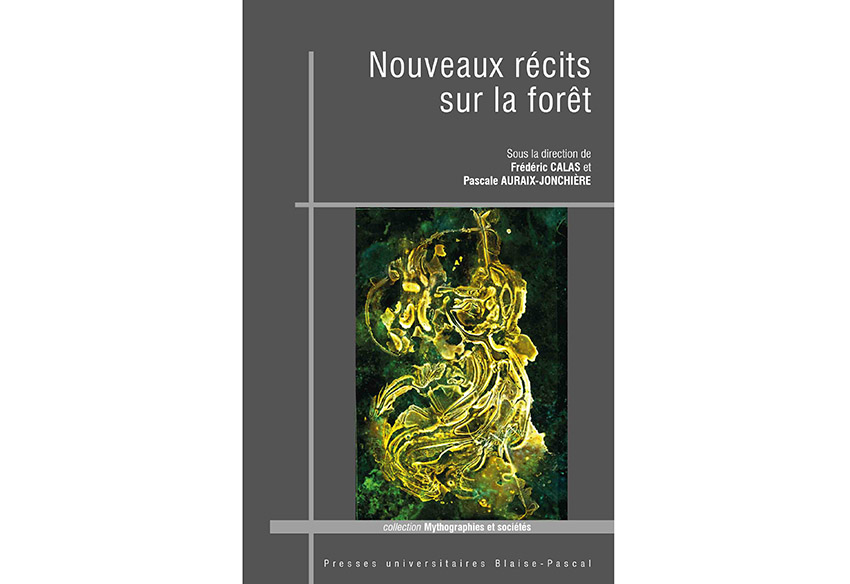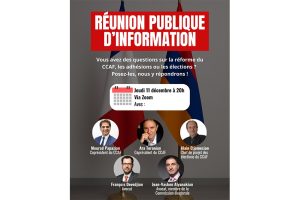Sous la direction de Frédéric Calas
et Pascale Auraix-Jonchière
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2023,
3896 p., 23,00€
Au fil des siècles, la forêt a représenté un lieu initiatique, un endroit mystérieux abritant des créatures fantastiques ou des brigands et des marginaux. De nos jours, et à la suite des découvertes scientifiques comme « la communication racinaire des arbres », les engagements politiques contre la déforestation ou la prise de conscience de l’écosystème, la représentation de la forêt s’est considérablement modifiée, donnant lieu à une « néologie » (un nouveau vocabulaire). Les auteurs de ce volume collectif dirigé par Frédéric Calas et Pascale Auraix-Jonchière se proposent d’analyser les répercussions de ces changements de représentations et l’impact qu’a le discours scientifique sur la fiction prise au sens large (littérature, cinéma, livres jeunesse, philosophie). D’où le titre, « Nouveaux récits sur la forêt » (‘nouveaux’ au sens de « inédits », « d’un genre nouveau » et « récents ») traversés par un imaginaire que les auteurs des quatorze essais réunis ici espèrent porteur d’une nouvelle relation avec la forêt.
Catherine Tauveron remarque dans trois contes pour enfants, l’abandon de l’image angoissante de la forêt léguée par les frères Grimm, un « désensauvagement de la forêt » au profit d’une découverte de la vie qui s’y cache. Dans L’enfant racine de Kitty Crowther, « conte œcuménique dans ses sources sylvestres et singulier dans son résultat », la forêt reste sombre et mystérieuse mais l’auteur lui confère un rôle matriciel et y fait revivre les fées celtiques. Elle veut y voir une résurgence du lien que les Grecs de l’Antiquité nouaient entre le végétal et la « race » des hommes et qu’elle retrouve dans le livre de Sara Donati Parler avec les arbres. Probablement influencée par le best-seller de Peter Wohleben, La vie secrète des arbres Donati est aussi à l’écoute des poètes qui ont su « entendre la voix des arbres » (Hugo, Lamartine, Chateaubriand…).
Les « formes que prennent les forêts enchantées dans la littérature pour la jeunesse contemporaine » intéressent Esther Laso y León. Elle part de trois romans qui actualisent la forêt enchantée en « introduisant une réflexion sur la société contemporaine » : Messager de Lois Lowry, Winter-
wood de Shea Ernshaw et Nature extrême de Yves-Marie Clément. Laso y León relève les ressemblances entre les forêts de ces romans et celle de la Belle au bois dormant (Grimm et Perrault) : poussée rapide de la végétation, défense et agressivité de la forêt, mobilité anormale, laideur (ronces)/ beauté (fleurs). Les récits contemporains se distinguent des précédents par l’introduction de théories scientifiques relatives à la communication des arbres à travers un langage chimique, ils personnifient la forêt ou l’animalisent, en font un organisme, s’imprègnent de nostalgie et messages écologistes.
La forêt en tant qu’immensité sombre et angoissante dans laquelle furent abandonnés le Petit Poucet et sa fratrie, ce « stéréotype » ancré dans l’imaginaire à travers des illustrations célèbres comme celles de Gustave Doré, tend désormais à céder la place à « une veine réparatrice et jubilatoire qui exorcise les maléfices de la forêt d’antan et incite à la considérer autrement », écrit Christiane Connan-Pintado. Avant d’aborder l’examen de cinq versions contemporaines du conte de Perrault avec leurs illustrations, elle rappelle que Michel Tournier avait amorcé ce mouvement avec « La fugue du Petit Poucet », écrit au cours des années hippies, le Flower Power. Par la mise en couleur de la forêt, les auteurs contemporains veulent effacer l’obscurité cauchemardesque, « offrir à l’enfance et à la jeunesse, à leur échelle, un message volontariste animé par le care et porteur d’espoir ». Dans notre époque où augmentent les « familles recomposées » peut-être l’objet de l’angoisse (la forêt) se déplacera-t-il alors sur la « marâtre » (rappelons que ce n’est pas la mère mais la marâtre du Petit Poucet qui élabore la stratégie), ou sur la ville. C’est ce que montre Catherine Tauveron dans une étude des albums jeunesse qui semblent enfin échapper à l’esprit guimauve moralisant. Ici, l’espace urbain anxiogène devient la forêt dangereuse. Les gangs remplacent les loups, la surcharge de publicité fait office d’arbres, les centres commerciaux séduisent pour empoisonner, le pire arrive dans les quartiers mal famés où se perd La petite fille en rouge, illustré par Roberto Innocenti et cyniquement raconté par Aaron Frisch. Tauveron a choisi des œuvres qui interrogent et perturbent, livres illustrés et pièce de théâtre où l’homme fusionne dangereusement avec l’arbre, sous l’effet d’une communication magique et fatale qui le laisse seul et fou.
 MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
©Alexandra Vassilikian, Chêne multicentenaire Forêt de Blanche Lande,
photo argentique sur papier baryté 50×70 cm, 1998.
Depuis le début du XXe siècle, l’Amazonie subit, comme on le sait, une déforestation croissante. Cette réalité n’empêche pas l’imaginaire de la rattacher au « sublime » (Burke, Kant), ainsi que l’étudie Chloé Chaudet. Elle analyse, sous l’angle de l’éco-critique, deux romans qui figurent « l’incommensurabilité de l’Amazonie », celui de l’auteur portugais José Maria Ferreira de Castro, Forêt vierge (1930) traduit par Blaise Cendrars et celui de l’écrivain « chilien écologiste », Luis Sepúlveda, Le vieux qui lisait des romans d’amour (1989) adapté au cinéma par l’australien Rolf de Heer en 2001. Chez tous deux, la jungle amazonienne se rapproche de la sombre forêt terrifiante, une forme de « locus terribilis » liée au vécu douloureux des auteurs. Chez tous deux se dégage une critique de l’exploitation capitaliste de l’Amazonie et une mise en évidence de son élan vital auto-régénérateur. Ces récits nous montrent en somme que « respecter la forêt au sens fort du verbe implique de l’envisager comme un écosystème auquel on peut participer mais qu’on ne peut dominer ».
Proposant une lecture « écopoétique », Hélène Vial tisse des liens entre les films d’animation du réalisateur japonais Hayao Miyazaki et les Métamorphoses d’Ovide. La forêt y apparaît comme carrefour de la vie et de la mort, de l’humain et du divin, du passé et de l’avenir, comme lieu conservant la mémoire des actions humaines, comme sanctuaire et lieu de vérité où se donne à voir la puissance métamorphique du vivant dont seuls l’enfant et l’artiste perçoivent la beauté.
Le « locus rom » dénomme le lieu de « stationnement traditionnel des roulottes pendant les déplacements des familles roms » dont Sidonia Bauer examine la représentation dans la littérature rom tout en soulignant l’esthétisation à laquelle il a donné lieu dans les « hétéroreprésentations » artistiques des XIXe et XXe siècles. Si le nationalisme allemand, ainsi que le rappelle Bauer, appuyait son idéologie sur une mythologie germanique de la forêt dont il récupérait la symbolique, pour les Roms, la forêt, l’arbre, s’avèrent indissociables de l’expérience génocidaire, comme le montre l’œuvre autobiographique de Ceija Stojka, sauvée par un arbre nourricier.
Depuis le livre de Peter Wolhleben, La vie secrète des arbres, vulgarisant les recherches de Suzanne Simard, le grand public connaît l’existence des réseaux mycorhiziens par lesquels les arbres communiquent de façon sous-terraine. L’influence de ces découvertes sur les représentations de la forêt aujourd’hui et dans diverses disciplines intéressent Yvan Daniel. La philosophie et l’anthropologie proposent, comme l’auteur le montre, un décentrement de l’humain, une exploration de la vie végétale et l’hypothèse selon laquelle « la forêt pense » développée par Eduardo Kohn. C’est du reste Kohn qui servira de point de départ à l’analyse que fait Christine Marcandier du rôle de la forêt en tant qu’ « envers du monde » dans l’œuvre de Marie Darrieussecq. Proposer de s’adapter à la sémiotique du vivant en pensant comme la forêt ne saurait manquer de révéler une nouvelle forme d’animisme que Y. Daniel repère aussi dans la littérature et l’analyse littéraire. Il choisit quelques œuvres (de Richard Powers, Laurent Tillon, Henry David Thoreau, A Cheng, Guido Mina di Sospiro et Didier van Cauwelaert) qui pensent la forêt ou donnent à lire ce qu’elle (ou un arbre) pense.
Spécialiste des analyses du langage, Agata Jackiewicz observe « la matérialité linguistique des discours engagés » : « Les terminologies et les catégories utilisées par les différents groupes sociaux pour nommer et classer les végétations et les formations boisées renseignent sur la nature des rapports de ces groupes à la forêt et à la maîtrise des ressources naturelles qu’elle offre », écrit-elle. Aussi, des auteurs comme le philosophe australien Glenn Albrecht veulent-ils créer « de nouveaux mots pour un nouveau monde » (on peut penser aux propos de Roland Barthes concernant le paradoxe langagier propre à la Révolution : elle veut faire table rase de tout mais doit in fine recourir à la langue du pouvoir qu’elle veut abolir). Cette nécessité d’un langage autre se dégage aussi de l’œuvre post-apocalypse et post-humaniste de Marie Darrieussecq étudiée avec acuité dans ce volume par Christine Marcandier. Jackiewicz observe quant à elle les fréquences haute ou basse de certains termes auxquels recourt le quotidien Reporterre, consacré à l’écologie. L’auteure en dégage des discours qui
« parlent à notre intellect, mais visent tout autant notre sensibilité », cherchant à allier connaissance et beauté, tout en faisant montre, selon nous, d’un ton moralisateur. Philippe Antoine privilégie la Sibérie, le Far-East et se penche sur des récits-plaidoyers découlant d’une enquête sur le terrain pour y montrer les liens « qui se tissent entre conscience environnementale et esthétique littéraire ». De façon originale il examine le récit du touriste (Danièle Sallenave, Dominique Fernandez, leur voyage en Transsibérien), de l’arpenteur et de l’ermite. Les forêts de Cédric Gras, l’arpenteur (géographe)
« sont encore capables de solliciter l’imaginaire ou de susciter la rêverie intertextuelle mais elles sont aussi géographiquement situées et ont une histoire », la fiction n’y a plus cours. L’ermite sera Sylvain Tesson. Son livre Dans les forêts de Sibérie retrace l’expérience de survie (mais aussi esthétique et spirituelle) « dans une isba isolée sur les bords du lac Baïkal » durant six mois (avec cependant du matériel et de la vodka). Chez les auteurs qu’il a choisis, Philippe Antoine retrouve des « lignes de forces » communes qu’il attribue à un bagage intellectuel composé de références
« appartenant à un fonds culturel commun ».
C’est aussi l’expérience et la formation d’ethnologue qui permettent à Anne Sibran de situer son récit, Enfance d’un chaman, dans le présent qui est pour elle la destruction de l’esprit de la forêt amazonienne, qu’elle laisse s’exprimer, de manière nouvelle et dans un retour à une forme primitive d’animisme, ainsi que le commente Alain Romestaing (il se penche également sur Forêt-Furieuse de Sylvain Pattieu). Comme l’écrit également Pascale Auraix-Jonchière, « seule la pensée mythologisante donne accès à l’essence de la forêt et permet de s’y ressourcer ». Auraix-Jonchière, qui co-dirige ce volume, souhaite exploiter quelques romans de la forêt « sous l’angle du care » (c’est-à-dire « une écriture transitionnelle aux vertus possiblement performatives ») en envisageant « la forêt comme possible agent remédiateur au mal-être existentiel et métaphysique des personnages ». Au reste, dans l’épilogue du volume, ce sont bien deux arbres à la fonction consolatrice qu’Auraix-Jonchière repère dans le recueil Arbracadabrants de la poète Béatrice Libert. Les trois œuvres de fiction relèvent de l’« autopathographie » : Le Mur invisible (Die Wand, 1963) de Marlen Haushofer ( = une forêt « philosophale »), Une forêt dans la tête (2021) de Violaine Schwartz (= une forêt guérisseuse, la narratrice a subi une rupture d’anévrisme) et Le Meurtre du Commandeur de Haruki Murakami (= la forêt comme espace de l’éveil). Toutes trois mettent en scène « la puissance efficiente de la forêt » qui devient « le moteur même de la thérapie symbolique ». Dans l’œuvre de Murakami, ce n’est pas seulement le personnage du peintre qui est transformé par sa vie dans les bois mais toute sa peinture, ses matériaux, qui s’imprègne de la vie de la forêt. Le portraitiste trouve alors la couleur juste, elle « s’impose à lui en une sorte d’épiphanie fulgurante », c’est celle des feuilles vertes des arbres voilées par la pluie. Saisissons l’occasion pour évoquer l’étude que Clélia Nau avait menée dans son magnifique livre sur le mode d’existence des feuillages dans le champ des images (peinture, gravure, cinéma, photo). Leur bruissement mystérieux et leur puissance vitale fait exploser la fonction décorative à laquelle on croit les assigner, le feuillage pousse le cri goethéen, « Alles ist Blatt » (1). Pour Auraix-Jonchière, les trois romans (autrichien, français, japonais), loin d’inviter à guérir la forêt font plutôt de la forêt un principe remédiateur essentiel aux souffrances humaines. Les trois fictions « opèrent un décentrement du monde actuel au profit d’un recentrement de l’être sur les valeurs fondamentales se révélant inaltérées », écrit-elle.
Frédéric Calas s’intéresse aux « dystopies apocalyptiques » (2), qui semblent une spécialité nord-américaine avec leur forte composante biblique annonçant la disparition de tout bonheur et de tout plaisir. L’intertexte biblique très présent dans la trilogie autour du dernier homme de l’écrivaine canadienne Margaret Atwood porte cette dernière à insister sur les conséquences de la perte de l’écriture, du livre fait de papier et d’encre, de lettres, qu’il faut réapprendre pour pouvoir raconter. Calas consacre une grande partie de son essai au livre de Thomas M. Disch, Génocides (1965), qui décrit la fin du monde sur fond de crise écologique, l’annihilation du pouvoir des hommes par des extraterrestres. Désormais soumis à la Plante, c’est-à-dire à la forêt, obscure comme dans les contes, devenue illisible et méconnaissable car elle est en fait une plante géante plantée par les extraterrestres (Disch désigne le piège des apparences), les hommes survivants demeurent « prisonniers d’un environnement qu’ils ingurgitent mais qui les tue ». Le livre « est bien une écofiction », car il aborde « la question des relations entre l’homme et le vivant, l’homme et son milieu, mais selon une vision dystopique d’un monde sans avenir, où les rapports de force avec la nature se sont inversés, sous l’intervention extérieure de cultivateurs ». Le récit, comme le note Calas, confère à Disch le rôle de sentinelle, exigeant des humains qu’ils se regardent comme « exploiteurs à outrance de notre planète ».
Ce volume foisonnant de découvertes et réflexions ne se satisfait pas des injonctions moralisantes et infantilisantes (l’expression « Mère-Na-
ture »…) importées des Etats-Unis, il confère également à la littérature son pouvoir de questionnement à travers l’inventivité du langage, l’activation d’un imaginaire que la destruction des forêts contribue à faire disparaître. Ainsi que l’écrit Robert Harrisson cité par Christine Marcandier :
« détruire les forêts ne signifie pas seulement réduire en cendres des siècles de croissance naturelle. C’est aussi un fond de mémoire culturelle qui
s’en va ».
Dans les contes arméniens, tantôt la forêt magnifique protège comme un rempart un lieu dangereusement mystérieux et magique mais beau comme le paradis (Zoulvisia), tantôt un pauvre garçon au bon cœur y ramasse des fagots, nourrit sa vieille mère et sauve des animaux (chat, chien, serpent)
qui l’accompagnent et transforment fabuleusement sa vie (La pierre de la bague) (3). Dans l’Arménie d’aujourd’hui, la déforestation est la réalité (4).
Chakè Matossian
_______
(1) Clélia Nau, Feuillages – L’art et les puissances du végétal, Paris, Hazan, 2021. Prix du cercle Montherlant de l’Académie des Beaux-Arts 2022.
(2) Voir à ce sujet notre compte-rendu du livre de Pierre Déléage, Traité des mondes factices, dans Nor Haratch, 13 avril 2023.
(3) Contes arméniens, trad. Frédéric Macler, Paris, Ernest Leroux, 1905.
https://mythslegendes.com/wp-content/uploads/2020/07/contes_armc3a9niens___traduits_de_…_bpt6k6226758q.pdf
(4) Quelques associations travaillent pour la reforestation en Arménie. Parmi elles :
https://myforestarmenia.org/fr/home/
https://www.armeniatree.org