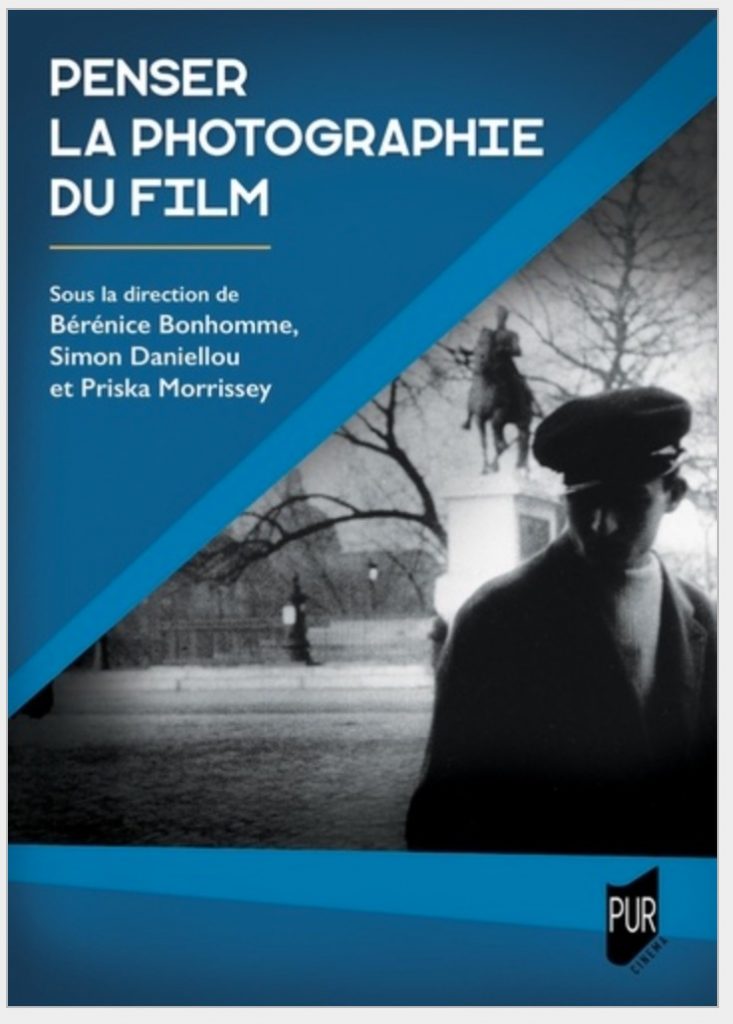
Presses Universitaires de Rennes, 2024,
335 p., 30,00€
La photographie du film n’est pas la première chose à laquelle nous pensons en regardant un film et pourtant elle nous regarde. Les essais réunis dans cet ouvrage montrent combien la fabrication d’un film dépend d’un immense travail collectif. Parmi les métiers participant à cette co-construction se démarque le directeur de la photographie chargé de « diriger » la lumière. L’esthétique, l’atmosphère et donc la dramaturgie du film en dépendront, d’où la possibilité de lui reconnaître un « style ». C’est le cas de Léonce Poncet qui, issu du théâtre, savait combien la lumière fait intrinsèquement partie du décor, comme en témoigne son film de 1912, le Mystère des roches de Kador analysé par François Ede. Un procédé ancien peut aider à résoudre une question technique nouvelle, comme le révèle Thomas Pillard lorsqu’il examine la portée esthétique et dramaturgique du recours aux « plaques Autochromes » (un procédé de superposition du début du XXe siècle) grâce auquel Bruno de Keyzer a pu rendre la « mémoire de l’oubli » dans le film Un dimanche à la campagne (1984) de Bertrand Tavernier.
Le cinéma résulte de l’utilisation de la caméra non plus comme simple outil d’enregistrement mais comme moyen d’expression. Katharina Loew rappelle que dès 1910 le cinéma danois, techniquement innovateur et dominant, a su créer des atmosphères, influençant ainsi le cinéma expressionniste allemand (1910-1926) dont on verra les répercussions sur le cinéma américain avec Fritz Lang et Murnau. « Director of photography » est un terme hollywoodien et Daisuke Miyao se demande ce qu’il signifie au Japon. Il y réfléchit en examinant le travail de Kazuo Miyagawa (1908-1999), « directeur de la photographie » de films cultes comme ceux de Mizoguchi ou de l’inoubliable Rashōmon de Kurosawa. La question, connotée idéologiquement, engage celle de la définition d’une esthétique « japonaise » au cinéma où le nationalisme va s’introduire en séduisant le public étranger grâce à l’exotisme des samouraïs et des geishas. Or, écrit Miyao, contrairement à ce que voudrait l’idéologie, le travail sur les contrastes de Miyagawa ne trouve pas tant sa source dans les souvenirs d’enfance à Kyoto que dans son admiration des réalisateurs allemands de Hollywood. Miyagawa a accompli « une sorte de numéro d’équilibriste entre une photographie mettant l’accent sur le contraste, qui trouve son origine dans son attirance pour la cinématographie allemande, et l’image populaire de l’architecture de Kyoto associée à l’idée d’ombre ».
Emmanuel Lubezki a reçu trois fois de suite l’Oscar de la meilleure photographie ( de 2014 à 2016), ce qui amène Antoine Gaudé à examiner le film The Revenant, pour y montrer que la photographie s’inscrit dans une histoire du goût et du regard. Que recherche-t-on en 2015 ? l’expérience subjective, fictionnelle, l’immersion, la proximité physique et le plaisir énergétique, c’est-à-dire un goût parfaitement alimenté par Lubezki grâce à l’usage de la technologie : « l’avènement de cet hyperréalisme subjectif et sensoriel se place sous le joug du numérique ». Le numérique joue désormais un rôle majeur mentionné par presque tous les auteurs du livre. Certains l’adoptent avec enthousiasme, comme Jeanne Lapoirie (directrice de la photographie) car il lui donne une grande liberté. Plus modéré, Manuel Dacosse, l’utilise sans pour autant éliminer l’argentique car tout dépend des effets recherchés (le vert d’une forêt, les carnations, les brillances dans le contre-jour, …). En fait, résume bien Dacosse, « la photographie du film consiste à apporter une atmosphère et pousser le film plus loin dans sa logique visuelle ».
Pascal Martin propose le néologisme de « flounet » pour exprimer, avec la difficulté du métier de « pointeur », la combinatoire du flou et du net. Il souligne la complexité du transfert de l’autofocus physiologique (notre œil) au système technique (la « bascule de point ») qui influencera la perception du spectateur. Peut-on associer la direction de la photographie (qui requiert la préparation) et le cinéma expérimental comme celui du « film-journal » (avec prise sur le vif) de Jonas Mekas, se demande Emmanuel Siety? Mekas poétise la lumière en tirant parti des hasards et des inconvénients techniques, qui deviennent des « contraintes stylistiques » et font de lui un « expert », lequel se distingue radicalement du « professionnel ». Le professionnalisme renvoie, quant à lui, aux systèmes des studios comme ceux de Hollywood sur lesquels se penche Patrick Keating. Il analyse la relation entre la photographie de film et les instructions qui apparaissent sur le scénario pour planifier au maximum le tournage et consolider le côté industriel du cinéma. Malgré tout, la planification ne peut tout englober, il lui faut laisser une place « pour les décisions prises sur le vif du tournage ». A l’opposé du professionnalisme mais en accord avec l’industrie et le consumérisme, se trouve le cinéma amateur, un cinéma de loisir consistant en films de voyage (tourisme de masse) et de famille (immortaliser et rendre vivante la galerie de portraits) que Roxane Hamery analyse à travers l’histoire de l’utilisation de la couleur dans les manuels de cinéma amateur de 1924 à 1968.
Le cinéma se fait aussi avec le HMC (habillage, maquillage, coiffure) qui doit se coordonner avec la photographie et les décors, car l’image du film, celle des acteurs et l’atmosphère même du film, en dépendent comme l’explique Guillaume Jaehnert à partir du cas de la cheffe maquilleuse-coiffeuse Chantal Leothier. Bien sûr, le numérique intervient également dans ce domaine, notamment avec les « masques virtuels correcteurs ». Quant au chef décorateur, il lui revient de « peindre avec la lumière », selon les mots d’Alexandre Tsékénis définissant le travail de Jean Rabasse.
Le numérique se révèle bien sûr fondamental pour les effets spéciaux que Simon Daniellou et Jean-Baptiste Massuet étudient dans « la photographie de Dean Cundey dans les films à effets spéciaux (1980-1990) » pour en détailler l’esthétique particulière. Les effets spéciaux intègrent des éléments hétérogènes : plastique, graphique informatique, dessin de modélisation, sculpture, animatroniques. Leur utilisation doit répondre à une sorte d’aporie : comment dissimuler les effets que l’on veut par ailleurs mettre en valeur ? Le côté magique des effets n’est pas nouveau, on peut le repérer dans les « films à trucs » qu’étudie ici Frédéric Tabet en rappelant l’origine foraine de ces plaisirs. Dans son passionnant article, Tabet met en évidence qu’une histoire commune relie les illusions scéniques, la photographie et la cinématographie. Faisant appel à Georges Meliès qui utilisait les inventions de son époque, Tabet démontre que les récréations photographiques (le refoulé de l’histoire de la photo) offrent un pont entre les installations théâtrales de la magie optique et celles du médium photographique donnant lieu aux premiers trucages cinématographiques.
Qui est responsable de la photographie sur un film d’animation ? demande Bérénice Bonhomme en examinant le cas Persepolis (Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, 2007) pour constater que « la prise de décision autour de la photographie du film apparaît comme assez dispersée au sein de plusieurs départements », ce qui donne lieu à des ajustements nombreux qui exigent une concertation. Un autre genre de film d’animation est abordé par Elisa Carfantan et Tatian Monassa. Ils décrivent techniquement l’élaboration des films d’animation en images de synthèse de la compagnie Pixar où s’allient science (physique, mathématique) et pratique d’animateurs venus du dessin animé. Les images produites par des algorithmes « sont le résultat d’équations qui déterminent chaque pixel à partir de modèles simplifiés forgés à partir de l’abstraction mathématique », ce qui élimine la dimension esthétique produite par les imperfections des phénomènes physiques réels dont il faut alors recréer les effets dans le monde immatériel. De son côté, Réjane Hamus-Vallée décortique la fabrication du « Roi lion » (Jon Favreau, 2019) qui constitue selon elle un tournant dans l’utilisation des nouvelles technologies imbriquant le virtuel au réel.
Le parcours d’un film s’achève sur un écran face au spectateur qui entre alors dans l’équation de la photographie du film. L’éclairage des salles de cinéma diffère, ainsi que la luminosité du projecteur, ou le style d’écran : nous ne voyons donc jamais le même film. Nous avons en outre des habitudes quant aux températures de couleurs, relève François Ede en rappelant l’histoire des sources d’éclairage utilisées au cinéma.
Comme on le sait l’IA a capturé l’écriture des scénarios dans ses algorithmes et elle permet de tout recréer qu’il s’agisse des décors, des masques, des personnages. Aussi, la fabrication du film se retrouve-t-elle désormais en grande partie dans les mains des informaticiens capables d’inventer les algorithmes nécessaires à la production d’un film rentable. Il reste que la lumière ne se laisse pas dominer mais seulement, peut-être, envelopper. C’est ce qu’on appelle l’atmosphère. Pour y parvenir, le directeur de la photographie doit se plier tantôt à ce qui survient inopinément et le perturbe, tantôt à ce qui s’offre à lui au moment opportun. Et il s’y plie, littéralement : « aucune planification ne peut changer le fait que la photographie de film reste une activité corporelle », observe Patrick Keating.
Chakè MATOSSIAN ■