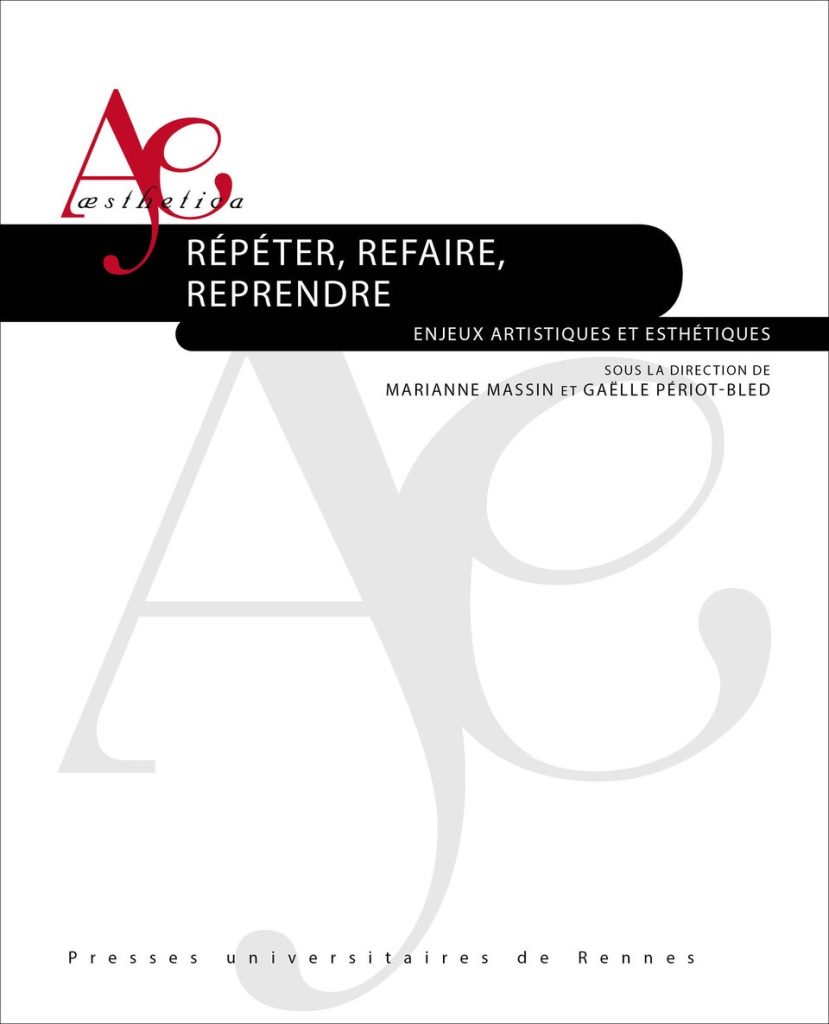
(Enjeux artistiques et esthétiques)
Presses universitaires de Rennes, 2025,
247 p., 25,00€
Sous un titre réunissant trois verbes marqués par le préfixe « re » et impliquant aussitôt la temporalité, les auteurs de cette publication interrogent ce qu’il en est de l’original et de l’originaire, ce qui dans les pratiques itératives telles que la répétition et la « reprise » – (titre d’un livre du philosophe danois Søren Kierkegaard (1), dont la présence circule ici , tout comme celle de Shakespeare, Borges ou Deleuze) – entraîne des changements, des variations et diffuse le « vertige du simulacre ». Reprendre reste indissociable du geste artistique qui procède par une sorte d’errance, avance par la rature, le retrait, les « repentirs » (en peinture), bref toutes sortes de tentatives qui font « palpiter » la peinture, ainsi que le voulait Léonard de Vinci. On se souvient du « raturer outre » d’Yves Bonnefoy (1923-2016) (2) pour qui, selon Patrick Werly, « la reprise n’est pas seulement un acte interprétatif mais le déplacement d’une situation sur un autre plan ». Werly ajoute, dans l’étude consacrée ici au Digamma (3), à la « pensée figurale » de Bonnefoy : « le Digamma s’annonce donc comme un livre sur la perte et sur ce qui manque dans notre langue, dans le fait même du langage et de la parole, pour que l’unité avec le monde soit possible ».
L’humain, depuis le paléolithique, ne fait que répéter, rappelle d’emblée Bernard Sève qui dresse une liste non exhaustive des pratiques artistiques liées à la répétition ou à la reprise. Il les nomme « usage second » – (traduction, pastiche, centon, pot-pourri, réemploi d’une œuvre ou d’une partie de l’œuvre, décontextualisation) – puisqu’elles existent en relation avec une œuvre qui les précède et qui peut être celle de l’artiste lui-même. Proust et J.-S. Bach en témoignent. Bach justement, dont Quentin Gailhac analyse la « deuxième vie esthétique de la Passion selon saint Matthieu » en montrant qu’au fil de l’histoire l’ancrage religieux a cédé la place à l’esthétique, laquelle détient le pouvoir de déclencher en retour chez l’auditeur post-chrétien une ouverture au religieux.
La modification d’un environnement influence la création des installations car « l’expérience de l’espace est constitutive de l’installation comme œuvre »,
rappelle Maki Cappe dans son article « Réinstaller ou refaire une installation ? ». Boltanski concevait quant à lui l’installation à la manière d’une partition. Ainsi l’œuvre deviendrait-elle un répertoire qu’il s’agit de rejouer et qui, à l’instar de ce qui se passe en musique, demande à être « réincarné » (on se souvient que la répétition kierkegaardienne procède de la « résonance », comme l’avait montré N. Viallaneix). Aussi arrive-t-il à certains auteurs de confier l’acte de réincarnation au lecteur, comme le remarque Justine Prince dans son analyse du roman d’Italo Calvino, Si une nuit d’hiver un voyageur. Reprise et répétition s’y enchevêtrent : « dans ce roman dont le véritable héros est le lecteur, les reprises et les répétitions acquièrent une valeur réflexive et permettent de mettre en avant la part active de la réception du texte dans sa lecture ». Et Prince souligne combien la façon dont Calvino recourt à la répétition ôte à celle-ci toute dimension rassurante : « Contre le plaisir de la reconnaissance, contre la permanence rassurante de la répétition, Calvino joue sur la déstabilisation de l’intrigue romanesque ».
Penser la répétition hors de la sphère soporifique du ressassement, la comprendre comme un aiguillon ou un dard (socratique-kierkegaardien) entraîne Marianne Massin à imaginer « les voies par lesquelles refaire ou reprendre ne relèveraient pas de la plate répétition ou de la redondance ». Elle montre l’attente de la répétition hors de son contexte dans le film de Chaplin, les Temps modernes ou le bouleversement du sens des phrases dans la répétition qui en supprime des parties (à l’exemple de la nymphe Echo qui, en répétant la fin des phrases de Narcisse, exprime son propre désir). Massin fait aussi appel à l’épanorthose (le locuteur rectifie lui-même ce qu’il vient de dire pour renforcer son propos) et à l’anacyclique (changement de sens d’un mot ou d’un groupe de mot par la lecture inversée), outils qui sous-tendent son analyse de la vidéo « Cloudscape » (2004) de Lorna Simpson. Massin y décèle un gain de sens par soustraction et la remise en question de l’irréversibilité temporelle. C’est également sous l’angle d’une temporalité particulière que Céline Flécheux s’intéresse à la singularité du préfixe « re » dans « revenir » (4) (« re » n’indique pas ici de répétition) comme le manifestent le retour d’Ulysse et celui du fils prodigue ainsi que les « torsions du retour » que l’auteure repère dans l’œuvre de Rodin.
La question de la temporalité surgit aussi dans l’étude que Natacha Pfeiffer propose de la série des arbres chez Piet Mondrian (1872-1944). Elle sou-
ligne l’importance que le peintre accordait au terme théosophique d’ « évolution » et au rôle du geste répétitif : « l’unité de base de la forme sérielle n’est pas à rechercher dans une toile particulière, mais dans un geste : le geste répétitif de repeindre une toile ». À travers la série et la répétition, Mondrian travaille l’abstraction destructrice en vue d’atteindre le « degré zéro de la peinture », son « essence universelle » dont témoigne, selon Pfeiffer, la dernière toile inachevée du peintre, Victory Boogie-Woogie (5).
Louis Antoine Mège s’intéresse aux artistes du groupe anglais Art & Language et voit dans leur obstination « à répéter, entre 1982 et 1983, une même représentation picturale de leur atelier » une façon de poursuivre la critique « du modernisme et de ses stéréotypes, initiée dès la fin des années 1960 ». Se fondant sur Brecht et Benjamin, tout en évoquant le contexte social anglais, ces artistes font ressortir la dimension expérimentale et théâtrale de l’atelier transformé en support de performance : « ce sont des ‘artistes jouant les artistes’ ». Comme le souligne Mège : « la répétition de la représentation du lieu de production » engage alors autant le regardeur que le faiseur. Au théâtre, domaine par excellence des reprises et des répétitions, Gaëlle Périot-Bled souligne le tournant qu’opère Antonin Artaud (1896-1948) lorsqu’il revendique, contre la soumission au texte, la « compression énergique » de celui-ci. Périot-Bled examine les répercussions de ce bouleversement dans deux spectacles contemporains (celui de Pascal Rambert, Clôture de l’amour, 2011 et celui des Chiens de Navarre, La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ?, 2020). Chez Rambert, l’auteur s’efface devant les acteurs. Avec les Chiens de Navarre les acteurs jouent « un texte absent en vue d’un non-spectacle ». Leurs répétitions théâtrales semblent confirmer les propos du poète Frédéric Forte : « la répétition, c’est aussi croire ou espérer que chaque fois que tu refais la même chose […] il y a d’autres choses qui naissent et qui n’étaient pas là avant ».
En fin de parcours, « pour ne pas conclure… », Marianne Massin indique la force de la répétition capable d’engendrer une sorte de mise en abîme, un vertige qu’elle nous invite à vivre en regardant la vidéo de Christian Marclay, Doors (2022). A l’instar des portes, les livres, sans cesse, s’ouvrent et se referment sur d’autres livres qui eux-mêmes, etc… Répétition infinie sur le théâtre du monde, comme pour se détourner de « la vraie reprise » tapie derrière les coulisses, là où regardait un Kierkegaard : « Ses enfants furent la seule chose que Job ne reçut pas au double, parce que la vie humaine ne se laisse pas ainsi redoubler. Seule est possible ici la reprise de l’esprit, quoique, dans la temporalité, elle ne soit jamais aussi parfaite que dans l’éternité, qui est la vraie reprise » (6).
Chakè MATOSSIAN ■
———
(1) S. Kierkegaard, Gjentagelse (1843), traduit par P.H. Tisseau sous le titre « La Répétition » et par Nelly Viallaneix sous celui de « La Reprise » en soulignant qu’elle concerne l’intériorité en tant que « changement dans le même ».
(2) « L’Arménie me trouble toujours », écrivait Yves Bonnefoy. Voir : « Mes souvenirs d’Arménie » in Le lieu d’herbes, Paris, Galilée, 2010, p. 68. Repris dans l’édition bilingue Français-Arménien, traduit par Chouchanik Thamrazian, Erevan, Nairi, 2014.
(3) Digamma (gamma double) est une lettre grecque archaïque.
———
(4) Titre de son livre (publié aux éditions Le Pommier en 2023) dont nous avions fait le compte-rendu paru dans NH-Hebdo n°348 du 23 mars 2023.
(5) Dans une perspective très différente, Clélia Nau a démontré que ce tableau « est une espèce de fleur », « une fleur abstraite, polycentrée, réduite à l’énergie centrifuge de sa dissémination ». Cf. C. Nau, « La vie des formes : le paradigme de l’éclosion », in La Part de l’Œil, n°38, Bruxelles, 2024.
(6) S. Kierkegaard, La Reprise.
© 2025 Tous droits réservés