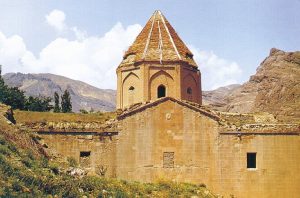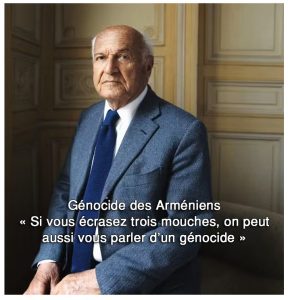Sophie Delaporte
Éditions Odile Jacob, 2023,
300 p., 25,90€
Spécialiste de la médecine de guerre, l’historienne Sophie Delaporte se propose de faire connaître au public francophone un médecin étatsunien à ses yeux trop oublié, même en son pays, Thomas W. Salmon. Rappelant son milieu familial (dépressif), elle retrace le parcours de ce personnage qui, de simple médecin, est devenu, par son travail sur le terrain et sans passer par une formation académique, un psychiatre reconnu. Amoureux de la mer, c’est en elle qu’il disparaîtra.
Thomas Salmon (1876-1927) a, selon Delaporte, « contribué à modifier la discipline psychiatrique, à changer la profession et la place de celle-ci dans le champ médical, mais aussi au sein de la société tout entière ». Le livre souligne les difficultés de la psychiatrie à exister dans le monde médical et, par là-même, les connexions qui s’établissent entre la médecine, les domaines politiques et financiers. Nous sommes cependant loin ici des lectures critiques qu’un Michel Foucault nous a laissées sur les relations entre la médecine et le pouvoir, sur l’enfermement du fou avec la création de la folie, sur les rapports entre discipline du corps et pouvoir. Delaporte s’en tient au niveau de la biographie narrative, en s’appuyant sur de nombreux documents permettant de mettre en avant le rôle de ce médecin dont le travail a mis en lumière la spécificité des traumatismes de guerre.
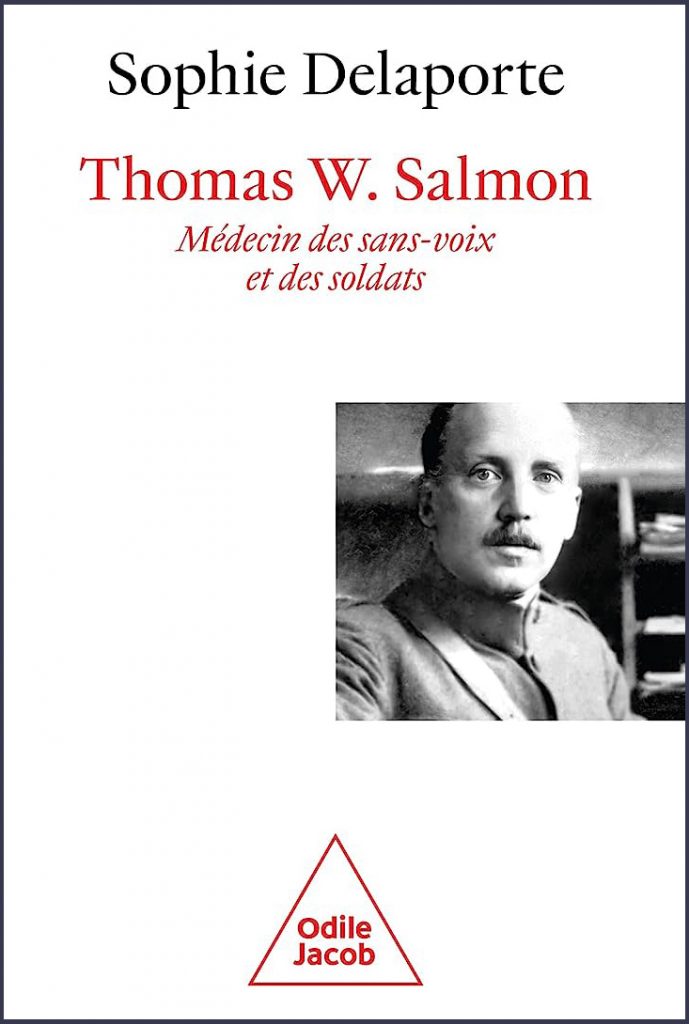
C’est à Ellis Island, l’île où débarquent par milliers les immigrés voulant s’établir aux Etats-Unis, que Salmon a d’abord commencé à travailler. Il participe au triage médical qui consiste à repérer en quelques secondes (de quatre à six secondes) les signes de maladie ou de troubles mentaux. Aux Etats-Unis, comme ailleurs, la politique raciale et l’idéologie eugéniste ont cours. Voulant écarter toute lecture anachronique, Delaporte tente d’amoindrir le racisme de Salmon en rappelant le contexte idéologique de l’époque, mais elle admet volontiers que Salmon soutient l’eugénisme. Il faut trier afin que la « race » ne dégénère pas. A Ellis Island, tous ceux porteurs de « stigmates de la dégénérescence » sont marqués à la craie pour être refoulés.
En lisant la biographie de Sophie Delaporte, l’on peut remarquer chez Salmon une vision logistique de la situation. Il veut organiser le triage par une rationalisation basée sur des notes et des statistiques, ce qui lui donne l’occasion de réaliser du même coup une expérience eugénique. Le médecin témoigne par ailleurs d’un regard humaniste sur les troubles mentaux, en tenant compte du vécu des personnes, de leur milieu. En 1912, Salmon rejoint le Comité national d’hygiène mentale créé à la suite, notamment, du livre autobiographique de Clifford Beers dont la parution a été soutenue par le philosophe William James (1842-1910) et le neurologue zurichois Adolf Meyer (1866-1950). Ce dernier a démontré le rôle de l’« environnement », notion dont Salmon se servira en la dénommant « psychobiologie ». Salmon connaît aussi les ressorts de la communication, il est un bon communiquant et cherche à faire connaître au public l’existence des troubles mentaux, à le sensibiliser afin que les « fous » soient regardés comme nécessitant un traitement et non plus comme cibles d’un rejet violent. Ainsi, en 1913, le Comité présente-t-il une exposition accompagnée d’un catalogue qui toucheront un large public. Soutenu par la fondation Rockefeller le Comité et donc Salmon, peuvent mener à bien les enquêtes sur le terrain dont Delaporte décrit avec minutie les étapes et les conditions. En intervenant à la demande des états, les enquêteurs visent à promouvoir l’amélioration des soins, celle de la formation des médecins et in fine à modifier la législation pour « améliorer la situation des plus vulnérables », des « fous et faibles d’esprit » jusque-là enfermés de façon ignoble, particulièrement les pauvres placés dans des cages sordides.
Dès 1917, en préparation à l’entrée des E-U dans la grande guerre, Salmon réfléchit, avec d’autres neurologues, au rôle de la « ‘neuropsychiatrie’ dans l’armée en temps de guerre » afin de pouvoir répondre aux névroses de guerre, aujourd’hui dénommées PTSD pour « Post traumatic stress disorder » (syndrome de stress post-traumatique). Aux maladies et blessures physiques propres au champ de bataille, s’ajoutent donc les désordres mentaux (« shell shock », expression controversée que Salmon n’apprécie guère) souvent occultés et pour lesquels le groupe de Salmon recommande la création d’unités spéciales, ainsi que le détaille Delaporte. Au fil des décennies, les recommandations de Salmon se sont transformées en espèces de dogmes (« proximité, immédiateté, espoir ») que les Américains appliquent dans leurs multiples guerres. Selon Salmon, la névrose serait dictée par l’instinct d’auto-conservation, il la voit comme un « symptôme somatique » permettant au soldat (ce sont plus souvent les officiers, plus cultivés, qui la développent) d’échapper à la guerre. Arrivé en Europe en 1917 pour accompagner l’armée américaine, Salmon restera près des champs de bataille (assez confortablement), observant ce qui se passe en Grande-Bretagne et en France (où l’on recourait aux électrochocs). Il regrettera l’évacuation des malades dans des asiles loin de la ligne de front et prônera leur maintien dans leur environnement proche car il y subsiste une « vigueur mentale »
« favorable aux thérapeutiques » dans lesquelles le rôle du soignant s’avère pour lui essentiel. Salmon fonde la rééducation sur une activité pratique et utile comme la fabrication des équipements ; en construisant, le malade s’investit dans l’objet qu’il crée, ce qui le dynamise et lui donne l’espoir d’une réussite. La thérapie par le travail sera appliquée en 1918 aux soldats américains atteints de névrose de guerre en France. Leurs activités comportent le cassage de pierres, la construction d’une route ou encore l’artisanat. La rééducation motrice aide au déblocage émotionnel, tout comme que la verbalisation et la représentation par l’image, le dessin. Quoi qu’il en soit, il n’est pas question, pour Salmon, qu’un soldat malade retourne au combat. Accumulant observations et notes, enquêtes et chiffres, Salmon en vient à proposer des méthodes de sélection des recrues américaines en affirmant qu’il existe en chaque soldat un « point de rupture ».
Aussi est-il impératif, pour l’armée américaine, de détecter parmi les candidats mais également parmi les soldats et les officiers, ceux qui présentent des troubles, des symptômes d’addiction, de faiblesse mentale ou nerveuse, afin d’éviter leur envoi sur le front européen où ils ne font que rendre la situation plus difficile. Le combat de Salmon, simple médecin, pour la reconnaissance d’une intégration nécessaire de la psychiatrie dans le domaine de la médecine militaire n’a évidemment pas manqué de susciter des inimitiés, comme celle du neuropsychiatre universitaire Bailey. Parallèlement, Salmon reçoit aussi de nombreux soutiens ainsi que le relève Delaporte.
Il y a la guerre mais aussi l’après-guerre et la situation des vétérans « psychonévrosés » à laquelle Salmon veut trouver une réponse lorsqu’il rentre aux Etats-Unis en 1919. Il lutte pour l’installation d’un institut neuropsychiatrique avec un personnel formé et pour le droit aux indemnisations. Ce qui paraissait possible sous la présidence de Wilson le sera beaucoup moins sous celle de son successeur, Warren Harding. Ce dernier n’a d’empathie et d’admiration que pour les mutilés de guerre et considère les troubles mentaux comme une forme de « luxe ».
Salmon connaîtra la reconnaissance institutionnelle en 1921 où il est nommé professeur de psychiatrie au College of Physicians and Surgeons de l’Université de Columbia, officialisant ainsi l’intégration de la psychiatrie dans la médecine. L’institut-hôpital qu’il crée à Columbia allie enseignement, recherche et clinique. Outre les domaines déjà connus comme l’immigration et la santé mentale, il s’oriente alors vers de nouvelles questions jusqu’ici effleurées comme la criminalité, l’enfance délinquante et la prévention de la délinquance.
L’œuvre de Salmon aura donc mis en relief « l’impact de la guerre sur la psyché » et la nécessité d’un accompagnement qualifié en vue d’une réinsertion des vétérans de guerre dans la société civile. Des décennies après Salmon, les troubles mentaux engendrent encore dans certains pays un sentiment de honte et mènent à un enfermement des malades dans des conditions indignes.
La psychiatrie évolue avec la guerre, car les nouvelles armes (comme les drones tueurs utilisés par l’Azerbaïdjan en Artsakh) créent aussi des situations inédites générant d’autres formes de traumatismes, comme le signalent Christopher Markosian (1) et ses co-auteurs qui examinent le cas de l’Artsakh et de l’Arménie. Le livre de Sophie Delaporte, consacré à Salmon, nous révèle, par-delà la biographie spécifique de ce médecin, l’urgence d’une aide psychiatrique en Artsakh (2) pour soigner mais aussi pour anticiper les traumatismes de guerre. Pour être moins visibles que les mutilations physiques, les dégâts psychiques n’en sont pas moins réels. La répétition des événements traumatiques (génocide, tremblement de terre (3), guerre) tend à les aggraver et même à occasionner, selon certains auteurs, une transmission possible par voie épigénétique (4).
Chakè MATOSSIAN
______
(1) Christopher Markosian et alii, « War in the COVID-19 era: Mental health concerns in Armenia and Nagorno-Karabakh”, International Journal of Social Psychiatry, 2021; https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00207640211003940
(2) La psychiatrie et la pédopsychiatrie commencent seulement à se développer en Arménie. Ces disciplines sont soutenues par l’intervention de Santé Arménie qui alerte sur la nécessité de prendre en considération les traumatismes de guerre.
https://www.santearmenie.org/groupe-2/psychiatrie-&-psychotraumatisme
(3) Armen Goenjian, Alan Steinberg, Robert Pynoos, Lessons Learned in Disaster Mental Health – The Earthquake in Armenia and Beyond, Cambridge University Press, Mai 2022.
(4) Cf. notre compte-rendu du livre d’Etienne Danchin, La synthèse inclusive de l’évolution, in Nor Haratch Hebdo, 9 mars 2023.