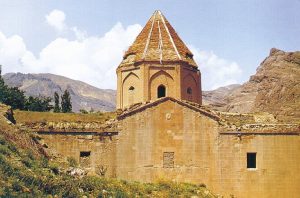Pierre Déléage
Traité des mondes factices
Paris, P.U.F., (Perspectives critiques), 2023,
250 p., 18,00€

Le livre de Pierre Déléage (anthropologue et philosophe) semble assouvir ce que saint Augustin appelait la « concupiscence morbide », tant il se nourrit de récits macabres, hallucinatoires, paranoïaques et vertigineusement cauchemardesques, qui forment tout un pan de la science-fiction à visée apocalyptique. La question du « factice » hante depuis toujours la philosophie. Celle-ci n’a eu de cesse, au moins depuis Platon, de dénoncer le simulacre du réel pris pour la réalité. Dans la République, Platon développait la célèbre allégorie de la caverne : le monde dans lequel nous sommes n’est en fait qu’une prison où défilent des ombres que nous prenons pour des réalités. Le philosophe chemine hors de la caverne, parcourt un chemin long et douloureux, accède à la lumière divine (solaire) et il a pour mission de retourner dans la caverne afin de libérer les prisonniers. Mais ceux-ci prennent le philosophe pour un fou et le mettent à mort. C’est ce qui est arrivé à Socrate.
Pierre Déléage s’intéresse aux « mondes factices », il prend pour objet d’étude les récits de science-fiction qui dialoguent entre eux autour d’un « concept narratif », celui du monde clos, dans lequel s’insère celui de « monde miniature ». Mais il n’y a ici aucune lumière solaire, aucune découverte du monde des idées (les réalités de Platon) qui produise la conversion du prisonnier de la caverne en philosophe. Déléage ne recherche nullement l’Absolu, ne s’intéresse pas plus aux projets de sociétés idéales, et s’attache bien au contraire aux « délices de l’horreur », incluant les corps démembrés et les univers apocalyptiques où la matière se désagrège, bref aux univers plutôt glauques imaginés par les auteurs du XXe siècle principalement.
L’auteur commence par rapporter les situations inhumaines contées par la science-fiction ou les films d’horreur qui ont laissé des traces dans le vocabulaire. Tel est le cas du terme « zombi », un concept haïtien qui doit son succès au film gothique de Victor Halperin, White Zombie de 1932, inspiré du livre de William Seabrook, L’Île magique (1929), qui a introduit ce terme créole dans l’anglais américain. Le zombie, rappelle l’auteur, qui examine le parcours de cette créature dans l’histoire du cinéma, « est un corps sans âme, un corps mort, mais pourvu par la sorcellerie d’un semblant de vie mécanique », il servira de métaphore à la critique d’un capitalisme néo-esclavagiste tel que l’a pratiqué l’industrie américaine de la canne à sucre. Comme on le devine, Hollywood se chargera de dépolitiser le zombie en déportant le politique vers le sentimental. Le zombie tentera néanmoins de maintenir sa connotation politique, il lui reviendra d’incarner les masses exterminées du XXe siècle, comme celles d’Hiroshima et du Viet-Nam, lesquelles ne manquent pas de perturber « la douceur, le confort et la sécurité du mode de vie occidental ». Récemment, Darlène Dubuisson a réactivé la dimension politique du zombie en examinant les photos du tremblement de terre de Haïti de 2010 parues dans le Time magazine. Le motif haïtien du zombie sert selon elle de matrice d’interprétation, il opère une déshumanisation des victimes et donne à voir une différence raciale relevant du monstrueux (1).
L’on comprend d’emblée que la dimension politique fait partie de ces inventions de mondes épouvantables et épuisants, sans doute comme une lentille grossissante de notre habitat, notre monde « réel ».
Dès le début du XXe siècle, les romans comme ceux de Wells, supposent la venue d’extraterrestres considérant l’humain comme un être inférieur, qui pourrait être objet de vivisection, de colonisation, d’extermination, tels les bisons, les dodos et le peuple de Tasmanie. Dans ces récits, apparaissent souvent des laboratoires, des virus qui s’en échappent, des développements technologiques finissant par créer des sociétés suicidaires. Toutes sortes d’expériences peuvent être imaginées pour asseoir le pouvoir, comme celle de rendre amnésique et d’injecter des faux souvenirs. On saisit l’occasion pour rappeler que certains états d’aujourd’hui, comme l’Azerbaïdjan, qualifié par Mme von der Leyen de « fiable », c’est-à-dire tenant un discours de vérité et donc non factice, n’a nul besoin de seringue ni de savant fou pour parvenir à cet endoctrinement.
D’où parle le narrateur ? Le point de vue importe, souligne Déléage. Ainsi, Maurice Renard développe-t-il son histoire du point de vue du cobaye dans son livre le Péril bleu (1909) qui marquera les différentes visions et perceptions des extraterrestres, en littérature comme au cinéma. Avec lui se propage l’hypothèse selon laquelle nous serions des cobayes et la terre un zoo d’expérimentation. Les extraterrestres gagnent en réalisme dans les années 1960, lorsqu’apparaît le témoignage oral d’un enlèvement effectué par des extraterrestres. Il s’en est suivi des récits d’amateurs, d’historiens, de psychiatres et de scientifiques qui ont alimenté la science-fiction, encore renforcée par la croyance d’après laquelle des extraterrestres seraient à l’origine de la fondation d’anciens sites archéologiques.
Déléage intercale (on pourrait presque dire « entrelarde ») dans ses commentaires sur les livres et les films de fictions angoissants, des pages insoutenables de cruauté, extraites de l’essai de Jean-Yves Bory, La douleur des bêtes (2013) qui cite les rapports des expériences de vivisections réalisées par des médecins ou des vétérinaires sur des chiens, des chevaux, des ânes, des lapins. Le lecteur ne saisit pas trop pourquoi ces extraits décrivant des actions réalisées apparaissent dans un livre consacré à l’analyse des récits de science-fiction apocalyptiques. Une complaisance envers le sadisme ? Ou peut-être une façon de dénoncer, à la suite de saint Augustin et de Nietzsche, la violence voyeuriste de notre curiosité que viendrait masquer le beau nom de « science » ? Quoi qu’il en soit, il est ainsi sous-entendu que tout ce que nous infligeons aux bêtes pourrait nous être infligé, ou l’est déjà. Il suffit de considérer le groupe objet de l’expérimentation comme « inférieur » pour se permettre toutes les atrocités possibles. Ce que savent parfaitement certains groupes humains pour l’avoir vécu.
Dans Fragment d’histoire future (1896) (2), « fantasmagorie supranaturaliste à la fois loufoque et inquiétante », Gabriel Tarde avait prédit la mort thermique de l’univers. Un refroidissement climatique entraîne la disparition de l’humanité à laquelle échappent deux groupes réfugiés (l’un des groupes étant chinois) dans les entrailles de la terre recouvertes de glace. Le monde de Tarde est « devenu entièrement artificiel », et « se substitue sereinement aux derniers reliquats du monde naturel », il expose ainsi l’« anthropisation de la planète », une extinction de la nature.

Toros Roslin, La fournaise ardente, 1266, rituel Machtots (Ms. 2027, fol. 14 V.)
Déléage mène le lecteur dans le morbide, en se référant à la mission de Diego de Landa, franciscain chargé d’évangéliser les Mayas au Yucatán au XVIe siècle. Il décrit le rituel Maya sacrifiant les esclaves par écorchement, cannibalisme et revêtement de leur peau par les sacrificateurs. Revêtir la peau des morts peut devenir un fantasme qu’Edward Theodore Gein, un Américain psychopathe a réalisé en 1945, à la suite du décès de sa mère, en tuant des femmes ou en profanant des tombes dans le désir de fusionner avec sa mère. Son histoire aura inspiré Hitchcock (Psychose, 1960) et Jonathan Demme (Le silence des agneaux, 1991), ou le terrible film Massacre à la tronçonneuse (1974) qui, censuré durant quelques années, connut ensuite, pour cela-même, un succès générateur d’atrocités : « son impact sur l’imaginaire contemporain est difficile à mesurer tant il est étendu », affirme Déléage. Que cherche à faire comprendre l’anthropologue en nous menant dans ce parcours accablant et pervers ? Nous montrer que nous dépeçons les animaux sans y penser alors que nous vomissons d’horreur à l’idée d’un revêtement de peau humaine ? Oui, l’auteur insiste dans son livre sur la cruauté envers les animaux. Mais, plus profondément, Déléage perturbe notre tranquillité en nous montrant la fascination (de certains) pour l’atrocité, celle que saint Augustin dénonçait dans les Confessions en convoquant l’exemple de l’attroupement des foules dès qu’il y a un cadavre. Déléage quitte la métaphore pour préférer la métonymie, il s’agit « d’être dans la peau » de quelqu’un.
L’auteur, anthropologue, rappelons-le, repère les stéréotypes de sa profession qui circulent dans l’imaginaire collectif et sont très nombreux, apparaissant dans « les plus beaux textes de la littérature de science-fiction ».
Il s’attarde sur Louise Banks, le personnage central d’une nouvelle de Ted Chiang, L’histoire de ta vie (1998) que Denis Villeneuve adaptera au cinéma en 2017, dans Premier contact. On y voit l’héroïne entrer en communication avec des extraterrestres dont l’écriture tout à fait particulière témoigne d’un autre mode de pensée, « un mode de conscience simultané et panoramique ». Le livre pose ainsi la question de la temporalité et admet que « le futur existe déjà », que le flux temporel n’est qu’une illusion engendrée par la conscience, désormais changée en « conscience éternaliste ».
Il reviendra au livre du philosophe des sciences, Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini (1957) de démontrer l’opposition entre l’univers infini prôné par les grands astrophysiciens (Tycho Brahé, Kepler…) et la conception médiévale aristotélicienne du monde clos. Or, c’est ce monde clos qui se maintient avec force dans la littérature de science-fiction du XXe siècle, en tant que monde factice et non plus naturel. Les « variantes du monde clos » examinées par Déléage sont sous-tendues par un contrôle totalitariste et une « tentation génocidaire » mais, du fait de leur clôture, s’y trouvent aussi imaginées l’émancipation et la libération. Le génocide va souvent de pair avec le monde clos, de même que le fantasme du pouvoir absolu et la terreur de l’enfermement dans un monde factice qui pousse à l’émancipation, à la transgression libératrice. L’une des principales sources d’inspiration sera l’essai du physicien John Desmond Bernal, The World, the Flesh and the Devil, écrit en 1929. Déléage examine bon nombre de nouvelles et de films traversés par la « relation entre miniaturisation et temporalité distendue », comme dans le récit de Fitz-James O’Brien, La lentille de diamant (1858). Ces récits font apparaître des mondes clos dans l’infiniment petit, des créatures submergeant leur créateur, qui n’est plus forcément une intelligence humaine mais désormais informatique, créant un monde virtuel simulant un monde réel qui n’est pas nécessairement le monde matériel.
Déléage, rappelle souvent l’importance du point de vue des personnages, la perspective changeante qui leur fait voir tout à coup leur monde réel comme une contrefaçon, et donc la « prise de conscience » qui en est indissociable. Mais d’autres récits perturbent cette conscience car le personnage peut aussi découvrir qu’il « est en fait une intelligence artificielle ». Le doute quant au monde se déplace sur la facticité de l’être : suis-je un simulacre informatique ? La question n’est finalement qu’une version technologisée de celle que Descartes posait dans ses Méditations, mais elle apparaît ici sous forme de récits et de films. Au reste, Déléage trouve à certaines de ces narrations une portée métaphysique dont il répertorie même les « ingrédients »
dans « le roman philosophique » de Philipp K. Dick, Ubik (1966). Il le considère comme « un traité achevé de métaphysique expérimentale » dans lequel il repère l’influence de certains psychiatres comme Ludwig Binswanger ou Viktor Emil von Gebsattel et de certains textes sacrés comme le Livre des morts tibétain (Bardo Thödel). Pour Déléage, Dick, lecteur de Leibniz, « apparaît au XXe siècle comme le plus grand philosophe des métaphysiques contrefaites ». Ses textes, même ceux inachevés (Joe Protagoras) proposent, dans une époque marquée par la physique quantique, des mondes alternatifs infinis, réels, superposés ou parallèles et simultanés, dans lesquels s’inscrivent aussi ses orientations politiques. Dick s’attaque à la complexité du « faux »,
par une mise en abîme (des « faux faux »), par une confusion entre le modèle et son imitation. Le « faux faux » est « un objet qui prétend être une copie mais qui est en fait un exemplaire authentique ».
Tous les récits lus par Déléage se trouvent chargés d’affects et de fantasmes. De par leur immense popularité, ils révèlent « un mode de sensibilité propre à une période historique particulière, la nôtre ». Nous y reconnaîtrions notre aliénation. Si certains nous promettent la libération, d’autres, « peut-être plus lucides » selon lui, observent la mise en péril d’un monde de plus en plus artificiel.
Une lucidité optimiste ne pourrait-elle exister ? Que la science-fiction productrice de mondes monstrueux nous permette non seulement d’observer le nôtre mais également d’intervenir concrètement dans sa construction, est ce que nous montre l’urbaniste et géopolitologue Federico Cugurullo (Trinity College, Dublin) en recourant au Frankenstein de Mary Shelly. Dans Frankenstein Urbanism (3), il étudie les écovilles, les villes intelligentes et la ville future gérée par l’intelligence artificielle (AI en anglais) à aune de l’histoire du monstre. L’auteur ne prédit rien ; optimiste, il refuse la fin apocalyptique et mortelle (Frankenstein), il préfère de loin Eros à Thanatos, la réunion à la désagrégation. La ville telle que nous la connaissons encore, définie en tant qu’espace gouverné, planifié et expérimenté par des intelligences humaines sera complètement modifiée par l’intelligence artificielle, mais in fine ce sont les humains qui devront répondre des conséquences de cet urbanisme expérimental.
Chakè MATOSSIAN
(1) Darlène Dubuisson, « The Haitian zombie motif: against the banality of antiblack violence”, Journal of visual culture, August 2022, Sage ed.
(2) L’ouvrage de Gabriel Tarde peut être consulté en ligne (Dans la description d’un projet de construction, Tarde fait venir d’Arménie les matériaux qui lui sont nécessaires) : https://www.articule.net/wpcontent/uploads/2019/01/GabrielTardeFragmentHistoireFuture.pdf
(3) Federico Cugurullo, Frankenstein Urbanism – Eco, smart and Autonomous Cities, Artificial Intelligence and the End of the City, London, Routledge, 2021.