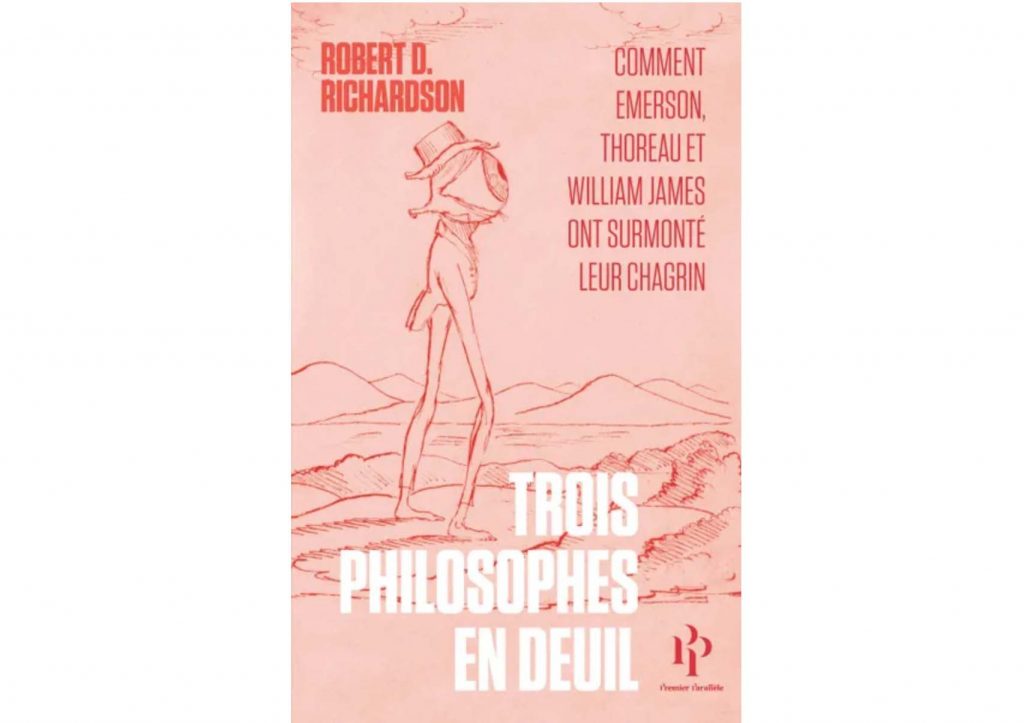
Trad. de l’anglais (Etats-Unis) par Frédéric Joly
Premier Parallèle, 2025,
171 p., 19,00€
La perte d’un enfant, d’un frère, d’un être cher est assurément un événement douloureux mais hélas cruellement banal. C’est pourquoi il ne suffit pas d’avoir souffert pour être écrivain, philosophe ou artiste, tout comme il ne suffit pas de se droguer pour devenir un Baudelaire ou un Rimbaud. Il se pourrait, en revanche, que l’expérience tragique participe de l’œuvre et, en opérant un tournant dans la vie d’un être, lui révèle quelque chose de lui-même et en lui-même, qui le pousse à créer. Dans son petit livre, Trois philosophes en deuil, Robert D. Richardson retrace en les entrecroisant, les biographies de trois philosophes états-uniens majeurs, Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Henry David Thoreau (1817-1862) et William James (1842-1910). Il les rapproche à partir de l’expérience du deuil, dès lors que tous trois ont dû supporter très tôt la mort d’un proche (une femme, un enfant, un frère, une cousine aimée). Cela n’explique pas leur œuvre mais y circule, comme Richardson veut le montrer en enquêtant sur le rôle et la place de la mort dans leurs idées. Il se plonge dans la correspondance et les journaux intimes des trois penseurs pour faire entendre leur voix, c’est-à-dire ce qu’il y a en eux de vivant. Dans un langage simple, Richardson opte pour la « biographie documentaire », il décrit la façon dont ces trois hommes ont « surmonté leur chagrin », comme l’’indique le sous-titre du livre et qu’il nomme d’un mot que l’on entend sans doute un peu trop aujourd’hui, la « résilience ». Richardson en convient, « la résilience n’a rien de très original ni de très inhabituel », mais elle est au cœur de la philosophie d’Emerson qui parle, lui, de « compensation ».
Emerson, pasteur unitarien, perd très tôt sa femme Ellen. Elle avait dix-neuf ans et aimait la poésie, elle en écrivait. Dans sa mission religieuse, Emerson applique une nouvelle méthode consistant à « étudier les textes bibliques en les comparant dans leurs langues originales ». En parallèle, il s’intéresse aux sciences naturelles. Quatorze mois après la mort de sa femme, il fait ouvrir le cercueil. Il voit ce qu’il voit. Il n’en dit rien, mais il abandonne son ministère, c’est un renversement copernicien dans sa vie : « je considère que l’astronomie copernicienne a rendu absolument impossible – et c’était là une conséquence inévitable – toute croyance dans le schème théologique de la rédemption ». Cette conversion à rebours lui fait prendre le large, découvrir l’Italie et Paris, où il suit les cours de chimie de Louis-Jacques Thénard (1777-1857) et Louis-Joseph Gay-Lussac (1778-1850) à la Sorbonne. La visite du Jardin des Plantes provoque un éblouissement total et le métamorphose, il y capte ce que recèle la beauté des oiseaux et de la nature et c’est alors que « le très puissant principe de vie en vient à supplanter entièrement les sentiments de perte et de désespoir ». À Londres, il rencontre Coleridge et se lie d’amitié avec Carlyle en Écosse. Richardson rappelle l’adhésion de Carlyle à l’idéalisme transcendantal allemand (Fichte, Schelling) et à l’hindouisme, ce qui est important pour saisir la fusion de l’esprit avec la puissance féroce de la vie. De retour à Boston, Emerson consacre ses livres et ses conférences au langage de la nature, qui est en quelque sorte la langue originale qu’il recherchait, celle qui fait correspondre les mots et le réel, une langue de vérité dont les autres, conventionnelles, ne seraient que des comparaisons affaiblies : « Le pouvoir que possède un homme d’exprimer sa pensée en la reliant à un symbole qui lui est propre dépend de la simplicité de sa personnalité, à savoir de son amour de la vérité et de son désir de la communiquer sans perte. La corruption de l’homme entraîne une corruption du langage », écrit Emerson dans ses Essais (1).
Henry Thoreau, qu’une amitié sincère et profonde liera à Emerson, se plonge lui aussi dans les livres d’histoire naturelle qui lui procurent « une vision authentique et joyeuse de la vie ». La joie le quitte lorsque meurent son frère et son fils, mais c’est encore grâce à la nature qui vibre pour lui dans le livre Le vrai messie (1829) où l’auteur, Guillaume Oegger, disciple du célèbre mystique Swedenborg, expose les « principes de la langue de la nature », que Thoreau, perdu « comme une plume flottant dans les airs » et cerné par d’« insondables profondeurs », commence à se remettre d’aplomb. Richardson examine le livre majeur de Thoreau, Walden, à la lumière d’une recension des « rapports sur l’agriculture dans le Massachusetts » qu’Emerson lui avait demandé d’écrire. A partir de là, la vision anthropocentrée cède le pas à une vision centrée sur la nature dans laquelle Thoreau se fond. Il écrira : « Ma soif de savoir est intermittente, mais mon envie de baigner ma tête dans des atmosphères inconnues à mes pieds est pérenne et constante. Le plus haut point que nous puissions atteindre n’est pas le savoir, mais la sympathie avec l’Intelligence » (2). La santé du monde naturel inclut la mort car la nature « retrouve ses biens sous d’autres formes sans la moindre perte ». Il n’y a donc pas de mort et cette conviction, écrit Richardson, « sert puissamment la résilience individuelle ».
William James perd sa chère cousine, frêle, vive et intelligente, Minny Temple, emportée par la tuberculose lorsqu’ils avaient tous deux une vingtaine d’années. Ils s’écrivaient pour échanger leurs idées et leurs doutes sur la religion. A la mort de Minny, William lui écrit en imagination dans son journal intime. Il s’adresse à elle et note une citation en sanskrit dont Richardson rappelle l’origine et le sens. Elle provient, « des plus anciennes Upanishad, la Chandogya » et vise à exprimer la jonction entre le monde et soi-même. Mais William James se trouve sous l’emprise de phobies et d’une crise de neurasthénie, il vit une expérience quasiment religieuse, une sorte de conversion, après avoir lu Renouvier qui lui fait prendre une décision : « mon premier acte libre sera de croire au libre arbitre ». Il faut agir et il importe d’instaurer des habitudes si l’on veut s’en sortir. D’où cette phrase qui résume, aux yeux de Richardson, la position philosophique fondatrice de William James : « je vais postuler que la vie (la vraie, la bonne) réside dans la résistance autonome du moi au monde ».
Richardson achève son livre par un Post-scriptum dans lequel il revient sur le terme de « résilience » afin de souligner qu’Emerson est celui qui, des trois philosophes, l’aura le mieux compris et transmis. La résilience « est en vérité une loi ou une force universelle, susceptible d’être discernée partout où l’on regarde. La résilience est partie intégrante de la nature des choses », écrit-il. Un peu comme Descartes invitant le lecteur déprimé à regarder les choses sous un autre angle, Emerson nous conseille de transformer la privation d’une personne aimée en un guide. Et Richardson fait bien de le préciser, Emerson sait de quoi il parle et nous sommes loin ici de « cet optimisme si facilement récupérable par l’industrie du marketing ». Emerson, fidèle lecteur de Montaigne voit dans la banalité et les petits riens matière à réflexion et à réconfort. Faire du marketing avec les idées d’Emerson, revient somme toute à le classer parmi les « grands » : « Pythagore fut incompris, comme le furent Socrate, Jésus, Luther, Copernic, Galilée ou Newton, comme ne put manquer de l’être tout esprit pur et sage ayant vécu sur cette terre. Être grand, c’est être incompris » (3).
Chakè MATOSSIAN ■
———
(1) Ralph Waldo Emerson, Essais, éd. Michel Houdiard, p. 25
(2) Henry David Thoreau, De la marche, éd. Mille et une nuits, 2003, pp. 57-58.
(3) Ralph Waldo Emerson, Essais, p. 36.
© 2025 Tous droits réservés