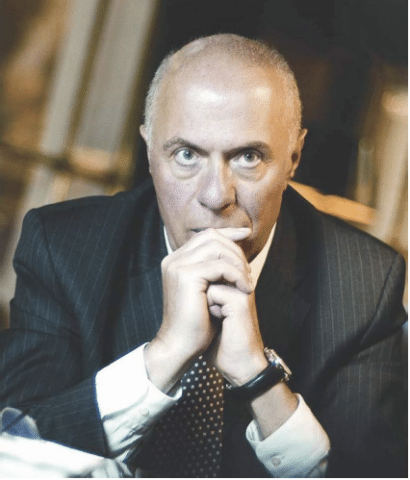
Parler d’une vie professionnelle dédiée au développement, à la fabrication et à la diffusion des produits et services informatiques ainsi qu’aux projets d’enseignement technique (France) et professionnel (Haut-Karabakh) sans faire preuve d’exigence et de rigueur ne mène à rien. A l’inverse, l’évoquer en rencontrant à chaque échelon des dossiers les compétences de chacun (investisseurs, donneurs d’ordre, clients, étudiants) élève le niveau de connaissances de tous et pérennise la solidité des entreprises et des institutions concernées. Autrement dit, le gros œuvre et les bonnes finitions des travaux assurent le label qualité du chantier ; et à l’inverse, sans talent, aucune entreprise d’envergure ne peut perdurer dans le temps sans se lézarder, ni s’effondrer à terme.
L’exemple le plus éloquent est celui de l’École professionnelle Yeznig Mozian (EPYM) : la perte de Chouchi et de Stépanakert en 2020 et 2023 n’a pas empêché de dupliquer le « modèle Yeznig Mozian » lorsque le Fonds arménien de France (FAF) a dû transformer le lycée Patrick Devedjian à Idjevan. Les partenaires français et arméniens de l’Arstakh sont d’ailleurs à la tâche pour parachever cette ambitieuse mission. Bref, c’est bien connu, tout travail bien fait est le résultat d’une exigence, d’une excellence et d’une exemplarité. Pourquoi cette règle des trois « E » devrait-elle se limiter à l’économie et au secteur de la construction ? Pourquoi ne pourrait-elle pas s’élargir au-delà ? Pourquoi ne serait-elle pas transposable dans le domaine de la gouvernance publique et des affaires arméniennes ?
Ce sont des bâtisseurs qui construisent les pyramides et élèvent les cathédrales. Ce sont des hommes qui sont à l’origine des plus belles créations de notre patrimoine commun dans l’espace et le temps. Ce sont leurs compétences qui ont permis aux humains de pouvoir faire et de savoir-faire ce qu’ils nous ont laissés mus par des idées, des valeurs, des magistères, une éthique et des règles de conduite. Qu’ils soient administrateurs, religieux, militaires, philosophes, techniciens, économistes, diplomates ou littéraires, ils sont tous appelés à se dépasser pour une entreprise commune où le bien commun l’emporte sur le gain personnel et où l’intérêt général surpasse l’intérêt particulier. Mais sans cette règle des trois « e », sans ce label qualité, sans cette éthique de responsabilité, l’administrateur devient un censeur ; le religieux, un fanatique ; le militaire, un sicaire ; le philosophe, un charlatan ; le technicien, un bricoleur ; l’économiste, un boutiquier ; le diplomate, un hâbleur ; et enfin le littéraire, un plumitif.
Pour redevenir les artisans, les architectures et les acteurs d’une vie collective décente, il n’y a rien de mieux que de revisiter le passé récent et prendre exemple sur cette génération de titans qui au prix de leur vie ont tout donné pour bâtir l’incroyable en 1918 juste trois ans après un génocide qui a décapité une nation, séparé les élites du peuple et déraciné une civilisation de son environnement, bref arraché un patrimoine à la Grande Histoire. Les bâtisseurs de la Ière République méritent des statues, des monuments, des rues et des musées mais ils méritent avant tout d’être réhabilités dans ce qu’ils ont fait de mieux : renouer les Arméniens avec leur passé de bâtisseurs au nom de la règle des trois « e ».
Qu’ils s’appellent Aram Manoukian, Alexandre Khadissian, Simon Vratsian, Hovannes Katchaznouni ou encore Mantachev, Gulbenkian et Boghos Nubar Pacha, tous autant qu’ils sont n’ont pas figé les Arméniens dans leur passé mais plutôt jetés les fondations de leur avenir. Aucun d’entre eux n’a envisagé le futur en regardant dans le rétroviseur, sauf pour prendre appui sur les savoir-faire, renouer avec l’esprit bâtisseur et la grandeur d’un peuple à l’histoire trimillénaire. Quel autre point commun peut associer ces hommes issus de milieux différents si ce n’est celui du dépassement, de l’esprit public et de l’intelligence collective comme loi fondamentale du progrès humain. Pour chacun d’entre eux, c’est l’homme qui fait le système, c’est l’homme qui construit le monument et non l’inverse : ce n’est pas le système qui fait l’homme, ce n’est pas le monument qui construit l’homme. Aucun n’a placé une idéologie, un dogme ou une sacralité au-dessus des compétences des hommes.
C’est cet esprit de conquête et de valorisation des potentialités de chacun qu’il faut retrouver dans la démarche collective qui consiste à bâtir l’État, la Maison commune, notre Maison commune.
(Partie 1/2)
St Chaffrey, Ier août 2025