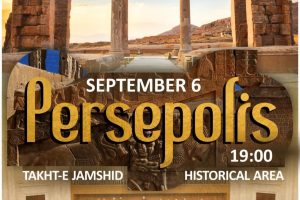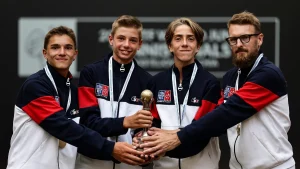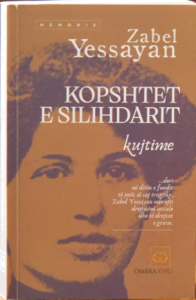Par Chakè MATOSSIAN
La littérature, l’histoire, les cultures, les voyages, l’émigration, nourrissent le travail d’Anna Boghiguian (née au Caire en 1946). Sa formation en économie et en sciences politiques qui a précédé ou accompagné ses études artistiques, lui donne un angle de vision particulier. L’art s’avère chez elle inséparable de l’économie tout comme de l’histoire. Son travail artistique ressortit à la réflexion critique, il vise donc à faire réfléchir (cela même que Proudhon, philosophe anarchiste, exigeait de l’art et dont il trouvait la réalisation dans la peinture de Courbet). Loin de la plate idéologie accompagnant un engagement éphémère et réactif, Boghiguian prend acte de l’injustice comme faisant nécessairement partie de l’histoire. Il ne s’agit pas de larmoyer. Elle fait découvrir des liens méconnus, occultés, entre des situations que tout – le temps, les lieux – semble séparer. L’économie du sel et Alexandre le Grand, le canal de Suez, la culture du coton, l’extinction des abeilles, l’exploitation des matériaux dont les performances procurent un pouvoir militaire et économique nouveau (comme l’acier par rapport au fer).
La manière dont Anna Boghiguian ne cesse d’embrasser le monde et ses représentations a donné lieu à deux expositions récentes en Europe en 2022. L’une était présentée en Espagne, à Valencia, sous le titre « Parfois, de manière inattendue, le présent rencontre le passé » (Institut d’Art moderne) et l’autre intitulée « Le jeu d’échecs » (The Chess Game) occupait le premier étage de la Scuola di San Pasquale du 20 avril au 4 juillet 2022.
Boghiguian regarde les faits, l’époque, le temps, les lieux de près avec une vue sur le temps long. Regarder et représenter implique un questionnement de la vision et, en ce sens, Boghiguian relance la problématique de la « perspective » théorisée à la Renaissance. Michael Baxandall (dans L’œil du Quattrocento) et André Chastel (dans Fables, formes, figures) inscriront l’invention de la perspective dans le contexte économique de la création des banques, des découvertes maritimes et du système mathématique marchand qu’utilisaient les artistes, ce qu’un Michelet avait suggéré un siècle auparavant, sans le développer. Au reste, dans son traité de la perspective, Leon Battista Alberti (1404-1472) comparait le trou du point d’où l’œil regarde à un « ducat ».
Placée sous l’égide de la Kunsthaus Bregenz (KUB) (Autriche) où l’installation sera exposée en automne (du 22 octobre 2022 au 23 janvier 2023), The Chess Game de Venise consiste en un échiquier géant sur lequel Boghiguian a disposé de grandes figurines, un peu comme des marionnettes ou des personnages carnavalesques qui rappellent la peinture d’un James Ensor. Elle met presque à notre échelle les personnages que l’on découpe dans les livres d’enfant. Ces pièces du jeu d’échec détiennent toutes un lien avec l’Autriche, son histoire passée et récente, royale et intellectuelle ou simplement typique. L’anecdotique peut se révéler important : ainsi Rose Bertin, la marchande de mode qui habillera Marie-Antoinette ou Léonard Autié le coiffeur préféré de cette dernière. La vie affairiste de Rose Bertin éclaire le succès toujours actuel de la rue du Faubourg Saint-Honoré où elle avait sa fabrique. Quant au coiffeur, n’est-il pas, à sa façon, une représentation de l’artiste ? Boghiguian décrit la mise en scène des coiffures « poufs » qui pouvaient atteindre deux mètres de haut et dans lesquelles le coiffeur intégrait « des dessins, de petits personnages, des bateaux, des forêts » enfin, « toutes sortes de dessins ».
La problématique de la perspective est donc soulevée par la présence de l’échiquier et celle de la représentation par ses miroitements. L’échiquier reste inséparable de la géométrisation à l’œuvre dans la perspective, de même que dans la guerre, dans les conquêtes territoriales ou le commerce. En effet, bon nombre de dessins et gravures de la Renaissance associent l’échiquier avec le parterre quadrillé destiné aux exercices de l’escrime où la vie et la mort dépendent du déplacement calculé de manière précise. Le jeu d’échecs ainsi que l’escrime renvoient à la géométrisation du support sur lequel les pièces ou l’escrimeur se déplacent et calculent les mouvements selon un « nouvel imaginaire mathématique »1. En installant un échiquier, Boghiguian crée un espace de jeu auquel participe le visiteur. En se déplaçant, il devient le joueur d’échecs qui pourtant ne peut rien changer à ce qu’il voit, si ce n’est la vision de l’ensemble : il tourne autour de l’échiquier, perçoit les personnages tantôt de face, tantôt de dos, et sa déambulation crée une variation dans la perception des relations entre les pièces du jeu d’échecs. Les échecs, au regard de l’histoire, se révèle un jeu intrinsèquement lié à la représentation du pouvoir : il s’agit certes de mettre le roi de la partie adverse en échec (dans une perspective freudienne, tuer aimablement le père) mais les règles montrent bien que le souverain détient un statut à part mis en évidence par ses attributs (couronne, sceptre) et par sa manière unique de déplacement2. Du Moyen-Âge au XVIIe siècle, le jeu d’échecs recevra une interprétation religieuse, politique et pédagogique. La mort du roi n’est que la fin du royaume terrestre qui n’entame en rien l’éternité christique à laquelle le souverain se trouve identifié3. Étant donné l’attention que Boghiguian porte à l’économie, au monde, au pouvoir, l’on ne peut se contenter de prendre l’échiquier comme un simple jeu parmi d’autres mais bien comme le jeu qui, par excellence, problématise le pouvoir et sa relation (aujourd’hui éventuellement nulle) à la transcendance.
En n’accordant pas de rôle particulier à certains personnages, comme c’est le cas des cavaliers (« il en fallait deux et j’en ai donc mis »), Boghiguian traite le temps dans la possibilité de sa suspension : la présence des cavaliers sur l’échiquier ne signifie rien de particulier au moment où elle en parle mais il se pourrait bien qu’à un autre moment, décisif, leur présence sur l’échiquier reçoive une lecture différente. Leur efficacité existe ici ‘en puissance’ et pourrait, selon l’occasion, être ‘en acte’. Il y a aussi une confusion assumée par l’artiste dans les représentations de certains personnages historiques. Ainsi Ferdinand I (1503-1564) a-t-il pris la place du Ferdinand I (1793-1875) que l’artiste voulait représenter, celui, épileptique, qui dirigeait Venise. Boghiguian rattache la guerre à la chasse avec le personnage de Franz Ferdinand (1863-1914), dont l’assassinat à Sarajevo aura déclenché la Première Guerre Mondiale. Il apparaît ici dans son activité favorite, avec l’un des cinq mille daims qu’il était fier d’avoir abattus. Un autre type de chasse au cervidé nous est signalé avec Felix Salten (1869-1945), l’auteur de Bambi que Disney achètera et qui angoissera des générations d’enfants (on notera en passant que le verbe allemand « vertreiben » signifie à la fois chasser et commercialiser). Boghiguian relie Salten à Theodor Herzl (1860-1904), tous deux sionistes et elle rattache ces derniers à la pacifiste Bertha von Suttner (1843-1914). Une case est occupée par le médecin de la mort, le SS Aribert Heim (1914-1992), réfugié en Egypte après avoir tué de nombreuses personnes en leur faisant ingurgiter du lithium. Boghiguian admire Egon Schiele (1890-1918) pour sa liberté, son audace, dans la représentation de la sexualité. Elle lui donne une actualité en associant sa mort due à la grippe espagnole au contexte de la pandémie de Covid. Deux figures intellectuelles complètent l’échiquier : Sigmund Freud (1856-1939) que Boghiguian considère influencé par Nietzsche (mais il faudrait plutôt voir du côté de Schopenhauer) et Ludwig Wittgenstein qui est, selon elle, le plus important philosophe « après Aristote et Platon » (sic). Elle apprécie ce qu’il exprime sur la vision et la lumière. A la suite de Wittgenstein, Boghiguian questionne ce qu’il y a derrière les noms, ces noms connus, historiques ou familiers et étrangers, ce qui se passe lorsque nous percevons des figures, des couleurs et des formes. Wittgenstein écrivait : « À la couleur de l’objet correspond la couleur de l’impression visuelle (ce buvard me paraît rose, et il est rose), à la forme de l’objet, la forme de l’impression visuelle (il me paraît rectangulaire), mais ce que je perçois lors de l’apparition soudaine de l’aspect n’est pas une propriété de l’objet. C’est une relation interne entre lui et d’autres objets » (Recherches philosophiques). Aussi, n’y a-t-il pour lui aucune possibilité de représenter le champ visuel : « Non, on ne peut pas faire une image visible du champ visuel », écrit-il, ajoutant : « le manque de netteté est une propriété interne de l’espace visuel ». En conséquence, conclut le philosophe autrichien : « Le caractère illimité de l’espace visuel n’est pas pensable sans ce ‘flou’ » (Remarques philosophiques).
L’échiquier miroitant respecte en apparence les règles : Boghiguian a inclus le cheval (avec le cavalier) et puis une tour car « dans un jeu d’échecs vous devez avoir un château », annonce-t-elle. De la tour, on observe et on voit l’ennemi arriver. Chaque personnage pourrait être associé à une manière de voir liée à sa fonction : Bertin voit le monde par les corps, de près. Salten les expérimente de l’intérieur. Autié perché sur la tête de la reine, adopte un point de vue de survol. Schiele ose regarder vers le bas et montrer ce que le public ne veut pas voir, Freud aussi, en examinant l’humain sous l’angle des pulsions. L’Ego reste le point de mire du pouvoir des reines et des empereurs mais Marie-Antoinette se laisse guider par les apparences. Vision et perception occupent la pensée de Wittgenstein. En dernière instance, il se pourrait bien que, retenant les remarques du philosophe, Boghiguian laisse au « flou » le soin de mettre le visiteur échec et mat.
1. Les marques au sol et le calcul des mouvements à l’escrime sont tributaires du « nouvel imaginaire mathématique » du XVIe siècle et le jeu d’échecs, faisant évoluer les pions sur un dallage, procède lui aussi d’une mathématisation du mouvement. Georges Vigarello, « Le maniement de l’épée », in Le corps à la Renaissance, Actes du XXXe Colloque de Tours, sous la dir. de Jean Ceard, Marie-Madeleine Fontaine et Jean-Claude Margolin, Paris, Aux Amateurs du livre, 1990, p. 351-355.
2. J-M. Mehl, « Le roi de l’échiquier : approche du mythe royal à la fin du Moyen-Age », in Revue d’histoire et de philosophie religieuse, n°2, Paris, P.U.F., 1978 : « En effet, il lui appartient de débuter le jeu par un mouvement de trois cases, c’est-à-dire par un chiffre constitutif de six présenté comme symbole de perfection. Ce mouvement de perfection conduit le roi jusqu’aux limites du royaume ».
3. Ibid. : « Le but même du jeu manifeste la spécificité royale. Protéger le prince est l’activité essentielle des sujets. Sa mort constitue le signe annonciateur du retour au néant pour tous ceux qui l’ont soutenu et elle symbolise la fin de la société terrestre. La mort du roi est une mort sociale et le roi est la condition nécessaire de la société ».