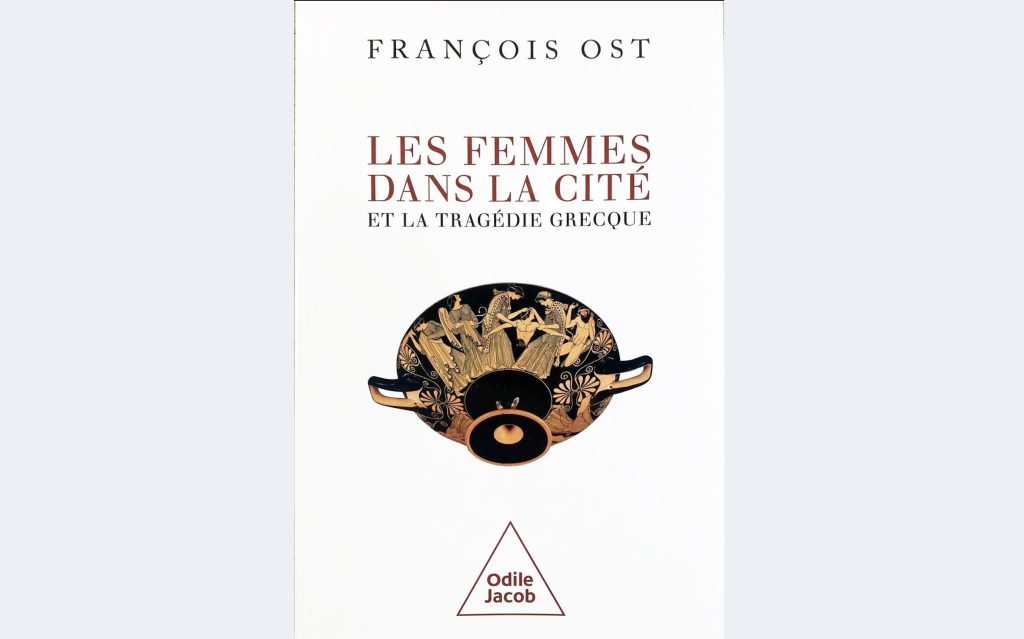
François Ost
Éditions Odile Jacob, 2025,
218 p., 23,90€
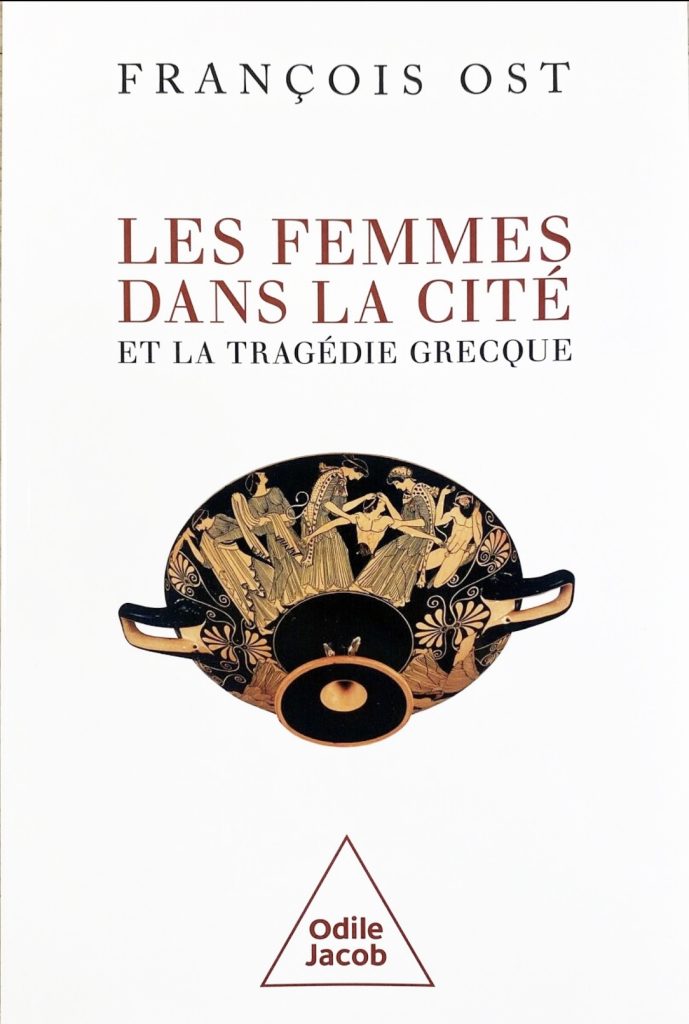
Athéna (née sans mère) incarne l’ordre masculin patriarcal qui règne dans la cité de la Grèce antique. Le droit de cité est un droit d’hommes qui s’opposerait à un désordre incarné par les femmes terrifiantes, opposition qui ne saurait se satisfaire d’une interprétation binaire et ressortit bien davantage à l’ambivalence : en menaçant l’ordre établi, les femmes font évoluer la cité. François Ost, rappelant le contexte historique du genre tragique et son évolution, cherche à comprendre pourquoi l’ordre de la cité repose sur le refoulement de la voix des femmes et il se demande, à la suite d’autres auteurs et notamment de Nicole Loraux (1943-2003), quelle est la portée politique de ces voix qui se font entendre dans les tragédies. Il convoque alors les textes d’Eschyle, Sophocle et Euripide en rappelant l’écart de génération qui sépare déjà Eschyle d’Euripide. Ost reconnaît d’emblée la nouveauté de la perspective créée par Nicole Loraux qui, dans ses ouvrages profonds et passionnants, a cerné la représentation du féminin dans la cité et l’ambivalence qui en ressort, en cherchant à écouter ce qui se dit au-delà des discours du pouvoir.
Dans La voix endeuillée, Loraux analyse l’antipolitique (« l’autre de la politique ; un politique autre », écrit-elle) qui se donne à entendre au cœur de la tragédie à travers deux acceptions d’un mot particulier aeí, généralement traduit par « toujours ». Ce mot / son se retrouve dans les cris et les plaintes qui forment les chants et la musique du deuil. Le deuil est l’affaire des femmes et le son qu’elles profèrent perturbe le sens du discours officiel qui recourt aussi à aei pour faire « la louange d’une cité, éternellement fidèle à son principe » (1).
François Ost, qui est juriste et philosophe, voudrait, par son analyse, « rendre audibles les infrasons et les ultrasons de ces voix de femmes et chercher à comprendre quel effet ces voix, relayées par les poètes tragiques, pourraient avoir sur le droit et la politique de la cité ». Au commencement de son ouvrage, Ost souligne le lien entre les femmes de la tragédie et certaines questions intéressantes qui relèvent du droit : demande d’asile, droit d’enterrer ses proches, devoirs de vengeance, droit du mariage, droit de la guerre. L’auteur lit avec précision les tragédies et ne manque pas de les citer, mais il consacre de nombreuses pages à une sorte de plaisir du classement, multipliant les épithètes qu’il voudrait actifs en recourant au participe présent adjectivé imprimé en italiques (résistante, performante, intransigeante, stupéfiante…) ce qui lasse le lecteur (et surtout la lectrice), d’autant plus qu’il s’agit d’appréciation subjective. Les femmes sont pour Ost un objet de classement, d’abord hiérarchique (déesse, mère, nourrice, concubine, servante…) et ensuite psychologique, comportemental ou sociologique : ce seront les femmes implorantes, terrifiantes, suppliantes, défaillantes, hésitante, endurante, migrantes… L’attrait pour le classement entraîne Ost à établir un « carré tragique » composé de quatre éléments l’ubris (la démesure), la terreur, la pitié et la catharsis, carré dont le centre serait un trou noir dévorant le personnage central qui aurait franchi les limites (on peut penser qu’il s’agit du trou féminin en quelque sorte). L’auteur crée de surcroît des « catégories » pour les femmes mais aussi pour quelques hommes, catégories qui vacillent immanquablement lorsqu’un sujet se trouve dans plusieurs cases à la fois ou déborde, à l’instar de Phèdre qui n’est « qu’à demi terrifiante » tout en étant « défaillante ». Il reste que les classements ne sauraient se substituer à l’analyse et celle que voulait mener Ost sur les « infrasons et ultrasons » dans les voix des femmes apparaît bien souvent comme une description des passions qui dominent les personnages, de façon parfois contradictoire. Ainsi par exemple, Électre, matricide, déborde « d’une joie sauvage » et se montre « froidement déterminée ». Lisant Euripide, Ost trouve Électre « inquiétante et violente » mais, ajoute-t-il, le tragédien ne l’a pas rendue « terrifiante », car « à aucun moment la ligne rouge de la radicale monstruosité ne semble franchie ». On aimerait savoir en quoi consiste la « radicale monstruosité », même si l’auteur a signalé dans un passage de son livre que la transgression de la ligne rouge résultait de l’égarement (atè).
Ost se révèle nettement plus stimulant lorsqu’il cesse les descriptions psychologisantes pour aborder le rapport au droit dans des questions qui restent souvent d’actualité. Ainsi, sa lecture des Sept contre Thèbes où Eschyle aborde la question de savoir s’il faut accorder ou non une sépulture aux ennemis et aux traîtres (Ajax, Antigone), met-elle en évidence la division entre « le droit positif » et le point de vue « plus universel ». Le problème du matricide traité par Eschyle dans les Euménides opposera quant à lui « le droit ancestral qui assimile vengeance privée et justice » et le « tribunal nouveau » instauré par Athéna : « une révolution judiciaire » (mais fragile) se trouve ainsi consacrée, les arguments rationnels prenant le pas sur la vengeance privée et donnant lieu à un « ordre ‘masculin’ » qui n’étoufferait pas la voix des femmes.
Ost examine le droit d’asile dans les Suppliantes d’Eschyle qui tourne autour d’une controverse juridique dont les Danaïdes sont la cause : il y est question de l’applicabilité du droit. Va-t-on appliquer celui « du pays des demanderesses » (Égypte) ou celui d’Athènes, où les définitions de l’inceste ne sont pas les mêmes. Les Danaïdes incarnent « le refus radical du sexe » et « repoussent l’hymen avec horreur » (2), considérant les hommes comme des bêtes aux instincts luxurieux. Dans leur plaidoyer elles invoquent une parenté mythologique afin de refuser le mariage avec leurs cousins, mariage que la loi dicte pourtant puisqu’elles sont « épiclères » (héritières du patrimoine en l’absence de mâle) : « d’un côté donc, la grande loi naturelle du mariage orientée ici par l’institution de l’épiclérat destiné à protéger le patrimoine paternel, de l’autre côté, la prohibition des unions endogamiques ».
Dans le dernier chapitre de son livre Ost analyse Antigone sous l’angle du droit. Avec elle surgit une alternative à l’ordre patriarcal incarné par Créon qui dirige la Cité. Antigone, unique survivante de la famille maudite d’Œdipe (qui est à la fois son père et son frère) révèlerait une nature paradoxale qui mène Ost à la classer comme « morte-vivante », saintement criminelle pour avoir rendu les honneurs funèbres aux siens. En donnant une tombe à son frère Polynice, Antigone obéit aux coutumes dictées par les divinités archaïques mais transgresse simultanément l’édit de Créon. Antigone, fait acte de « désobéissance civile », affirme Ost tout alertant le lecteur sur le risque d’une idéalisation anachronique du personnage. Écoutant de plus près le chœur, Ost se rend compte que celui-ci invoque Dionysos pour « guérir »la cité maudite. Antigone obéissant aux lois non écrites est devenue « l’emblème par excellence du droit idéal (on disait jadis ‘droit naturel’) face au droit contingent des États ». Mais elle reste fautive d’avoir suivi sa loi à elle, c’est-à-dire d’avoir éliminé l’altérité, ce qu’indique, dans le texte de la tragédie, la prolifération du préfixe « auto » que Nicole Loraux avait mis en évidence. Citant Loraux, Ost souligne cette « surdétermination du réfléchi » ce qui l’amène à caractériser la loi d’Antigone, en tant que « l’implacable loi généalogique ».
Dans la notice qu’elle ajoutait à sa traduction de la Médée d’Euripide, Marie Delcourt (1891-1979), la grande helléniste belge trop souvent oubliée, première femme chargée de cours à l’université de Liège, écrivait : « De tous les poètes grecs, Euripide est le seul qui ait dépassé la misogynie populaire et osé dire atroce la condition des femmes. Celle-ci apparaît dans toute son absurdité en Médée, partagée entre une sensualité exigeante qui devrait faire d’elle une esclave soumise, et un caractère auquel les vertus patientes sont étrangères. Au moment même où elle vient de les répudier avec mépris elle dit à sa nourrice : ‘je compte sur toi, tu es une femme aussi’. Toute une vie écartelée tient dans ce pathétique appel » (3). Si, comme l’écrit Ost dans sa conclusion « les questions que posent les femmes d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide sont encore les nôtres aujourd’hui », nous devons alors en déduire que les femmes ne cessent de poser les mêmes questions depuis des siècles. Leur faudra-t-il toujours s’opposer aux lois pour faire avancer le droit ?
Chakè MATOSSIAN ■
_____
(1) Nicole Loraux, La voix endeuillée – Essai sur la tragédie grecque, Paris, Gallimard, p. 50.
(2) Giulia Sissa a étudié le cas des Danaïdes sous la perspective de l’imaginaire du corps féminin et de la représentation de la virginité en Grèce antique, le corps comme « amphore » trouée. Voir G. Sissa, Le corps virginal, préface de Nicole Loraux, Paris, Vrin, 1987.
(3) Marie Delcourt, Notice à Médée, in Euripide, Tragédies complètes, t. I, Gallimard, Folio, 1962, p. 131. Attentive à la représentation de la femme et active dans la société civile, Marie Delcourt a milité dans l’Union des femmes de Wallonie et a rejoint le réseau de renseignement « la Dame blanche » pendant la première guerre mondiale. Parallèlement à ses ouvrages scientifiques, soucieuse de libérer les femmes de leurs corvées ménagères chronophages, l’helléniste a publié, à la sortie de la seconde guerre mondiale, Méthode de cuisine à l’usage des personnes intelligentes, édité chez Baude à Bruxelles, en 1944. Pour elle, « intelligentes » signifie simplement « utilisant leur raison », ; il s’agit d’un livre pratique, offrant des recettes tenant compte de la réalité de la vie des femmes, en opposition aux péroraisons des « chefs ».
© 2025 Բոլոր իրաւունքները վերապահուած են։